SOMMAIRE :
- Dinosaures d'Amérique du Nord
- Dinosaures
- Mésozoïque
- De nouveaux arguments pour l'hypothèse
de l'extinction des dinosaures par impact de météorite
- Extinction (biologie)
- Deinonychus
- Velociraptor
- Diplodocus
- Ptérosauriens
- Ichtyosaures
- Tricératops
- Tyrannosaure
.
Dinosaures d'Amérique du Nord :

Dans mon journal des Galápagos,
je vous ai parlé de ma passion pour les requins. Eh bien, ce
n'était pas tout car j'étais aussi un fan des dinosaures. Là
aussi il n'y avait pas beaucoup de livres pour amateur à l'époque.
Je me rappelle cependant de l'"encyclopédie de la
préhistoire", un de mes livres préférés d'avant mes dix ans, qui me faisait hésiter entre sa lecture et jouer avec
mes amis. Il y avait d'explicites illustrations picturales de
nature à m'entraîner dans de longues rêveries.
L'imagerie numérique a maintenant totalement révolutionné ces
représentations. La science aussi a beaucoup évolué offrant de
nouveaux outils d'analyse pour étudier ces  témoignages
de ce passé révolu. Finies ces représentations de dinosaures patauds,
la queue pendante. Les voici aussi véloces qu'une autruche. On sait
maintenant que certaines espèces (sauropodes par exemples) se déplaçaient en horde, protégeant leurs
petits au milieu comme les éléphants, et qu'ils pondaient
probablement des oeufs dans des aires de nidification qu'ils
gardaient. Même si leur aspect devait être terrifiant pour
certains, ils m'apparaissent beaucoup plus proches de ère
géologique que je ne l'imaginais dans mon enfance. témoignages
de ce passé révolu. Finies ces représentations de dinosaures patauds,
la queue pendante. Les voici aussi véloces qu'une autruche. On sait
maintenant que certaines espèces (sauropodes par exemples) se déplaçaient en horde, protégeant leurs
petits au milieu comme les éléphants, et qu'ils pondaient
probablement des oeufs dans des aires de nidification qu'ils
gardaient. Même si leur aspect devait être terrifiant pour
certains, ils m'apparaissent beaucoup plus proches de ère
géologique que je ne l'imaginais dans mon enfance.

 Une
petite visite du musée des Rockies s'est révélée des plus
instructives. L'Amérique du Nord avait alors un tout autre aspect
que de nos jours. De grandes mers recouvraient alors les plaines de
l'Alberta et des États-Unis. Sur ces côtes évoluait toute une
faune dinosaurienne. De très réalistes maquettes nous permettent
de nous faire une idée de leur taille et de leur mode de vie en
trois dimensions. Seule la couleur est des plus hypothétiques
étant donné l'impossibilité de fixer cette donnée dans la roche. Une
petite visite du musée des Rockies s'est révélée des plus
instructives. L'Amérique du Nord avait alors un tout autre aspect
que de nos jours. De grandes mers recouvraient alors les plaines de
l'Alberta et des États-Unis. Sur ces côtes évoluait toute une
faune dinosaurienne. De très réalistes maquettes nous permettent
de nous faire une idée de leur taille et de leur mode de vie en
trois dimensions. Seule la couleur est des plus hypothétiques
étant donné l'impossibilité de fixer cette donnée dans la roche.




Maintenant, vous allez certainement me
demander ce qui m'a fait choisir la psychiatrie à la paléontologie.
En fait, je pense que ces deux professions ne sont pas aussi
différentes l'une de l'autre. N'ai-je pas souvent demandé à mes
collègues de "creuser" l'anamnèse de nos patients,
d'analyser couche après couche leur histoire, de déterrer les
"nonos" oedipiens ou de vieux souvenirs fossilisés ? La psychiatrie
n'est finalement pas si différente du travail archéologique à la
différence près, mais non négligeable, du setting.


Les personnes intéressées par
ce sujet trouveront ci-dessous quelques articles tirées de
l'Encyclopédie Encarta 2000. L'occasion d'apprendre, de rafraîchir
ou de corriger nos connaissances sur cette époque géologique.
.
1.
PRÉSENTATION
dinosaures,
groupe réunissant environ 350 espèces de reptiles, tous
disparus avant la fin du Crétacé. Les premiers dinosaures
apparurent au Mésozoïque, plus précisément vers le milieu du
Trias moyen, ou au début du Trias supérieur. Petits et légers,
ils étaient bipèdes, carnivores ou omnivores, probablement rapides
et agiles. La plupart d’entre eux ont disparu à la fin du Trias.
Le Jurassique et le Crétacé ont vu l’explosion des dinosaures en
une multitude de types différents, dont certains atteignirent des
tailles gigantesques.
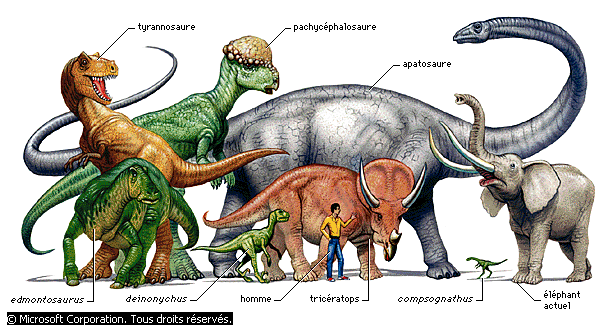
Comparaison des tailles de
quelques dinosaures
La
plupart des dinosaures appartenaient à deux grands ordres, les
ornithischiens et les saurischiens. Les ornithischiens étaient
caractérisés par un bassin ressemblant à celui des oiseaux. C’était
le cas de l’apatosaure, herbivore quadrupède, ou du tyrannosaure,
carnivore bipède. Les saurischiens avaient, en revanche, un bassin
semblable à celui des autres reptiles. Parmi eux, on trouve l’iguanodon,
herbivore bipède, et le tricératops, herbivore quadrupède. Les
plus anciennes espèces, comme le staurikosaure et l’herrérasaure
d’Amérique du Sud, sont trop primitives pour être classées dans
l’un ou l’autre groupe.

De nombreuses différences anatomiques entre les
crânes de l'allosaure, carnivore, du diplodocus, herbivore et du
massospondyle, omnivore, sont liées aux différences de régime
alimentaire de ces animaux.
Dorling Kindersley
2.
DÉCOUVERTE
ET PREMIÈRES ÉTUDES
Les
premiers restes de dinosaures ont été découverts en Angleterre,
au cours des années 1820. Deux décennies plus tard, plusieurs
groupes étaient déjà clairement identifiés. La singularité de
leur taille gigantesque, leur habitat exclusivement terrestre, leur
position verticale et l’inclusion de cinq vertèbres au moins au
niveau de la ceinture pelvienne, les firent baptiser par Richard
Owen, spécialiste d’anatomie comparée, dinosauria, mot
grec qui signifie « terrible lézard ».

Le bec des hadrosaures, aplati, leur a valu le nom
de « dinosaures à bec de canard ». Ces curieux
reptiles possédaient également, sur le dessus de la tête, une
crête osseuse de forme variable selon les espèces. Celle du
parasaurolophe était très longue et dépassait largement en
arrière du crâne.
Ces crêtes, qui devaient jouer un rôle dans la
reconnaissance visuelle entre individus d'une même espèce,
contenaient des conduits aériens, grâce auxquels les hadrosaures
pouvaient probablement produire des sons.
Dorling Kindersley
L’exploration
de l’ouest des États-Unis, vers les années 1880, permit la
découverte de squelettes entiers de dinosaures. Ce n’est qu’à
partir de ce moment-là que l’on put affirmer que les dinosaures
étaient en majorité bipèdes, position inhabituelle pour un
reptile. Cette découverte suscita de nombreuses spéculations au
sujet de leur mode de locomotion, de leur comportement et de leur
physiologie.
C’est
à la même époque que H. G. Seeley divisa les dinosaures
en deux groupes, en fonction de la forme de leur bassin : les
saurischiens (ou sauripelviens), au bassin de reptile, et les
ornithischiens (ou apipelviens) au bassin d’oiseau.
Paradoxalement, ce serait à partir de ces dinosaures au bassin de
reptile que l’évolution aurait donné naissance aux oiseaux. Plus
particulièrement, ils auraient évolué à partir de petits
dinosaures carnivores à dents pointues, comme le Deinonychus
et les Compsognathus.
3.
CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES
Les
dinosaures se distinguaient des reptiles actuels par la position de
leurs membres, plus ou moins ramenés sous le corps à la manière
des oiseaux et des mammifères, plutôt que disposés
transversalement comme chez les crocodiles, les lézards et les
tortues. Ils partageaient cette caractéristique avec les
ptérosaures. Les empreintes laissées par les dinosaures bipèdes
révèlent également qu’ils marchaient comme les oiseaux, une
patte devant l’autre, avec les doigts légèrement recourbés vers
l’intérieur. Leurs pattes antérieures étaient préhensiles et
munies de pouces opposables aux autres doigts. Leur cerveau était
en général plus grand que celui de la moyenne des autres reptiles,
tout particulièrement en ce qui concerne les dinosaures carnivores
et les hadrosaures.
Les
informations récoltées démontrent que les dinosaures avaient une
croissance rapide, tout comme les oiseaux et les mammifères. Ils ne
rampaient pas, à l’instar de la majorité des reptiles actuels,
et leur position dressée impliquait une dépense continuelle d’énergie.
Leurs empreintes, ainsi que la grande taille de leurs membres,
indiquent qu’ils pouvaient se déplacer à grande vitesse.
Il
est difficile de savoir si les dinosaures avaient ou non le sang
chaud. D’ailleurs, un seul mécanisme de régulation thermique est
probablement insuffisant pour rendre compte du mode de vie de tous
les dinosaures. En effet, si on prend l’exemple des mammifères,
on s’aperçoit que la chauve-souris, le chat, l’éléphant et la
baleine contrôlent différemment la température de leur corps. Il
est donc probable que, chez les dinosaures, les mécanismes de
régulation thermique aient été tout aussi variés.
 Cette
reconstitution d'un nid de Cette
reconstitution d'un nid de
Maiasaura
se fonde sur un site
fossilifère découvert dans le Montana (États-Unis). On pense
que Maiasaura nichait en vastes colonies, chaque site de
ponte comptant jusqu'à une vingtaine d'œufs. Le nom de ces
dinosaures vient du grec maia, « mère » et saura,
« lézard ».
The Natural History Museum, London
Nombreux
étaient les dinosaures qui construisaient des nids et pondaient des
œufs, comme certains reptiles et tous les oiseaux actuels. Des
traces de nids avec des œufs et de petits dinosaures nouvellement
éclos ont été découvertes dans le Montana, aux États-Unis. L’existence
de différentes couches de nids superposées semble indiquer que les
dinosaures revenaient pondre au même endroit chaque année.
4.
CLASSIFICATION
4.1.
Ornithischiens
ou avipelviens
Le
groupe des ornithischiens s’est différencié au Jurassique et
surtout au Crétacé. Toutes les espèces gardèrent cependant une
taille médiocre, une posture bipède, un régime herbivore et une
denture complète.
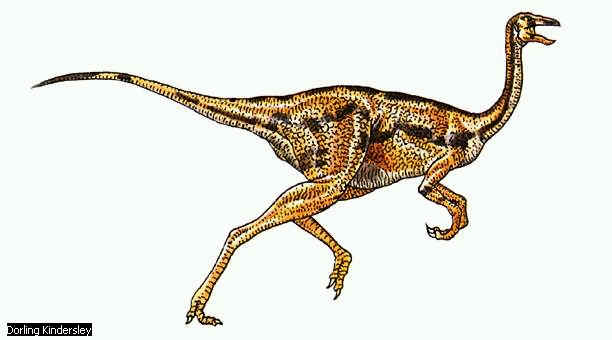
Avec son bec dépourvu de dents et son long cou
maigre, Ornithomimus avait l'allure d'une autruche. Il se
tenait sur ses pattes arrière et courait vite, en se servant de
sa queue comme balancier. Bien que sa tête fût de petite taille,
son cerveau devait être proportionnellement plus gros que celui
de la plupart des autres dinosaures.
Dorling Kindersley
La
famille des thyréophores comprenait les stégosaures et les
ankylosaures. Les stégosaures étaient caractérisés par un dos
bombé portant deux rangées d’épines ou de plaques osseuses
dressées qui se continuaient sur la queue, des membres antérieurs
courts et un crâne petit et étroit. Les ankylosaures avaient un
corps massif, enfermé dans une carapace osseuse.
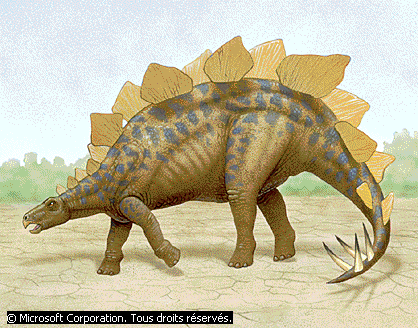
Dinosaure herbivore massif, le stégosaure se
caractérise par la présence, tout le long de son dos, de grandes
plaques de forme plus ou moins triangulaire et, à l'extrémité
de sa queue, de longues pointes effilées. Tandis que les
premières jouaient probablement un rôle dans la régulation de
sa température corporelle, les secondes devaient lui servir
d'armes contre ses prédateurs.
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Le
groupe des ornithopodes a vécu du début du Jurassique jusqu’au
Crétacé supérieur. En font partie les hadrosaures et leurs
cousins les iguanodons, grands bipèdes herbivores aux nombreuses
dents, ainsi que les cératopsiens à corne et leurs cousins les
pachycéphalosaures.
Outre
leur bassin d’oiseau, les dinosaures ornithischiens se
distinguaient par la présence d’un os prédentaire sur la
mâchoire inférieure. Les ornithischiens étant tous herbivores, l’os
prédentaire devait leur servir de « bec », pour
brouter à la manière des chevaux ou des chameaux. Les hadrosaures
et les cératopsiens possédaient des mâchoires munies de douzaines
de dents serrées formant une surface de mastication unie et
biseautée. Au cours de leur vie, les dinosaures, comme de nombreux
vertébrés, perdaient régulièrement leurs dents, qui étaient
remplacées au fur et à mesure que les racines étaient
résorbées.
4.2.
Saurischiens
ou sauripelviens
Les
saurischiens se divisent en deux groupes majeurs. D’une part, les
sauropodes herbivores, qui comprenaient les sauropodes géants à
long cou, comme le Diplodocus, l’apatosaure et les
prosauropodes, moins bien connus, dont le platéosaure. D’autre
part, les théropodes carnivores (ou carnosauriens), tels que les
petits Compsognathus et le Deynonichus et les géants
comme l’allosaure et le tyrannosaure.
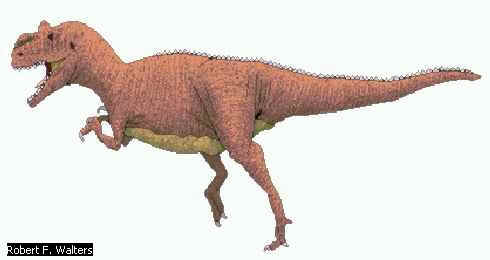
Accusant un poids de 6 à 8 t, Giganotosaurus
était un dinosaure carnivore bipède, dont les restes ont été
retrouvés en Amérique du Sud en 1995. Il était plus gros et
plus lourd que Tyrannosaurus rex, jusque-là considéré
comme le plus grand carnivore terrestre ayant jamais existé.
Robert F. Walters
La
taille des sauropodes, devenus quadrupèdes, augmenta
considérablement, leur permettant d’atteindre la hauteur des
végétaux dont ils se nourrissaient. Le Diplodocus, par
exemple, avait un long cou et une très longue queue, qu’il
utilisait comme un trépied : elle lui permettait de stabiliser
ses pattes arrière quand il dressait ses pattes antérieures en l’air
pour atteindre les plantes géantes dont il se nourrissait. En
revanche, le brachiosaure avait une petite queue sur laquelle il ne
pouvait pas s’appuyer, mais ses pattes antérieures étaient plus
longues que les postérieures, ce qui lui permettait, grâce à son
long cou, d’arracher la végétation haute.
Les
grands théropodes carnivores comme le tyrannosaure avaient une
grosse tête, de grandes mâchoires et une double rangée de dents
pointues recourbées vers l’arrière. Leurs pattes antérieures
étaient réduites, mais leurs hanches et leurs pattes arrière
massives, de sorte que ces prédateurs n’avaient qu’à se saisir
de leur proie avec leurs crocs et la déchiqueter sur place. En
revanche, les petits théropodes tels que le Deinonychus
étaient des chasseurs plus agiles, qui poursuivaient leur proie et
l’attaquaient en meute, avant de la déchiqueter à l’aide de
leurs griffes et de leurs crocs. Toutefois, certaines familles de
théropodes, comme les Struthiomimus, n’avaient pas de
dents, contrairement aux oiseaux primitifs tels l’archéoptéryx
et l’Hesperornis.
5.
EXTINCTION
Des
dizaines de théories ont été élaborées pour expliquer l’extinction
des dinosaures. Jusqu’à une époque récente, on considérait que
ces animaux avaient graduellement disparu pendant tout le Crétacé
supérieur. La découverte des traces d’un grand astéroïde ou d’une
comète qui serait entré en collision avec la Terre, il y a
65 millions d’années, entre le Crétacé et le Tertiaire,
raviva les spéculations sur leur disparition.
Selon certaines théories, cet impact aurait eu des
conséquences climatiques dramatiques qui auraient conduit à l’extinction
des dinosaures. Un tel événement, assez commun dans l’histoire
de la formation de la Terre, a certainement eu des répercussions
sur l’environnement mais, au moment où il s’est produit, la
majorité des dinosaures avaient déjà disparu. De plus, d’autres
organismes comme les crocodiles, les tortues, les poissons, les
oiseaux et les amphibiens, susceptibles d’être affectés par un
cataclysme de la même façon que les dinosaures, ont survécu au
prix de quelques pertes mineures.
Il est établi que, pendant le Crétacé supérieur,
le climat était devenu instable et saisonnier, provoquant l’extinction,
par vagues, de nombreuses espèces marines et terrestres. Les effets
de l’impact d’un objet extraterrestre ne sont pas négligeables,
mais ils n’expliquent pas que certaines espèces aient
complètement disparu à la fin du Crétacé, alors que d’autres
ont survécu. Ce dernier fait reste à expliquer, et ce dans l’hypothèse
de n’importe quelle catastrophe.
.
1.
PRÉSENTATION
Mésozoïque,
division des temps géologiques qui a commencé il y a environ
250 millions d’années et s’est achevé voici
65 millions d’années, appelée aussi ère secondaire. Le
Mésozoïque est précédé par le Paléozoïque et suivi par le
Cénozoïque. Il est divisé en trois périodes : le Trias, le
Jurassique et le Crétacé.
2.
DISLOCATION
DE LA PANGÉE
Durant
les dernières périodes de l’ère paléozoïque, les continents
avaient progressivement fusionné en une masse unique, la Pangée.
Mais à peine la nouvelle superstructure fut-elle en place que se
manifestèrent de fortes tensions qui l’amenèrent à se disloquer
à nouveau.
Il apparut, entre deux grands ensembles situés
respectivement au nord (la Laurasia) et au sud (le Gondwana), une
mer (la Téthys) qui occupa approximativement l’emplacement de la
Méditerranée actuelle.
D’autres dislocations suivirent cette grande
ouverture médiane. Le Gondwana se morcela et des blocs (l’Inde, l’Australie,
l’Antarctique) s’individualisèrent et commencèrent à s’écarter
de l’Afrique à laquelle ils étaient jusqu’alors soudés. L’océan
Indien était en cours de formation et le canal du Mozambique
apparut entre Madagascar et la côte orientale de l’Afrique.
À peu près au même moment, au Jurassique, s’ouvrit
une nouvelle fracture de l’écorce terrestre appelée à jouer un
rôle important puisqu’elle deviendra le rift médio-atlantique.
Cette fracture s’installa d’abord entre l’Afrique du
Nord-Ouest et l’Amérique du Nord, avant de s’élargir au
Crétacé pour former un véritable océan entre l’Afrique et l’Amérique
du Sud d’abord, entre l’Europe et l’Amérique du Nord ensuite.
Comme toujours durant les périodes de distension et
de fragmentation, l’activité magmatique se manifesta par l’épanchement
d’énormes quantités de laves basaltiques dans les zones de
fracture de l’écorce terrestre. Ainsi, en Sibérie, le
gigantesque plateau résultant de l’empilement de coulées de
lave, sur une épaisseur de 1 km et une superficie de
1 500 000 km2,
date du Trias. Au même moment, une activité semblable s’amorca
en Afrique du Sud ; elle se poursuivit au Jurassique. Au
Crétacé se mirent en place les énormes coulées de lave (les « trapps »)
du plateau du Dekkan, en Inde.
3.
OROGENÈSE
L’activité
orogénique du Mésozoïque fut en quelque sorte la phase
préliminaire du grand cycle orogénique alpin qui se développa
durant le Cénozoïque. On distingue deux grands ensembles
géographiques. Le premier englobe les deux Amériques, dont le
déplacement vers l’ouest est à l’origine des phases
orogéniques andine et névadienne qui virent la formation, en
Amérique du Sud, de la cordillère des Andes, et en Amérique du
Nord, de la Sierra Nevada. De nouvelles déformations affectèrent
ces régions à la fin du Mésozoïque pour donner naissance aux
montagnes Rocheuses (phase laramienne).
Le second ensemble est celui de la Téthys où se
produisirent, à la fin du Jurassique et au Crétacé, par rotation
de l’Afrique vers le nord-est, les premières grandes poussées
alpines, d’abord dans les Alpes centrales et orientales puis dans
le sud-est de la France.
Parallèlement à cette activité orogénique, le
Mésozoïque et plus particulièrement le Jurassique et le Crétacé
furent témoins d’une remontée extrêmement marquée du niveau
des mers. La mer progressa alors sur d’immenses plates-formes
littorales où s’accumulèrent de très importants dépôts
calcaires. Ce sont précisément les strates crayeuses très
épaisses accumulées durant cette transgression majeure, sur de
vastes territoires d’Europe et d’Amérique du Nord, qui ont
donné leur nom au Crétacé (à partir du latin creta, la
craie).
4.
FAUNE
ET FLORE
Après
les grandes extinctions du Permien, le début du Mésozoïque fut le
témoin d’un nouvel essor de la vie. Parmi les invertébrés, les
mollusques commencèrent à jouer un rôle prépondérant et
notamment, parmi les céphalopodes, les ammonites, à la coquille
enroulée, et les bélemnites, dont le rostre était l’équivalent
de l’os de la seiche actuelle. Les ammonites connurent un
développement remarquable au Jurassique et au Crétacé. Elles
constituent d’excellents fossiles car elles évoluaient
rapidement, étaient largement répandues et se conservaient bien.
Parmi les autres formes marines, ostracodes et foraminifères
abondaient dans les zones littorales très peu profondes, de même
que les brachiopodes, les échinodermes et les coraux.
Les
premiers mammifères apparurent au Mésozoïque. Il s’agissait d’animaux
dérivant de reptiles et dont la taille ne dépassait pas celle de
la musaraigne. C’est aussi au Mésozoïque que se manifestent les
premiers oiseaux connus, les archéoptéryx, très primitifs puisqu’ils
présentent encore des caractères reptiliens comme les écailles,
les griffes et les dents, mais déjà pourvus de plumes (un
caractère spécifique aux oiseaux). Durant le Jurassique, les
véritables maîtres des airs restèrent néanmoins les reptiles
volants, les ptérosauriens.
Cependant, l’événement paléontologique le plus
spectaculaire du Mésozoïque demeure la diversification étonnante
des reptiles. Au point que l’on a donné au secondaire la
dénomination d’« ère des reptiles ». Ces animaux
colonisèrent tous les milieux (marin, lacustre, terrestre, aérien)
et certains, les dinosaures, atteignirent des tailles gigantesques.
Les premiers dinosaures apparurent au début du Trias : ils
ressemblaient à de gros lézards de 30 à 40 centimètres de
longueur. Cent cinquante millions d’années plus tard, à la fin
du Mésozoïque, certaines espèces gigantesques atteignaient
30 mètres de longueur pour une hauteur de 10 mètres,
dimensions qui en font les plus grands animaux que la Terre ait
jamais portés.
Si la flore du Trias puis du Jurassique resta
dominée par les fougères, les prêles et les conifères, les
angiospermes (les plantes à fleurs) firent leur apparition et
bientôt prospèrent pour constituer près de 90 p. 100 de
la flore du Crétacé moyen.
5.
CRISE
BIOLOGIQUE
La fin
du Crétacé, et donc la fin du Mésozoïque, est marquée par une
crise biologique majeure qui vit la disparition de près de
75 p. 100 des espèces animales, et tout particulièrement
l’extinction totale et définitive des ammonites dans les mers et
des dinosaures sur les continents.
Si l’on a avancé de multiples hypothèses pour
expliquer cette crise majeure (variations climatiques, volcanisme,
inversion magnétique, etc.), il en est une qui est l’objet d’âpres
discussions depuis son élaboration en 1980. À cette date furent
découvertes, en plusieurs points du globe, de très fortes
concentrations en iridium dans les couches sédimentaires
correspondant à la limite Crétacé-Tertiaire. Les concentrations
de ce métal habituellement très rare sur la Terre étaient les
mêmes que celles qui caractérisent les météorites. Selon le
scénario élaboré à la suite de cette découverte, la Terre
aurait été percutée par une météorite de grande taille
(10 km de diamètre ?). L’impact aurait élevé un
énorme nuage de poussière, lui-même responsable de l’obscurcissement
de l’atmosphère. Et de proche en proche, par manque de lumière,
réduction de la photosynthèse et rupture des chaînes
alimentaires, nombre d’espèces animales auraient été rayées de
la surface du globe. Cette hypothèse semble avoir trouvé une
confirmation en 1997 à la suite de forages réalisés au large de
la Floride, non loin du cratère découvert en 1991 dans le
Yucatán, d’une météorite qui aurait percuté la Terre il y a
65 millions d’années (voir Extinction).
Quelle que soit la bonne hypothèse, l’extinction
de certains groupes d’animaux a eu comme contrepartie la
diversification d’autres groupes dont les représentants étaient
désormais libres de coloniser les niches écologiques abandonnées
par leurs occupants antérieurs. L’exemple-type est celui des
mammifères qui prirent le relais des grands reptiles dès le début
du Cénozoïque (ère tertiaire).
.
Cet article est extrait de l'Actualisation Encarta
de février 1997.
De
nouveaux arguments pour l'hypothèse de l'extinction des dinosaures
par impact de météorite
Les géologues du programme international de forage
en mer (Ocean Drilling Program, ODP), financé par les
organismes publics de recherche de vingt États, ont annoncé le
10 février la découverte de preuves supplémentaires
confirmant qu'une météorite a percuté la Terre il y a
65 millions d'années, avec un impact très important. Cette
météorite, probablement un astéroïde ou une petite comète de 10
à 20 km de diamètre, s'est écrasée au bord de la péninsule
du Yucatán, au Mexique. Cet impact a eu des effets cataclysmiques
sur l'environnement. Il a entraîné ou contribué à l'extinction
de plus de la moitié des espèces vivant à l'époque sur Terre,
dont les dinosaures.
Au début des années quatre-vingt, des géologues
ont émis l'hypothèse que la quantité importante d'iridium
présent dans les roches vieilles de 65 millions d'années
pouvait être due à l'impact d'une énorme météorite ayant
percuté la Terre à cette époque. Le site de l'impact, repéré en
1991 et appelé cratère de Chicxulub, du nom du village qui s'y est
implanté, a donné lieu depuis à des recherches approfondies.
Ce cratère est dissimulé sous des roches et
immergé dans sa partie nord. L'impact est marqué par trois ou
quatre cercles concentriques de roches de densités alternativement
faibles et fortes, chaque cercle ayant ses spécificités
magnétiques. Le diamètre total du cratère est encore
controversé. Une équipe de géologues l'estime à 180 km,
tandis qu'une autre dit avoir découvert les traces d'un quatrième
anneau extérieur de 300 km de diamètre.
Les géologues avaient déjà repéré en de
nombreux endroits des stratigraphies rocheuses portant des traces de
cet événement. Ces couches rocheuses contiennent des restes
fossilisés d'organismes ayant vécu avant et après l'événement,
ainsi que des débris projetés par l'impact. Les scientifiques
avaient également récupéré de nombreux extraits de sédiments
océaniques, dont beaucoup proviennent d'une région du golfe du
Mexique proche du site de Chicxulub. Cependant, le programme de
forage océanique ODP, a permis de faire des carotages plus précis
et plus complets au large de la côte de la Floride.
L'équipe de l'ODP, embarquée à bord de JOIDES
Resolution, a prélevé des sédiments sur le rebord d'un
plateau sous-marin situé dans l'océan Atlantique à environ
500 km à l'est de Jacksonville, en Floride. Elle a annoncé
que trois extractions sédimentaires, pratiquées en janvier et
février, présentaient une preuve claire de l'impact de la
météorite. Les carotages comportaient successivement : une
couche contenant des fossiles d'espèces marines ayant vécu avant
l'impact, une couche de gaz et de poussière projetée par la
météorite, une couche contenant des traces de la météorite
elle-même, celle-ci ayant été vaporisée par l'impact avant de
retomber sous forme de pluie, une couche où les traces de vie
marine sont très rares, puis une couche dont les fossiles indiquent
une prolifération des espèces ayant survécu ainsi que
l'apparition de nouvelles espèces.
Le cratère de Chicxulub est l'un des sites d'impact
de météorite les plus grands du monde. Les deux autre sites de
taille similaire connus, le cratère de Sudbury au Canada et le site
de Vredefort en Afrique du Sud, ont environ 2 milliards
d'années. Ces cratères ont été déformés et modifiés par le
processus géologique. Le cratère de Chicxulub, beaucoup plus jeune
et donc mieux conservé, représente également le lien le plus
évident entre impact de météorite et extinction massive des
espèces.
Source : Actualisation Encarta, février 1997.
.
1.
PRÉSENTATION
extinction
(biologie),
en biologie, disparition de populations ou d’espèces
interfécondes, ou encore de groupes taxinomiques supérieurs, tels
que les familles (voir Classification des espèces). Les
extinctions massives d’espèces ont été identifiées au début
du XIXe siècle,
grâce à l’étude de fossiles. Elles apparaissent sous forme de
successions de faunes et de flores nettement différentes les unes
des autres au cours de l’histoire de la Terre.
2.
CRISES
BIOLOGIQUES
Une
extinction, ou « crise biologique », répond à des
critères précis. Elle doit correspondre à la disparition
simultanée, sur l’ensemble du globe, d’un nombre d’espèces
anormalement élevé, appartenant à des groupes très divers et
dépourvus de lien écologique, dont les « rescapés »
ont subi une modification dans la diversité de leurs espèces.
Les
temps fossilifères (remontant à 550 millions d’années) ont
connu cinq grandes extinctions. Deux sont survenues au cours de l’ère
primaire : à la fin de l’Ordovicien (430 millions d’années),
puis à la fin du Frasnien (365 millions d’années),
entraînant chacune la disparition de près de 70 p. 100
des espèces. La troisième, qui date du Permien (250 millions
d’années), signe le passage de l’ère primaire à l’ère
secondaire. Quelque 90 p. 100 des espèces ont alors
disparu. Survenue au Jurassique (140 millions d’années), la
quatrième crise a été bien moins catastrophique. Enfin, la
cinquième, dite du Crétacé / Tertiaire (passage du
Secondaire au Tertiaire), a entraîné la disparition des grands
animaux comme les dinosaures, ainsi que de nombreux invertébrés
marins.
3.
CAUSE
DES EXTINCTIONS
Deux
courants d’idées s’opposent pour tenter d’expliquer les
phénomènes d’extinction : d’un côté, les partisans d’une
catastrophe ; de l’autre, ceux d’une extinction
progressive. Ces derniers s’appuient sur les régressions des
mers, qui ont coïncidé avec toutes les crises biologiques. Ils
supposent que le recul des mers a bouleversé l’équilibre
écologique des plateaux continentaux où vivaient la plupart des
espèces marines et modifié les climats sur les continents (voir
Océan ; Continent). Mais la durée de ces phénomènes
contredit la soudaineté apparente des extinctions en masse.
 Oiseau
de la famille du pigeon, le Oiseau
de la famille du pigeon, le
dodo,
ou dronte, peupla l'île Maurice jusqu'en 1681, date d'observation
du dernier spécimen vivant. L'arrivée de colons européens sur
l'île se traduisit par une chasse intensive et par l'introduction
d'animaux domestiques, qui concurrencèrent le dodo pour la
nourriture et l'habitat.
Tom McHugh/Field Museum, Chicago/Photo Researchers,
Inc.
C’est
pourquoi l’hypothèse de la catastrophe semble aujourd’hui la
plus probable. Il pourrait s’agir de la chute d’une gigantesque
météorite ou de l’éruption d’un énorme volcan. La
découverte de l’iridium sédimentaire, en 1980, a cependant fait
pencher la balance en faveur d’une origine extra-terrestre.
Classé avec le platine parmi les « platinoïdes », l’iridium
est en effet extrêmement rare sur Terre. Or, sa présence en
quantités anormalement élevées dans les sédiments contemporains
de la dernière crise pourrait signer la chute d’une météorite
sur la Terre, avec, pour conséquences, des pluies acides et un
obscurcissement de l’atmosphère. Cette collision aurait laissé
des traces sous la forme d’un cratère de 200 km de
diamètre, au sud-est du Mexique, et des forages réalisés en 1997
dans l’océan Atlantique à proximité de ce cratère ont
révélé une séquence sédimentaire compatible avec cette
théorie : à une couche riche en fossiles marins antérieurs
à l’impact de la météorite a succédé une couche de
poussières et de gaz contemporaine de l’impact, puis une couche
contenant des fragments de la météorite elle même, une couche
dans laquelle la vie marine est peu représentée, une couche
traduisant une prolifération des espèces survivantes et enfin l’apparition
de nouvelles espèces. Toutefois, cette théorie n’explique pas
pourquoi les dinosaures ont disparu, alors que d’autres animaux
ont survécu à cette catastrophe. La diversité des insectes, par
exemple, n’a subi aucune modification.
4.
ESPÈCES
AUJOURD’HUI MENACÉES
Au
cours de la période moderne, des espèces ont continué, et
continuent encore de s’éteindre, notamment sur les îles
océaniques. Près des deux tiers des oiseaux et un dixième des
plantes originaires des îles Hawaii ont ainsi définitivement
disparu. Le dodo de l’île Maurice est un exemple célèbre de
disparition observée par l’Homme « en temps réel ».
De nombreuses autres espèces sont en voie d’extinction. Parmi les
principales causes de ces extinctions récentes ou actuelles, on
compte les prédateurs, les compétiteurs et les maladies introduits
par l’Homme, qui viennent s’ajouter à l’action directe de l’Homme
sur son environnement.
Moins
fréquente, et directement liée à l’intervention humaine
(chasse, piégeage immodéré, déforestation, pollution), l’extinction
des espèces des aires continentales n’en est pas moins réelle et
préoccupante. La fragmentation et la disparition des habitats
peuvent réduire les populations à un degré tel qu’il suffit d’un
accident comme le mauvais temps pour provoquer leur extinction. Les
espèces rares ont certes plus de risques de disparaître que les
autres, mais l’extrême abondance d’une espèce n’est pas une
garantie contre l’extinction. Le pigeon migrateur, par exemple,
qui se reproduisait en colonies de plusieurs millions d’individus
dans les forêts de feuillus de l’Amérique du Nord au début des
années 1800, a été victime de la chasse, d’un piégeage
intensif et de la déforestation. Il a totalement disparu en moins d’un
siècle.
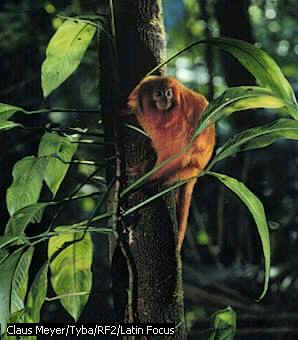 Ce
sont les régions tropicales, celles où la diversité des espèces
est la plus grande, qui connaissent le plus de destructions d’habitats.
Tous les jours, des espèces végétales et animales
(particulièrement des insectes) non encore identifiées y
disparaissent. D’autres s’éteignent tout juste après qu’on
les a découvertes. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant
qu’il est probable qu’un certain nombre de ces espèces
renferment des substances utilisables en médecine (comme la
pénicilline, extraite de certains champignons). Ce
sont les régions tropicales, celles où la diversité des espèces
est la plus grande, qui connaissent le plus de destructions d’habitats.
Tous les jours, des espèces végétales et animales
(particulièrement des insectes) non encore identifiées y
disparaissent. D’autres s’éteignent tout juste après qu’on
les a découvertes. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant
qu’il est probable qu’un certain nombre de ces espèces
renferment des substances utilisables en médecine (comme la
pénicilline, extraite de certains champignons).
Petit singe d'Amérique du Sud à la magnifique et
abondante fourrure cuivrée, le
tamarin lion
(Leontopithecus
rosalia) est actuellement l'un des primates les plus menacés
au monde. De tempérament doux, il a été victime de captures
inconsidérées à des fins d'exportation pour le marché des
animaux de compagnie. Les quelques spécimens que l'on rencontre
encore à l'état sauvage sont pour la plupart cantonnés à la
réserve de Poço das Antas, à Rio de Janeiro.
Claus Meyer/Tyba/RF2/Latin Focus
La
liste des espèces menacées s’allonge rapidement dans la plupart
des régions du monde, proportionnellement avec l’accroissement de
la population humaine, ce qui constitue une grave menace pour la
biodiversité.
5.
NIVEAU
DE BIODIVERSITÉ ACTUEL
Il est
impossible de connaître le nombre total d'espèces présentes sur
Terre. Pour l'instant, 1 700 000 espèces animales
ont été dénombrées et décrites, contre quelques centaines de
milliers d'espèces végétales. En se fondant sur le nombre
d'espèces nouvelles découvertes chaque année dans les forêts
tropicales, on a pu réaliser des estimations : le nombre total
d'espèces varierait de 5 à 100 millions ! Le chiffre
moyen de 12,5 millions, qui semble « raisonnable »,
a été suggéré.
Ainsi,
la majorité des espèces qui vivent sur notre planète nous sont
inconnues. Le groupe le mieux répertorié est sans aucun doute
celui des vertébrés, et plus particulièrement, dans celui-ci, les
mammifères, dont l'Homme fait partie. Tous groupes confondus, on
répertorie chaque année un grand nombre de nouvelles
espèces : ainsi, ces dernières décennies, on a décrit
quelque 200 poissons, 20 mammifères et 5 oiseaux. La
découverte la plus étonnante est sans doute celle de trois
nouvelles espèces de mammifères dans le nord du Viêt Nam.
Cependant, beaucoup d'espèces « nouvelles »
résultent d'une amélioration de la classification, qui sépare en
deux ou trois certains groupes que l'on croyait uniques.
En revanche, pour les insectes, qui comportent un
nombre gigantesque de représentants, plusieurs milliers de nouveaux
spécimens sont décrits chaque année. En fait, le nombre des
espèces enregistrées ne semble limité que par la rapidité des
taxinomistes à étudier les nouveaux individus !
6.
PERSPECTIVES
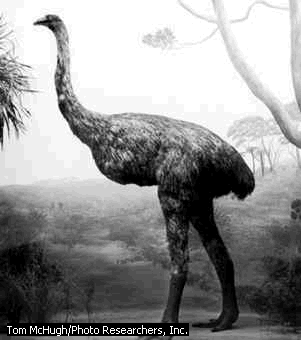 L'Homme
a contribué, et contribue toujours, à une importante réduction de
la biodiversité. La diminution des populations animales et
végétales, l'extinction ou la raréfaction de certaines espèces
et la simplification des écosystèmes en sont des preuves
évidentes. La régression de la biodiversité peut être évaluée
de deux manières : soit par l'observation, soit par des
prédictions, fondées sur les connaissances actuelles. L'Homme
a contribué, et contribue toujours, à une importante réduction de
la biodiversité. La diminution des populations animales et
végétales, l'extinction ou la raréfaction de certaines espèces
et la simplification des écosystèmes en sont des preuves
évidentes. La régression de la biodiversité peut être évaluée
de deux manières : soit par l'observation, soit par des
prédictions, fondées sur les connaissances actuelles.
Les trois quarts des extinctions d'espèces
animales survenues depuis le début du XVII e siècle
à cause des activités humaines se sont produites sur des îles.
Ainsi, le dinornis
géant de
Nouvelle-Zélande, chassé par le peuple moa depuis l'an
800 apr. J.-C., a totalement disparu, probablement dès
la fin du XVIIe siècle.
Tom McHugh/Photo Researchers, Inc.
Les
analyses effectuées sur des restes d'animaux (os et coquilles
principalement) et l'étude des documents historiques ont montré
qu'environ 600 espèces s'étaient éteintes depuis le début
du XVIIe siècle
(voir Extinction). Malheureusement, ce chiffre est forcément
sous-évalué, car de nombreuses espèces inconnues ont dû
disparaître en même temps. Environ les trois quarts de ces
extinctions se sont produites sur des îles, après colonisation par
l'Homme. La surexploitation, la chasse, la destruction de l'habitat
et l'introduction de nouvelles espèces sont à l'origine des
disparitions. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, un grand oiseau coureur,
le dinornis, a été victime d'une chasse intensive. Il a disparu
vers la fin du XVIIe siècle,
alors qu'il existait depuis la fin du Tertiaire.
C'est entre le début du XIXe siècle
et le milieu du XXe siècle
qu'ont été enregistrées le plus d'extinctions. Depuis, la
tendance s'est, semble-t-il, ralentie. Cette légère amélioration
pourrait résulter des efforts de conservation entrepris ces
dernières décennies, ou n'être que le reflet du délai qui
s'écoule entre le moment où l'on observe pour la dernière fois
une espèce et celui où on la considère comme définitivement
éteinte. Quelques espèces que l'on croyait disparues sont ainsi
réapparues.
Quelque 6 000 espèces animales sont
actuellement menacées d'extinction. Ce n'est qu'une estimation,
étant donné que la plupart des espèces actuelles n'ont pas
réellement fait l'objet d'une évaluation de leur population. En
effet, la plus grande partie des 9 700 espèces d'oiseaux
ont été recensées, mais seulement la moitié des
4 630 mammifères. Une partie infime des
250 000 espèces de plantes ont fait l'objet d'études,
et, si l'on fait exception des papillons, des libellules et des
mollusques, aucune des espèces d'invertébrés n'a été, ni ne
sera évaluée en termes de nombre d'individus.
On estime cependant qu'un habitat dont la superficie
globale se réduit de 10 p. 100 perd environ la moitié
des espèces qu'il comptait à l'origine. Ce rapport
espèces-superficie permet d'anticiper le taux d'extinction d'une
espèce. C'est pourquoi les conséquences de la déforestation et de
la modification de la forêt tropicale, où vivent la plupart des
espèces, suscitent de réelles inquiétudes.
De nombreuses personnes, organisations et nations se
sont efforcées, durant ces dernières décennies, d'identifier les
populations animales et végétales, les espèces et les habitats
menacés d'extinction ou de dégradation, et ont tenté d'inverser
la tendance. Les solutions consistent à protéger les milieux
naturels, voire à les reconstituer s'ils ont été détruits, et à
les repeupler en réintroduisant les espèces en voie de
disparition. Ces actions prennent en général énormément de
temps. C'est en particulier le cas pour les animaux sauvages, comme
les ours ou les loups, les mouvements de sauvegarde se heurtant
souvent à l'hostilité des habitants. Cependant, ils aboutissent
quelquefois. Ainsi, dans les Pyrénées, la réintroduction de
l'ours brun a récemment été entreprise : au printemps 1996,
deux femelles, capturées en Slovénie, ont été lâchées dans la
forêt pyrénéenne.
Le but commun de tous ces efforts est de gérer plus
efficacement les ressources naturelles de notre planète, de limiter
les dégâts causés par les activités de l'Homme, tout en
soutenant le développement des peuples les plus défavorisés. Une
convention sur la biodiversité a été signée à cet effet en juin
1992, lors de la conférence de Rio de Janeiro des Nations unies sur
l'environnement et le développement. Cette convention est
appliquée depuis fin 1993. Au début de 1995, on comptait plus de
cent nations signataires.
Les objectifs généraux de cette convention
consistent à préserver la diversité biologique, à en faire usage
de façon durable et à partager équitablement les fruits de la
recherche génétique (en matière de culture et de biotechnologie).
La tâche est lourde, mais la convention constitue le seul cadre
général permettant de planifier et d'entreprendre les mesures
nécessaires pour l'environnement. La convention spécifie que les
nations sont responsables de la biodiversité sur leurs territoires.
Mais le problème devant être considéré au niveau mondial, la
communauté internationale devra apporter son soutien aux pays en
voie de développement.
.
.
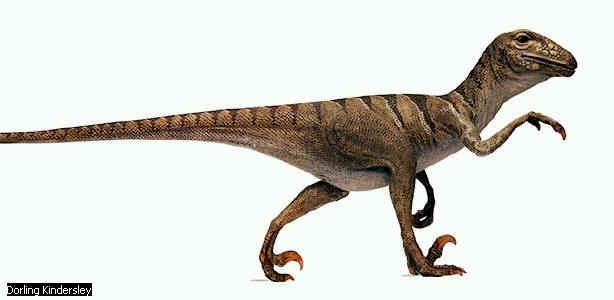
deinonychus,
petit dinosaure carnivore, qui vécut au début du Crétacé (de - 115
à - 100 millions d’années). Le Deinonychus était
un coureur rapide, aux membres postérieurs puissants, avec une
queue lui servant de balancier. À l’âge adulte, il mesurait
1,5 m de hauteur, 2,75 m de longueur, et pesait quelque
80 kg. Féroce prédateur, il possédait des mâchoires
équipées de dents pointues et acérées. Les trois doigts de ses
pattes antérieures étaient pourvus de longues griffes
incurvées. Sur le second doigt de ses pattes postérieures, le Deinonychus,
dont le nom vient du grec deino, « terrible »,
et onukhôs, « ongle », portait une griffe
rétractable longue de 13 cm. Il chassait probablement en
groupe.
Ce
dinosaure est connu par des fossiles découverts dans le Montana,
aux États-Unis. Il est assez proche du Velociraptor trouvé en
Asie.
Classification :
le Deinonychus fait partie des Saurischiens, dinosaures à
bassin de reptile, par opposition aux ornithischiens (à bassin d’oiseau).
Il appartient au sous-ordre des Théropodes, ou Carnosauriens.

C'est en Asie qu'ont été retrouvés tous les
fossiles, parfois très complets, de Velociraptor
(du latin velocis, « rapide » et raptus,
« enlèvement »), dinosaure carnivore du
Crétacé. Comme son nom l'indique, c'était probablement un
chasseur rapide qui devait s'attaquer aux couvées de dinosaures
ou, en groupe, à des proies de grande taille.
John Eastcott-YVA Momatiuk/Photo Researchers,
Inc.
.
.
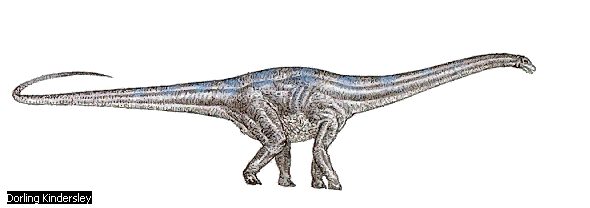
Pouvant atteindre quelque 32 m de long, le diplodocus,
paisible herbivore, comptait parmi les plus grands dinosaures.
Sa longue queue était flexible ; elle lui permettait sans
doute de repousser ses prédateurs.
Dorling Kindersley
.
.

ptérosauriens
(du grec, ptero, « aile » ; sauros,
« lézard »), genre de reptile volant du
Mésozoïque, qui vécut entre 230 millions et
65 millions d'années environ avant notre ère. Les fossiles
de ces animaux, appelés communément ptérodactyles, ont été
retrouvés dans tous les continents à l'exception de
l'Antarctique ; plus de 60 espèces différentes ont
été découvertes. Les ptérosauriens n'avaient pas de plumes.
Chacune de leurs ailes était formée d'une fine membrane (de
peau) semblable à celle de la chauve-souris. Elle était fixée
le long du tronc, sur le flanc, du genou à la patte antérieure,
puis était soutenue par le quatrième doigt, d'une très grande
longueur. Leurs os étaient creux et présentaient une ouverture
à chaque extrémité. Contrairement aux autres reptiles, les
ptérosauriens avaient le sternum bien développé servant de
point d'insertion aux muscles du vol, et le cerveau plus
développé que chez la plupart des reptiles.
Au Trias supérieur vivait Rhamphorhynchus,
aux longues ailes à l'aspect tanné. Ce représentant des
premiers ptérosaures était un puissant voilier, adapté à la
prise de poissons grâce à une dentition fine et acérée.
Giuliano Fornari/Dorling Kindersley
Les
premiers ptérosauriens du Trias supérieur (entre
230 millions et 208 millions d'années) possédaient un
crâne de 9 cm de long, un corps de près de 10 cm et
une queue souple d'environ 38 cm, terminée en forme de
diamant qui leur servait de gouvernail pour contrôler leur vol.
Les ptérosauriens du Crétacé supérieur (entre 97 millions
et 65 millions d'années) avaient une envergure de plus de
6 m, le crâne allongé et étroit et des mâchoires
dépourvues de dents. Bien que les ptérosauriens, sous leurs
formes évoluées, aient été bien adaptés au vol, ils ne sont
pas plus les ancêtres des oiseaux que les autres reptiles. Ces
animaux étaient carnivores.
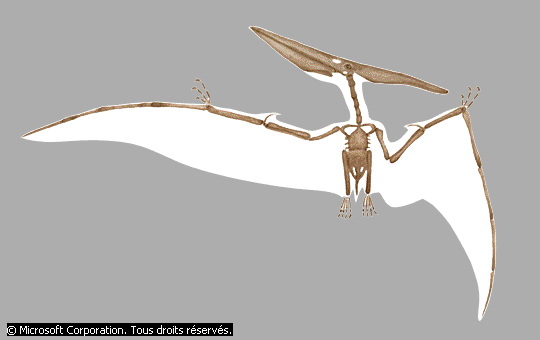 Pteranodon
Pteranodon
Au
début de 1975, les chercheurs ont annoncé la découverte de
fragments de squelettes de trois ptérosauriens géants, à long
cou, dans des roches du Crétacé supérieur, au parc national de
Big Bend, au Texas. Ces animaux, d'une  envergure
de 11 à 12 m environ, sont à ce jour les plus grands
animaux volants qui aient jamais existé.
Classification :
les ptérosauriens forment l'ordre des Ptérosaures. L'espèce la
plus connue de ptérosauriens du Trias supérieur est le Rhamphorhynchus.
L'espèce la plus connue des ptérosauriens du Crétacé
supérieur est le Pteranodon. envergure
de 11 à 12 m environ, sont à ce jour les plus grands
animaux volants qui aient jamais existé.
Classification :
les ptérosauriens forment l'ordre des Ptérosaures. L'espèce la
plus connue de ptérosauriens du Trias supérieur est le Rhamphorhynchus.
L'espèce la plus connue des ptérosauriens du Crétacé
supérieur est le Pteranodon.
.

 ichtyosaures
ou ichtyosauriens,
reptiles marins qui vécurent du début du Trias (il y a
240 millions d'années) jusqu'au Crétacé, qui se termina il
y a 65 millions d'années. Les ichtyosauriens forment un
ordre comprenant plusieurs espèces qui mesuraient entre 1 m
et 15 m de long. ichtyosaures
ou ichtyosauriens,
reptiles marins qui vécurent du début du Trias (il y a
240 millions d'années) jusqu'au Crétacé, qui se termina il
y a 65 millions d'années. Les ichtyosauriens forment un
ordre comprenant plusieurs espèces qui mesuraient entre 1 m
et 15 m de long.
Ces
animaux ressemblaient aux dauphins, avec leur long museau pointu
en forme de bec denté et leur corps aérodynamique. Ils avaient
des dents coniques et de grands yeux. Ils se propulsaient dans
l'eau en maintenant leur queue à la verticale et usaient de leurs
nageoires, dont les os étaient plus ou moins fusionnés. On pense
qu'ils étaient vivipares, ce qui leur permettait de ne pas avoir
à sortir de l'eau. D'autres reptiles de cette époque, y compris
les dinosaures, pondaient leurs œufs sur terre. Le régime
alimentaire des ichtyosaures était probablement entièrement
constitué de poissons.
.
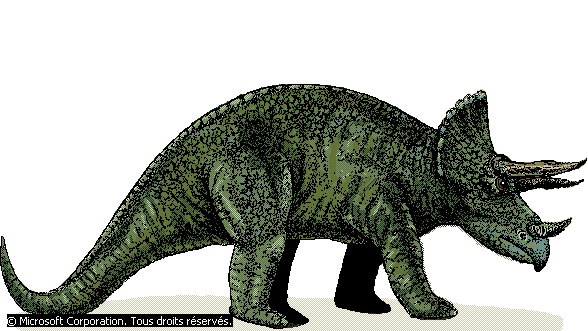
 Dinosaures
herbivores, les Dinosaures
herbivores, les
tricératops
ont vécu pendant une courte période, située entre 72 et 65 millions
d'années. On pense que ces animaux se rassemblaient en
troupeaux pour brouter l'herbe des prairies du Crétacé.
.
.
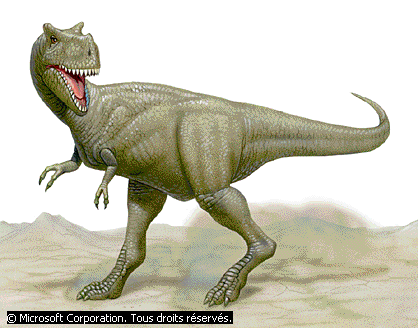
 tyrannosaure
(du grec turannos, « tyran » et sauros,
« lézard »), grand dinosaure bipède et carnivore
qui vécut pendant le Crétacé supérieur, plus de
65 millions d'années avant notre ère. Cet animal mesurant
près de 14 m de long, 5 m de haut et pesant plus de
4 tonnes est le plus grand carnivore ayant jamais vécu. Il
était bien armé pour s'attaquer aux grands dinosaures herbivores
de l'époque. Son crâne allongé, de plus de 1 m de long,
était pourvu de puissantes mâchoires munies de crocs en dents de
scie dont certains mesuraient 15 cm. Ses pattes antérieures
paraissaient minuscules par rapport au reste de son corps massif,
mais elles étaient pourvues de deux griffes bien aiguisées.
Quant à ses robustes pattes postérieures, elles se terminaient
par trois griffes saillantes et une quatrième griffe retournée
vers l'intérieur. Des fossiles trouvés en Amérique du Nord et
en Mongolie dans les strates du Crétacé supérieur indiquent que
ces espèces de dinosaures sont apparues et ont disparu en
l'espace, relativement court, de quelques millions d'années.
Parmi elles, une seule espèce est connue, celle du Tyrannosaurus
rex. tyrannosaure
(du grec turannos, « tyran » et sauros,
« lézard »), grand dinosaure bipède et carnivore
qui vécut pendant le Crétacé supérieur, plus de
65 millions d'années avant notre ère. Cet animal mesurant
près de 14 m de long, 5 m de haut et pesant plus de
4 tonnes est le plus grand carnivore ayant jamais vécu. Il
était bien armé pour s'attaquer aux grands dinosaures herbivores
de l'époque. Son crâne allongé, de plus de 1 m de long,
était pourvu de puissantes mâchoires munies de crocs en dents de
scie dont certains mesuraient 15 cm. Ses pattes antérieures
paraissaient minuscules par rapport au reste de son corps massif,
mais elles étaient pourvues de deux griffes bien aiguisées.
Quant à ses robustes pattes postérieures, elles se terminaient
par trois griffes saillantes et une quatrième griffe retournée
vers l'intérieur. Des fossiles trouvés en Amérique du Nord et
en Mongolie dans les strates du Crétacé supérieur indiquent que
ces espèces de dinosaures sont apparues et ont disparu en
l'espace, relativement court, de quelques millions d'années.
Parmi elles, une seule espèce est connue, celle du Tyrannosaurus
rex.

Le crâne du squelette de tyrannosaure le plus
complet jamais découvert a été exposé, avant la vente aux
enchères du fossile complet par Sotheby's, le 4 octobre
1997 à New York. Le squelette, surnommé « Sue »,
du nom de la paléontologue qui l'a découvert en 1990 dans le
Dakota du Sud, a été acheté par le Field Museum de Chicago
pour un montant de 8,4 millions de dollars.
Jeff Christensen/REUTERS
Classification :
le tyrannosaure est un dinosaure saurischien (au bassin de
lézard) du sous-ordre des Théropodes.
|
|