
aptéryx
ou kiwi, nom courant donné à trois espèces d'oiseaux
coureurs, qui n'habitent que la Nouvelle-Zélande et les petites îles
avoisinantes. Après avoir été décimés au XIXe siècle
à cause du commerce de leurs plumes et de l'introduction de
mammifères prédateurs, ces oiseaux sont aujourd'hui extrêmement
protégés.
La
femelle du grand aptéryx et de l'aptéryx tacheté, mesure environ
50 cm. Les aptéryx mâles sont plus petits que les femelles. Le
bec allongé des aptéryx porte les narines près de l'extrémité, ce
qui est unique chez les oiseaux. Le corps est robuste et les pattes
courtes mais puissantes, avec trois doigts avant dotés de solides
griffes. Les aptéryx sont des oiseaux nocturnes. Leurs yeux sont
petits et leur vision faible. Ils cherchent leur nourriture (vers et
autres petits invertébrés, graines et baies) au sol en utilisant
leur odorat, une caractéristique inhabituelle chez les oiseaux. Les
aptéryx n'ont pas de queue et leurs ailes rudimentaires sont cachées
sous leur épais plumage.
Les
œufs des aptéryx sont, proportionnellement à la taille de la
femelle, plus gros que ceux de tout autre oiseau — ils
correspondent à environ un quart de la masse du corps. La couvée
peut comprendre deux œufs, mais, dans ce cas, une période d'environ
un mois doit s'écouler entre la ponte du premier œuf et celle du
second pour qu'il ait suffisamment de place pour se développer.
L'incubation, généralement assurée par le mâle, dure entre 71 et
84 jours.
Classification :
les aptéryx forment la famille des Aptérygidés. Le grand aptéryx a
pour nom d'espèce Apteryx australis et l'aptéryx tacheté A. haastii.
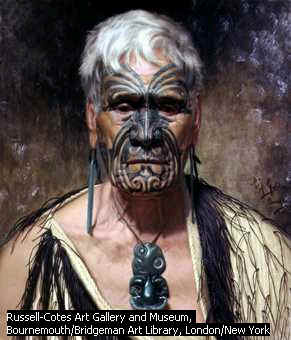
Portrait d'un chef maori
(1907), Charles Frederick Goldie.
Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemouth/Bridgeman
Art Library, London/New York
Maoris (peuple) ,
peuple indigène de Nouvelle-Zélande, d'origine polynésienne.
Ce
sont des découvertes archéologiques qui ont permis de dater
l'arrivée de la première vague de Maoris en Nouvelle-Zélande ;
venus des îles Cook ou des îles de la Société, ils
débarquèrent vers 800 apr. J.-C. Le peuple maori
présente de nombreuses caractéristiques communes à tous les
Polynésiens : une hiérarchie sociale composée de trois
groupes (tribu, sous-tribu et famille) et de trois classes (chef,
peuple et esclaves), ainsi que des concepts comme le tapu (« tabou »
ou « sacré »), mana (« prestige »
ou « honneur », pour un groupe social ou un individu),
mauri (« force de vie »), utu (« revanche »)
et makutu (« sorcellerie »).
Les
activités communautaires comprennent la cueillette, l'agriculture
et la guerre. Les guerres entre les groupes sociaux, grands ou
petits, accroissent ou diminuent le mana. Certains individus
se spécialisent dans les arts : poésie orale, tatouage et
sculpture du bois, des os et de la pierre. Les édifices publics
sont, encore aujourd'hui, richement décorés de sculptures de bois,
et les ornements personnels des Maoris atteignent souvent une très
grande sophistication.

Les portes des maisons maories étaient souvent
surmontées d'un linteau sculpté ; celui-ci provient de la
demeure d'un chef.
Museum of Mankind, London/Bridgeman Art Library,
London/New York
Les
Maoris entrèrent en contact avec des Européens pour la première
fois avec l'arrivée d'Abel Tasman en 1642 ; quatre des
membres de l'équipage de ce dernier furent tués lors d'un
affrontement sanglant. En 1796, James Cook parvint pourtant à
établir des relations plus pacifiques avec certains Maoris et, en
1800, les bateaux étaient tolérés sur les côtes de leur
territoire. Les Maoris apprirent rapidement à lire et à écrire la
langue des hommes blancs. Malheureusement, ils s'intéressèrent
aussi aux mousquets, dont ils expérimentèrent le pouvoir meurtrier
lors des guerres tribales.
C'est
en 1840 que le traité de Waitangi fut signé entre la Couronne
britannique et les chefs maoris, afin de déterminer les bases
officielles des relations entre Maoris et colons. Les dispositions
prises dans ce traité sont encore aujourd'hui l'objet de
contestations et de discussions et des conflits, qui concernaient la
possession de la terre, reprirent de plus belle avec ce
traité : le sang coula en 1842 et, pendant les trente années
qui suivirent, des conflits sporadiques, parfois très sanglants,
éclatèrent entre Maoris et colons. Ces conflits, appelés « guerres
de Nouvelle-Zélande » ou « guerres maories »,
culminèrent entre 1842 et 1846 et entre 1860 et 1868.
En
1856, les Maoris élirent un roi, Te Kooti, qui était le
premier dirigeant au-dessus du chef de tribu — notons qu'il y
a toujours, aujourd'hui, une reine maorie, respectée par les deux
communautés. À l'époque cependant, ce « mouvement
royaliste » fut considéré comme une provocation à l'égard
de la souveraineté britannique, et la guerre reprit de plus belle.
En 1865, Te Kooti échappa à la prison et prit la tête d'une
guérilla qui dura jusqu'en février 1872, date à laquelle la
résistance des Maoris fut écrasée. À la suite de ces
affrontements, les colons victorieux prirent à l'encontre des
autochtones des mesures de confiscation des terres qui sont encore
contestées aujourd'hui.
La
période qui suivit les guerres fut à tous égards une période de
répression pour les Maoris. La plupart d'entre eux menaient une vie
totalement à l'écart des Européens, installés en petites
communautés rurales sur les terres — en grande partie
stériles — que les colons leur avaient laissées.
Contrairement aux Européens, ils ne reçurent aucune aide du
gouvernement pour financer leur agriculture et la plupart d'entre
eux vivaient dans la misère. À partir de 1840 et jusque dans les
années 1890, la démographie maorie connut un déclin rapide, dû
aux guerres d'une part, et d'autre part à la misère et aux
maladies apportées par les Européens, comme la grippe, la rougeole
et la coqueluche, contre lesquelles ils n'étaient pas
immunisés : en 1769, la population maorie comptait environ
120 000 individus ; en 1896, seulement 42 000.
Devant ce déclin, les Européens parlaient d'une « race
mourante ». Toutefois, de 1890 à 1990, l'effectif de la
population maorie augmenta de nouveau, pour atteindre environ
300 000 habitants (un dizième de la population de
Nouvelle-Zélande). Un renouveau culturel et politique accompagna
naturellement cette croissance. Certains dirigeants maoris, qui
étaient imprégnés des deux cultures, européenne et maorie,
apparurent dans les années 1910-1930, et formèrent le Young Maori
Party. Parmi ces leaders figuraient d'excellents médecins, qui
contribuèrent en grande partie à l'amélioration des conditions
d'hygiène où vivait leur peuple. Ils avaient pour objectif de se
servir des institutions européennes, comme le Parlement, pour
atteindre leurs objectifs et faire reconnaître l'existence et la
dignité des maoris dans la société. Par ailleurs, ils savaient
adopter les habitudes de vie des colons et leurs pratiques, comme
l'achat de la terre. Quatre d'entre eux abondèrent dans ce sens et
reçurent le titre de chevalier de la Couronne britannique :
ils finirent par être rejetés par les Maoris pour avoir abdiqué
leur culture au profit de celle des Britanniques.
D'autres
dirigeants se tenaient plus à l'écart du gouvernement et des
européens. La plupart agissaient exclusivement au sein de leur
propre tribu, si bien que l'« unité maorie » devint
lettre morte. Ces dirigeants étaient soucieux de contribuer à
l'accroissement du prestige (mana) de leur tribu par des
actions sociales et culturelles, mais aussi par la réalisation de
progrès dans les domaines sanitaire, éducatif et économique. À
la fin des années 1920, la sculpture et les autres arts maoris
fleurirent. Ceux qui se sentaient mal à l'aise devant l'importance
grandissante du tribalisme rejoignirent le Ratana, un mouvement
religieux qui développait une idéologie politique centrée sur la
défense des Maoris. Ce mouvement conclut une alliance avec le Parti
travailliste et contribua de ce fait à la victoire des
travaillistes au Parlement. Dès lors, les Maoris pouvaient avoir
une influence sur les politiques gouvernementales pour
l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils tirèrent en outre
un nouveau prestige de leur participation aux grandes guerres
internationales : leur bravoure et leur habileté au combat
leur octroya un plus grand respect de la part des européens et, à
leurs propres yeux, un retour de mana. En conséquence,
après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde, la
participation des Maoris à la vie du pays s'accrut de manière
considérable. La plupart de ceux qui ne s'étaient pas battus
s'étaient engagés dans les « industries essentielles »
pour participer à l'effort de guerre. Cette mobilisation impliquait
bien souvent pour eux le départ du village pour la ville, en un
véritable exode qui est devenu, depuis les guerres, un des aspects
fondamentaux de la société néo-zélandaise. En 1936, seuls
11 p. 100 des Maoris vivaient dans les centres urbains ;
dans les années 1980, ils étaient plus de 90 p. 100. Cet
exode rural était dû aux guerres et à la présence d'emplois dans
l'industrie urbaine, mais aussi, en grande partie, à la pauvreté
de la terre des Maoris, associée à l'absence de subventions
gouvernementales. Le mode de vie citadin, plus attrayant et plus
varié, contribua sans doute, dans une moindre mesure, à cet
abandon des zones rurales.
La
promiscuité des Maoris et des Européens dans les zones urbaines
eut pour conséquence une conscience accrue des tensions raciales.
Pour les Maoris, le problème principal a consisté à développer
en ville des structures maories afin de remplacer ou de soutenir le
système tribal établi à la campagne. Dans le même temps,
l'activité culturelle maorie a pris un tour résolument
militant : des revendications toujours plus véhémentes pour
une reconnaissance nationale sont diffusées à la radio et à la
télévision, et le rejet des systèmes judiciaire et économique
britanniques refait surface de façon vigoureuse. Ces questions sont
toujours débattues, ainsi que les revendications des Maoris sur les
terres qui leur furent injustement confisquées au XIXe siècle.
Depuis 1980, ces réclamations sont étudiées par le tribunal de
Waitangi. De nombreux Maoris ont réussi à sortir de la
marginalité pour participer aujourd'hui à la vie du pays en tant
que médecins, avocats, hommes d'affaires et membres du parlement.
Mais le pourcentage de Maoris parmi les classes défavorisées est
plus élevé que celui des Européens, et ils sont davantage
atteints par la délinquance, le chômage et les problèmes de
drogue. Pour le moment, aucune solution vraiment efficace n'a été
trouvée pour résoudre ces problèmes, qui sont liés en grande
partie à l'exode rural et à la dissolution de structures
traditionnelles qu'il implique.
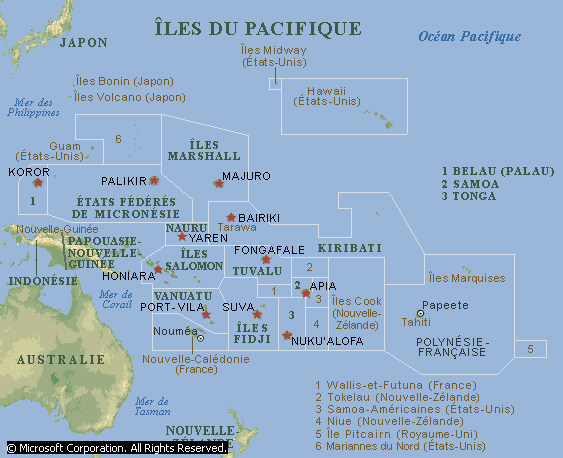
1. PRÉSENTATION
Océanie,
région de l’océan Pacifique, l’une des cinq parties du monde qui
regroupe toutes les terres émergées à l’est et au sud du
continent asiatique. En dehors de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande, la superficie des terres émergées est d’environ
570 000 km2,
pour une population d’environ 8 millions d’habitants (la plus
grande ville étant Honolulu, avec 800 000 habitants).
Outre l’Australie
et la Nouvelle-Zélande, l'Océanie représente un ensemble composite
de plusieurs milliers d’îles, pour la plupart de petite taille,
dispersées au sud de l'équateur, à l'exception d'une partie de la
Micronésie et des îles Hawaii. En dépit des distances
considérables qui souvent séparent ces îles et ces archipels les
uns des autres, certains traits historiques et culturels les
rapprochent. Si, au cours des derniers millénaires, un peuplement
diversifié s'est mis en place et semble avoir cultivé ses propres
différences, son origine renvoie toutefois à un même berceau
géographique et culturel, en l’occurrence le Sud-Est asiatique.
Pour rendre compte à la fois de cette diversité et de ces
similitudes, l’explorateur français Jules Dumont d’Urville a
proposé en 1831 de subdiviser l’Océanie en trois ensembles :
la Mélanésie (les « îles noires »), la Micronésie
(les « petites îles ») et la Polynésie (les « nombreuses
îles »). Ce découpage est encore en vigueur aujourd’hui,
car il offre des repères au sein de la multitude de ces diverses
cultures, cependant la perception moderne de cette pluralité a
considérablement évolué ; la traduction du nom donné à
chaque grande région notamment fait clairement apparaître que la
classification reposait sur une supposée relation directe de cause à
effet entre la race, le milieu et la culture, or cette idée n’est
plus recevable aujourd’hui.
7. HISTOIRE
7.1.
Des
premiers contacts à la colonisation
L’Océanie
a permis à des sociétés très particulières — sociétés
traditionnelles aux relations sociales d’une complexité
extraordinaire, ainsi que l’ont démontré des ethnologues comme
Bronislaw Malinowski, Margaret Mead ou Maurice Leenhardt — de
perdurer.
Ces sociétés sont entrées en contact tardivement avec
les Européens. Au XVI e siècle,
les navigateurs espagnols et portugais (Magellan en 1520-1521)
traversent l’Océanie, avant le Néerlandais Tasman (1642-1643), le
Français Bougainville et surtout le Britannique Cook (1768 à 1779),
qui effectue trois voyages. Le récit de ces explorateurs fait naître
en Europe le mythe des « îles heureuses » où vivent,
libres et gentils, de « bons sauvages ». La Polynésie
surtout, aux femmes charmantes et aux paysages enchanteurs, fascine les
premiers regards européens, qui surnomment notamment Tahiti la « Nouvelle
Cythère ».
Si les XVI e,
XVIIe
et XVIIIe siècles
sont des siècles de découverte, le XIXe
est celui de l'expansion européenne. Les rivages océaniens attirent
d'autres types d'aventuriers : dans un premier temps les
missionnaires, qui bâtissent, non sans peine et dangers, de véritables
royaumes, protestants ou catholiques, afin de convertir l'Océanie au
christianisme ; parallèlement aux missionnaires, des marins
déserteurs ou parfois naufragés, forçats en cavale, débarquent sur
ces mêmes côtes. Ces Beachcombers, surnommés « batteurs
de grève », vérifient, parfois à leurs dépens, l'autre face
du mythe océanien : l'isolement, les fièvres, etc. Puis, des
hommes d'affaires au regard plus froid leur succèdent :
marchands-navigateurs attirés par le bois de santal vendu par la suite
en Chine, marchands-recruteurs cherchant à s'emparer dans les îles de
la main-d'œuvre qui fait alors défaut sur les plantations du
Queensland.
La prise de possession de ces territoires par les
grandes puissances colonisatrices — États-Unis, Royaume-Uni,
France et plus tard Allemagne — ne commence réellement que vers
1840. Le Commonwealth d’Australie est créé en 1901 et la
Nouvelle-Zélande devient un dominion de l’Empire britannique en 1907.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, une partie des
archipels océaniens — Nouvelle-Guinée, Salomon, Carolines,
Marshall, Gilbert, etc. — est occupée par les Japonais. La
reconquête américaine est longue et difficile, néanmoins la guerre du
Pacifique fait entrer brutalement la région dans une nouvelle ère de
son histoire.
Polynésie, une des trois principales divisions
ethnoculturelles (avec la Mélanésie et la Micronésie) de l’ensemble
océanien. Ce découpage, couramment admis, relève plus en réalité
de considérations pratiques que de vraies raisons.
La
Polynésie (littéralement « îles nombreuses ») se
caractérise par des terres isolées et fragmentées, soit
volcaniques, soit réduites à des atolls sans autre relief que la
cime de leurs cocotiers. Ces terres, disséminées dans tout le centre
de l’océan Pacifique, forment un immense triangle dont les trois
sommets sont constitués par Hawaii au nord, l’île de Pâques à l’est
et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Les autres îles et archipels
sont Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Tonga, Wallis-et-Futuna, les îles
Marquises, les îles Cook, la Polynésie-Française, l’île Pitcairn
et Niue. Les descriptions ethnologiques englobent parfois les îles
Fidji, en Océanie, en raison de leur importante population de
descendance polynésienne. La Polynésie compte également
19 petites îles et atolls polynésiens, les « outliers »,
qui se situent hors du triangle entre les Carolines et la
Nouvelle-Calédonie.
Les
sociétés polynésiennes se sont construites dans un moule social
défini par une organisation fortement hiérarchisée et de type
héréditaire. Certaines de ces chefferies ont pu donner naissance à
de véritables royaumes, que l’on a parfois qualifiés de « pré-féodaux »
(par exemple dans l’archipel des Tonga). Les langues de la plupart
des îles polynésiennes appartiennent au même groupe linguistique
malayo-polynésien.
Vers
1500 av. J.-C., à l’époque de la poterie Lapita, la
Polynésie a commencé à se peupler. Les traits mongoloïdes de ses
habitants ont été immortalisés par le peintre Paul Gauguin. Les
Polynésiens réussissent à couvrir une immense zone allant du
tropique du Cancer au nord à la zone tempérée australe. Les
premières colonisations s’effectuent à Tonga et Samoa entre 1300
et 1000 av. J.-C. La grande expansion vers Hawaii, les
Marquises, la Société, Pâques, Cook et la Nouvelle-Zélande a lieu
entre les années 200 et 1000 de notre ère. Le centre de dispersion
semble avoir été les Marquises. On suppose que, vers l’an 800,
les Maoris sont partis de là pour émigrer en Nouvelle-Zélande.
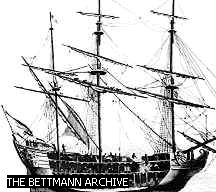
Au milieu du XIX e siècle,
la pêche à la baleine était très pratiquée aux États-Unis.
THE BETTMANN ARCHIVE
1. PRÉSENTATION
baleine,
chasse à la,
activité visant à capturer des baleines pour en commercialiser
l'huile, les fanons, la viande et différents autres sous-produits.
Dès l'âge de pierre, les baleines ont été chassées pour la viande
et l'huile qu'elles procuraient. Elles ont ainsi contribué, tout au
long de l'histoire, à la richesse de nombreux pays.
La baleine fournit des huiles que l'on hydrogénise et
que l'on solidifie pour obtenir des margarines, des savons, des
bougies, des crayons et certains cosmétiques. On emploie sa farine
d'os comme engrais ; la viande sert de nourriture pour l'homme,
les chiens et les chats ; les os permettent de fabriquer de la
gélatine.
2.
HISTORIQUE
2.1.
Essor
La chasse à la baleine fut introduite en France au Moyen Âge, par
les Basques. Des cétacés venaient en effet nombreux dans les eaux
claires du golfe de Gascogne à la recherche de bancs de sardines. À
l'origine, seuls les cétacés échoués étaient exploités.
Toutefois, leur nombre s'est vite révélé insuffisant ; les
Basques ont alors installé des observatoires pour surveiller le
passage des baleines au large. Une fois les proies repérées, de
petites embarcations à rames se lançaient à leur poursuite pour les
harponner.
La chasse s'étendit progressivement aux côtes
espagnoles, à la mer d'Irlande et au Finistère. Les cétacés,
traqués sur tous les fronts, finirent par gagner la haute mer. Les
Basques armèrent alors des navires pour se lancer à leur poursuite.
L'essor rapide de cette activité transforma la chasse
à la baleine en une véritable industrie, pilier de la richesse du
Pays basque pendant près de cinq siècles.
2.2.
Apogée
À l'apogée de l'industrie baleinière basque, au XIIe siècle,
il arrivait que plus de 100 navires emportant
9 000 marins partent chaque année vers Terre-Neuve, depuis
les ports de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz ou de Bayonne. À cette
époque, le roi d'Angleterre, également duc de Guyenne, avait même
créé un « impôt baleine ». Par tradition, la queue
des cétacés revenait à la reine, la tête, au roi, et quelques
fanons, à la cour.
La chasse mena les baleiniers basques jusqu'aux riches
eaux de Terre-Neuve, largement exploitées par la suite. En 1610, les
chasseurs de baleine basques étendirent leur territoire de chasse aux
eaux encore vierges du Spitzberg, redécouvert quinze ans auparavant
par le navigateur néerlandais Willem Barents. Ils furent rapidement
suivis par des navires venus de tous les grands ports français
(Granville, Bordeaux, La Rochelle, Lorient, Saint-Malo, Honfleur,
Le Havre et Dunkerque), mais aussi par les flottes hollandaise,
espagnole, portugaise, russe, allemande, norvégienne, écossaise et
danoise. Ainsi, cent ans après la découverte du Spitzberg, les
monstres marins étaient devenus si rares qu'il fallut aller les
pourchasser au Groenland (Terre Verte). Le Spitzberg fut entièrement
dépeuplé en un siècle.
2.3.
Déclin
Le XVIIe siècle
marqua le déclin de la pêche baleinière française. Ce recul fut
largement amorcé par la perte de Saint-Jean-de-Luz au profit des
Espagnols, en 1636, puis par l'abandon de Terre-Neuve et de l'Acadie
aux Anglais, en 1713. Pendant la Révolution et les guerres
impériales, la chasse française disparut complètement. En 1817, des
primes à la pêche permirent une timide reprise, qui fut de courte
durée. En effet, le Mademoiselle, en 1831, puis le Tourville,
en 1835, furent les derniers voiliers français à partir pour la
chasse à la baleine dans l'océan Arctique. Désormais, Britanniques,
Néerlandais et Américains allaient régner en maîtres sur cet
océan, dont les derniers troupeaux de baleines, retranchés autour du
Groenland, furent rapidement décimés.
|