|
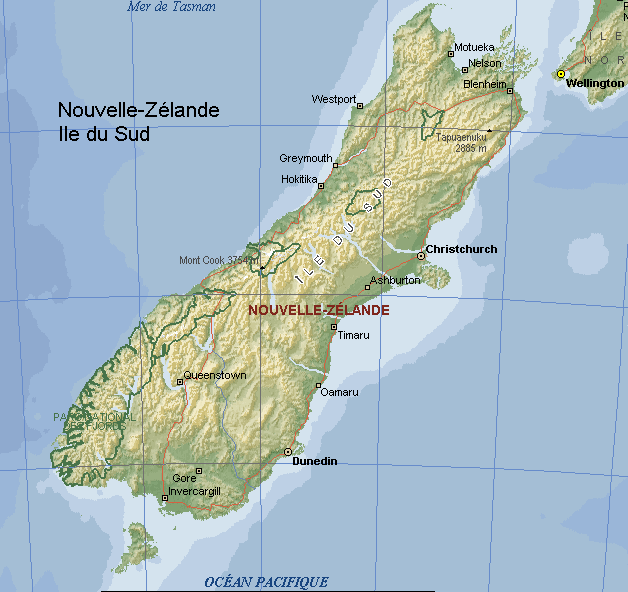
1. PRÉSENTATION
Nouvelle-Zélande,
pays insulaire du Pacifique Sud, membre du Commonwealth, à environ
1 600 km au sud-est de l'Australie. Le pays est formé de deux
grandes îles, l'île du Nord et l'île du Sud, séparées par le
détroit de Cook, et de nombreuses petites îles : l'île Stewart,
Tokelau, ou les îles Cook, qui bénéficient du statut de territoire
extérieur. La superficie globale du pays est de 270 534 km2.
La capitale est Wellington, située dans l'île du Nord.
2.
LE PAYS ET
SES RESSOURCES
2.1.
Relief et
hydrographie
Le paysage
de la Nouvelle-Zélande est caractérisé par les lignes de faille qui
divisent le pays en deux blocs. Les deux îles principales sont donc
coupées par des massifs montagneux : les Alpes néo-zélandaises
couvrant près des 3/4 de l'île du Sud et une chaîne plus basse
couvrant 1/5 de l'île du Nord. On a recensé plus de 220 sommets
au-dessus de 2 286 m d'altitude. Le mont Cook, au cœur des
Alpes néo-zélandaises, est le point culminant du pays
(3 764 m). La Nouvelle-Zélande possède de nombreuses
rivières dont la plupart prennent leur source dans les montagnes. Elles
sont généralement courtes, impétueuses et difficilement navigables.
Seule l'île du Sud possède de grandes plaines alluviales : les
plaines de Canterbury à l'est des Alpes néo-zélandaises. Les
rivières sont souvent entrecoupées de chutes, comme celles de
Sutherland, qui dévalent 580 m, dans l'île du Sud et sont les
cinquièmes plus hautes chutes du monde. Les lacs de Nouvelle-Zélande
se trouvent généralement dans d'anciens cratères volcaniques au
centre de l'île du Nord comme le lac Taupo (606 km2),
le plus grand lac du pays, ou dans les vallées glaciaires des Alpes
néo-zélandaises. Les côtes de Nouvelle-Zélande couvrent près de
7 000 km et sont particulièrement découpées, surtout dans
le Northland, péninsule située au nord d'Auckland.
2.1. 2.
L'île du
Sud
L'île du
Sud couvre environ 152 720 km2.
La chaîne plissée des Alpes néo-zélandaises s'étend sur plus de
480 km du sud-ouest au nord-est. Outre le mont Cook,
15 sommets culminent à plus de 3 048 m. Il existe plus
de 300 glaciers dans les Alpes néo-zélandaises. Leur versant
occidental est généralement boisé et humide. Le versant oriental est
plus sec car mieux abrité des vents. À l'extrême sud-est de l'île se
trouve le plateau d'Otago, zone de plaines élevées, autrefois le
théâtre d'une ruée vers l'or, mais aujourd'hui essentiellement
consacré à l'élevage. Les plaines de Canterbury constituent la plus
grande étendue plate de Nouvelle-Zélande et sa première région
céréalière.
Le réseau
hydrographique est conditionné par le relief élevé des deux îles. La
plupart des rivières ont un cours torrentiel. Il n'y a pas de longs
fleuves navigables, hormis le Waikato (425 km) dans l'île du Nord.
2.2.
Climat
La
Nouvelle-Zélande se trouve dans la zone tempérée. Le climat est
généralement brumeux et humide avec des saisons peu marquées. La
région du Northland est la plus chaude et le versant occidental des
Alpes néo-zélandaises, la région la plus froide. Les précipitations
sont généralement modérées à abondantes. Les précipitations les
plus abondantes (environ 5 590 mm) se situent autour de
Milford Sound, sur la côte sud-ouest de l'île du Sud. La température
moyenne à Wellington varie entre 20,1 °C en janvier, mois le
plus chaud, et 5,6 °C en juillet, mois le plus froid. Les
précipitations moyennes sont de 1 230 mm. À Auckland, les
températures en janvier et en juillet se situent respectivement entre
23,4 et 7,8 °C. Les précipitations moyennes annuelles sont de
1 851 mm.
2.3.
Flore et
faune
L'isolement
de la Nouvelle-Zélande et sa colonisation tardive ont entraîné le
développement d'une flore exceptionnelle de caractère subtropical. Sur
les 2 000 espèces indigènes, environ 1 500 ne se
trouvent nulle part ailleurs dans le monde, comme le kowhai doré et le
flamboyant pohutukawa. Avant l'arrivée massive des Européens, la
végétation en Nouvelle-Zélande était essentiellement composée de
forêts denses d'arbres à feuilles persistantes (pins Kauri et hêtraie
en altitude), en particulier sur l'île du Nord plus chaude, landes avec
épineux, mousses et fougères arborescentes. Aujourd'hui, cette
épaisse forêt n'existe plus que dans des zones inhabitées et dans des
parcs et réserves nationaux.
Depuis
1900, de nombreuses espèces de plantes exotiques ont été introduites,
en particulier les conifères à croissance rapide, comme le pin
d'Oregon ou le pin radiata (pin de Monterey).
Contrairement
à sa flore très riche, la Nouvelle-Zélande possède très peu
d'espèces animales indigènes. Lorsque les Maoris se sont établis en
Nouvelle-Zélande, il n'y existait que deux espèces mammifères et deux
variétés de lézards, le gecko et le tuatara, un survivant de l'ère
préhistorique, quelques espèces de grenouilles et deux espèces de
chauves-souris, seuls mammifères d'origine. Aujourd'hui, la faune
sauvage de Nouvelle-Zélande comprend le cerf, le lapin, la chèvre, le
porc, la belette, le furet et l'opossum australien, tous descendants
d'animaux importés. Sans prédateurs naturels, ces animaux se sont
énormément multipliés et causent de nombreux dégâts sur
l'environnement. Il n'y a pas de serpents en Nouvelle-Zélande. On
compte une grande variété d'oiseaux, dont 23 espèces
autochtones. Parmi les espèces indigènes, on trouve des oiseaux
chanteurs : le bellbird et le tui, des perroquets sylvicoles et des
oiseaux coureurs dont le fameux kiwi, qui appartient à la même famille
que le moa, une autruche géante, aujourd'hui disparue. La plupart des
espèces indigènes sont aujourd'hui en voie de disparition et
protégées. Les nombreux fleuves et lacs du pays hébergent quantité
de poissons comestibles, dont la blanchaille, l'anguille, la lamproie et
des crustacés d'eau douce, en particulier l'écrevisse. La truite et le
saumon ont été acclimatés. Proche d'un point de rencontre de courants
chauds et froids, les eaux néo-zélandaises sont riches en poisson. Les
courants chauds apportent le thon, le poisson volant et le marlin, ainsi
que des requins, attirés par les espèces locales telles que le
vivaneau et la carangue australienne. Les courants froids apportent le
merlan bleu et on trouve le hapuku et le tarakihi tout le long de la
côte.
3.
POPULATION
ET SOCIÉTÉ
3.1.
Démographie
La
population de la Nouvelle-Zélande était de 3,63 millions
d'habitants en 1998, soit une densité moyenne de 13 habitants au
km2,
tandis que le taux d'accroissement naturel atteignait, la même année,
1,04 p. 100.
La Nouvelle-Zélande est l'une des dernières grandes
terres à avoir été conquise par l'Homme. Les premiers colons ont
été les Maoris, peuple polynésien arrivé probablement vers le Xe siècle
de notre ère. La colonisation européenne n'a commencé que dans les
années 1820, mais aujourd'hui environ 80 p. 100 des
Néo-Zélandais sont d'origine européenne, surtout britannique. La
population maorie représente 9,7 p. 100 environ de la
population totale du pays. Elle est concentrée pour l'essentiel sur
l'île du Nord, en particulier près d'East Cape qui est considéré
comme leur berceau culturel et linguistique. Près des trois quarts de
la population vivent dans l'île du Nord. Bien que l'économie de la
Nouvelle-Zélande dépende encore beaucoup du secteur primaire, environ
86 p. 100 de la population est urbanisée. Une petite moitié
est concentrée dans les quatre plus grandes villes et leurs environs.
3.2.
Découpage
administratif et villes principales
Depuis les
réformes du gouvernement local de novembre 1989, la Nouvelle-Zélande
est divisée en 16 régions, chacune gouvernée par un conseil. Ces
régions sont : Auckland, Bay of Plenty, Hawke's Bay, Northland,
Taranaki, Gisborne, Waikato, Manawatu-Wanganui et Wellington dans l'île
du Nord ; Canterbury, Otago, Nelson, Marlborough, Southland,
Tasman et West Coast dans l'île du Sud. Ces régions se subdivisent
administrativement en 15 villes et 59 districts. La plupart
des autorités gouvernementales régionales sont élues au suffrage
direct pour trois ans.
Wellington
(335 468 habitants dans l'agglomération) est la capitale
politique et commerciale de la Nouvelle-Zélande. C'est également le
centre des liaisons inter-îles et de la navigation côtière. Le port
d'Auckland (1 077 205 habitants) est la plus grande ville
du pays et son principal pôle industriel. Les autres principales
concentrations urbaines sont : Christchurch, plus grande ville de
l'île du Sud, deuxième centre industriel de Nouvelle-Zélande et cœur
de l'industrie céréalière, Hamilton, centre d'industrie laitière de
l'île du Nord, et Dunedin, centre aurifère et lainier situé à
l'extrême sud de l'île du Sud.
3.3.
Langues et
religions La
majorité des Néo-Zélandais se déclarent chrétiens. Les principaux
cultes sont l'anglicanisme (25 p. 100), le presbytérianisme
(18 p. 100) et le catholicisme (16 p. 100). Les
méthodistes (5 p. 100) et les autres Églises protestantes
sont également représentés. La plupart des Maoris sont membres des
églises chrétiennes de Ratana et Ringatu. Les juifs, les hindouistes
et les confucéens forment de petites minorités. Environ
15 p. 100 de la population se déclare sans appartenance
religieuse.
En grande majorité anglophone, la Nouvelle-Zélande
possède deux langues officielles : l'anglais et le maori. La
plupart des Maoris parlent anglais. On estime à 50 000
(15 p. 100 de la population maorie) les personnes parlant le
maori couramment.
3.4.
Éducation
La
scolarité est obligatoire entre 6 et 16 ans et l'éducation
publique est gratuite pour les enfants entre 5 et 19 ans.
Les
enfants maoris peuvent recevoir une éducation dans leur langue jusqu'au
secondaire. Ceux qui vivent dans des zones isolées ou qui ne peuvent
aller à l'école suivent les cours de la New Zealand Correspondence
School à la radio ou par correspondance. Outre le système public, il
existe également un petit secteur privé.
La Nouvelle-Zélande possède sept universités :
l'université d'Auckland (fondée en 1882), l'université Waikato (1964,
à Hamilton), l'université Victoria de Wellington (1899), l'université
Massey (1926, à Palmerston North), l'université de Canterbury (1873,
à Christchurch), l'université d'Otago (1869, à Dunedin) et
l'université Lincoln (1990, près de Christchurch) accueillent, au
début des années quatre-vingt-dix, près de
88 000 étudiants.
3.5.
Culture
La plus
ancienne tradition culturelle de Nouvelle-Zélande est celle des Maoris,
basée sur la tradition orale. En raison de l'isolement géographique de
la Nouvelle-Zélande, l'art maori s'est développé indépendamment du
reste de la Polynésie. (Voir Océanien, art). Les colons
européens, en particulier les Britanniques, ont importé leurs propres
traditions, qui ont fortement influencé la vie culturelle du pays
jusque dans les années quarante, mais qui ont depuis, laissé place à
une culture nationale qui accorde plus d’importance à la tradition
maori.
Une grande
partie de la tradition orale des Maoris a été recueillie à la fin du
XIXe siècle
par les intellectuels européens (Shortland, Best) qui craignaient que
l'ethnie ne s'éteigne à cause des maladies importées et de la guerre.
Certaines des légendes les plus importantes ont été publiées et sont
devenues partie intégrante de la conscience nationale. La contribution
maorie au développement littéraire postcolonial néo-zélandais n'est
importante que depuis la seconde moitié des années soixante. Jaqueline
Sturm, en 1966, est devenue le premier écrivain maori cité dans une
grande anthologie de la littérature néo-zélandaise. Keri Hulme est
probablement l'écrivain maori le plus connu hors de la
Nouvelle-Zélande, lauréat en 1985 du prestigieux prix littéraire
anglais Booker. Comme la plupart des écrivains maoris modernes, la
langue d'expression de Hulme est l'anglais. Cependant, au cours des
dernières années, on a assisté à une recrudescence d'écrits en
maori utilisant un style traditionnel.
Les
chansons, ou waiata, et les chants accompagnés de danses et
autres mouvements rythmiques font partie intégrante de la culture
maorie. Le plus connu en dehors du pays est le haka, chant
accompagné de mouvements agressifs et d'expressions faciales destinés
à intimider les adversaires.
Du côté
européen, les écrits les plus remarquables du premier siècle de
colonisation (1820-1920) se trouvent dans les journaux et les récits de
la vie des pionniers, comme A First Year in Canterbury Settlement
(1863) du romancier anglais, Samuel Butler. Le même auteur écrivit
quelques années plus tard une utopie moralisante, machiniste et
anti-darwinienne inspirée de son séjour dans le pays et intitulée Erewhon,
anagramme de nowhere (autrement dit le « pays de nulle
part ». Parmi les grands noms de la littérature néo-zélandaise
figurent William Satchell et Jane Mander, et les poètes
R. A. K. Mason et Blanche Edith Baughan ou encore
Katherine Mansfield, qui la première a attiré l'attention des lecteurs
sur son pays. Jusque dans les années soixante-dix, Mansfield est
restée, avec Dame Ngaio Marsh, et Sylvia Ashton-Warner, l'un des rares
écrivains connus en dehors du pays. Depuis la Seconde Guerre mondiale,
la poésie s'est développée, sous la direction d'Allen Curnow et de
James K. Baxter. La grande figure de la fiction d'après-guerre est
Frank Sargeson, écrivain de nouvelles et de romans, mort en 1982, et
inspirateur de nombreux écrivains dont Maurice Duggan et Janet Frame.
Parmi d'autres écrivains devenus célèbres depuis les années
soixante-dix, on trouve Maurice Gee et Maurice Shadbolt.
L'industrie cinématographique néo-zélandaise est
réduite mais connaît un succès international grandissant. Jane
Campion et Peter Jackson sont les réalisateurs les plus connus. La
réputation de Jane Campion comme réalisatrice s'est faite avec Un
ange à ma table, version de l'autobiographie de Janet Frame, en
1990, et elle a été définitivement établie par le film ayant reçu
un oscar en 1994, la Leçon de piano. Citons également le film
de Lee Tamahori l'Âme des Guerriers, qui lors de sa sortie en
1994, connut un franc succès, notamment parmi la communauté maorie.
La soprano Kiri Te Kanawa a également fait connaître
son pays à l’étranger.
On trouve des galeries d'art et des musées dans la
plupart des grandes villes, mais les plus vieilles institutions
artistiques se trouvent à Auckland. La galerie d'Arts de la ville
d'Auckland (fondée en 1888) et le musée d'Auckland (1852) possèdent
des collections importantes. La galerie nationale d'Art (1936), à
Wellington, possède de remarquables peintures australiennes et
néo-zélandaises. On trouve de magnifiques collections ethnologiques et
d'histoire naturelle au National Museum de Wellington, au Canterbury
Museum de Christchurch et à l'Otago Museum de Dunedin.
Suite des informations sur la Nouvelle Zélande sur la page
concernant l'île du Nord
|