SOMMAIRE
:
-
Expédition
Lewis et Clark
-
Sioux
-
Sitting
Bull
-
Pieds-Noirs
-
Comanches
-
Cheyennes
-
Hidatsa
-
Shoshone
-
Mandan
-
Nez-percés
-
Apaches
-
Bataille
de Little Big Horn
-
George
Amstrong CUSTER
-
Wounded
Knee
-
Buffalo
Bill
-
Rivière
Missouri
-
Yellowstone
National Park
-
Parcs
nationaux et réserves naturelles
-
Bison
-
Wapiti
Lewis
et Clark, expédition,
mission d'exploration effectuée entre 1804 et 1806 aux États-Unis,
de l'ouest du Mississippi à l'océan Pacifique. Les États-Unis
avaient reçu un nouveau territoire situé à l'ouest du Mississippi
lors de la cession de la Louisiane en 1803, et le président Thomas
Jefferson souhaitait mieux connaître ces nouvelles terres.
L'expédition devait recenser la faune et la flore de ces régions,
établir des relations avec les peuples amérindiens et collecter
des informations à propos de leur culture.
Lewis 
 Clark
Clark
Les
chefs de cette expédition étaient Meriwether Lewis et William Clark.
L'équipe était constituée de trente à quarante-cinq soldats et
gardes-frontières dont une femme : cette dernière, une Shoshone
nommée Sacagawea, rejoignit la compagnie en 1805 et ses qualités
d'interprète furent très utiles.

Intitulée « À travers le nord-ouest
américain du Mississippi à l'océan Pacifique », cette
carte de Meriwether Lewis est une copie d'un détail d'une carte
dessinée lors de l'expédition par William Clark. Elle représente
le fleuve Colombia, marquant l'actuelle frontière entre les États
de Washington et de l'Orégon, et son embouchure sur l'océan
Pacifique.
L'expédition
partit de Saint Louis et remonta vers le nord le long du Missouri.
L'équipe passa son premier hiver avec le peuple Mandan, de la tribu
des Dakotas. Au printemps 1805, l'expédition continua de remonter
péniblement le Missouri jusqu'à son cours supérieur puis franchit
le versant oriental des Rocheuses, descendit la Snake River puis la
Columbia et atteignit le Pacifique en novembre 1805.
En
1805-1806, Lewis et Clark hivernèrent sur les berges du fleuve
Columbia. Le voyage du retour fut difficile : hiver interminable,
conflits occasionnels avec les Indiens, épuisement physique et
mental. Le groupe se divisa en deux équipes afin de couvrir des
terrains différents, progressant toutes deux par voie de terre pour
éviter de remonter les eaux tumultueuses de la Snake River. Puis ils
se retrouvèrent au confluent du Yellowstone et du Missouri pour
redescendre ce dernier. Le 23 septembre 1806, Lewis et Clark
étaient de retour à Saint Louis, après avoir parcouru plus de
13 000 km.
1.
PRÉSENTATION
Sioux,
puissante confédération de peuples d’Indiens d’Amérique du
Nord, de la famille linguistique sioux et de la zone culturelle des
Plaines. Le mot ojibwa désignant le groupe, transcrit en français
par les premiers explorateurs et négociants par le mot Nadouessioux,
fut abrégé en Sioux et passa ainsi dans la langue anglaise.
Les Sioux s’appellent eux-mêmes Lakota ou Dakota, ce
qui signifie « alliés ». Les sept peuples se
répartissent en trois divisions majeures : les Santees
sédentaires et agriculteurs, les Nakotas et les Tétons chasseurs de
bisons.
Au
XVIIe siècle,
les Sioux regroupaient de petites tribus des Woodlands dans l’actuel
Minnesota. Ils se nourrissaient de petit gibier, de cerfs et de riz
sauvage, et étaient entourés de grands groupes rivaux. Des conflits
avec leurs ennemis, les Ojibwés, les contraignirent à migrer vers
les prairies à bisons des Grandes Plaines. À mesure qu’ils
devinrent experts dans la chasse aux bisons, ces peuples s’accrurent
en nombre et prospérèrent. En 1750, les Sioux comptaient quelque
30 000 personnes solidement établies au cœur des Grandes
Plaines du Nord. Ils dominèrent cette région pendant tout le siècle
suivant.
2.
LA LUTTE
CONTRE L’AVANCÉE DES ÉTATS-UNIS
Les
Sioux combattirent aux côtés des Britanniques lors de la révolution
américaine et de la guerre de 1812. En 1815, cependant, les groupes
de l’Est conclurent des traités d’amitié avec les États-Unis
et, en 1825, un autre traité confirma la possession par les Sioux d’un
immense territoire englobant une grande partie du Minnesota actuel,
les deux Dakota, le Wisconsin, l’Iowa, le Missouri, et le Wyoming.
En 1837, les Sioux vendirent aux États-Unis tous leurs territoires à
l’est du Mississippi ; d’autres territoires furent encore
vendus en 1851.

Fort Laramie constituait un refuge pour les
pionniers, régulièrement attaqués par les Sioux lors de leur
longue traversée vers l'Ouest. Un traité de paix, signé en 1868,
permit d'instaurer une paix temporaire dans la région.
Fort Laramie, aquarelle d'Alfred Jacob Miller.
À
cette époque, un processus d’attaque et de contre-attaque se
développa, tandis que les colons pénétraient sur les terres sioux.
Le premier conflit se produisit en 1854 près de Fort Laramie, dans l’actuel
Wyoming : dix-neuf soldats américains furent tués. En
représailles, les troupes américaines tuèrent environ cent Sioux
dans leur campement de l’actuel Nebraska, et emprisonnèrent leur
chef en 1855.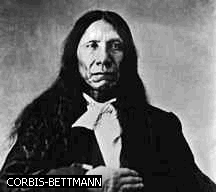
Chef sioux, Red
Cloud (« Nuage
rouge ») défendit contre les troupes américaines, dans les
années 1860, des terres qui font aujourd'hui partie des États du
Wyoming, du Montana et du Dakota du Sud.
CORBIS-BETTMANN
La
guerre de Red Cloud (Nuage rouge) (1866-1867), d’après le nom d’un
chef sioux, se termina par un traité accordant les Black Hills à
perpétuité aux Sioux. Le traité, cependant, ne fut pas respecté
par les États-Unis. Des chercheurs d’or et des mineurs envahirent
la région à partir de 1870. Au cours des conflits qui s’ensuivirent,
le général Custer fut tué avec trois cents soldats à Little Big
Horn le 25 juin 1876, par le chef sioux Sitting Bull et ses
guerriers. Les Sioux se divisèrent après cette bataille. Les troupes
américaines massacrèrent plus de deux cents hommes, femmes et
enfants sioux à Wounded Knee en décembre 1890, ce qui mit un terme
à la résistance sioux.
3.
MODE DE
VIE
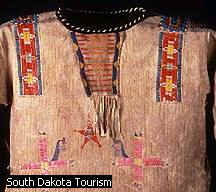 Le
tiyospe était l’unité sociale de base des Sioux : un
groupe familial élargi qui voyageait en quête de gibier. Les Sioux
croyaient en un seul dieu omniprésent et omnipotent, Wakan Tanka,
ou le Grand Mystère. Les visions religieuses étaient recherchées,
comme dans la cérémonie extrêmement impressionnante de la danse de
l’esprit. Selon la coutume sioux, l’infidélité dans le mariage
était punie de défiguration ; une infraction aux règles de
chasse entraînait la destruction du tipi et des possessions ;
lors des cérémonies funèbres, les participants s’infligeaient des
coups de fouet. Aujourd’hui, les descendants des Sioux vivent dans
des réserves aux États-Unis, dans le Minnesota, le Dakota du Nord,
le Dakota du Sud, le Montana et le Nebraska. Ils ont conservé leur
langue amérindienne et ses trois principaux dialectes. Le
tiyospe était l’unité sociale de base des Sioux : un
groupe familial élargi qui voyageait en quête de gibier. Les Sioux
croyaient en un seul dieu omniprésent et omnipotent, Wakan Tanka,
ou le Grand Mystère. Les visions religieuses étaient recherchées,
comme dans la cérémonie extrêmement impressionnante de la danse de
l’esprit. Selon la coutume sioux, l’infidélité dans le mariage
était punie de défiguration ; une infraction aux règles de
chasse entraînait la destruction du tipi et des possessions ;
lors des cérémonies funèbres, les participants s’infligeaient des
coups de fouet. Aujourd’hui, les descendants des Sioux vivent dans
des réserves aux États-Unis, dans le Minnesota, le Dakota du Nord,
le Dakota du Sud, le Montana et le Nebraska. Ils ont conservé leur
langue amérindienne et ses trois principaux dialectes.
Les
Sioux ont pris une part active au mouvement des droits civiques
amérindien, recherchant la restauration de leur territoire
traditionnel et l’institution d’une forme modernisée de la vie
traditionnelle.
Sitting
Bull
(v. 1834-1890), chef indien de la tribu Sioux.
Né
dans la région du Grand River, Sitting Bull, de son vrai nom
Tatanka Yotaka, devint chef des Sioux en 1867, et empêcha le gouvernement des États-Unis d'annexer les terres de son peuple. Entre
le 25 et le 26 juin 1876, l'expédition punitive dirigée par
le lieutenant-colonel George Armstrong Custer fut anéantie par les
Sioux et d'autres tribus à la bataille de Little Bighorn. Bien que
Sitting Bull n'y eut pas pris part, l'armée américaine le
poursuivit, mais il parvint à s'enfuir. En 1881, il rentra aux
États-Unis. Il participa au Wild West show de Buffalo Bill, puis
vécut dans une réserve en 1889, alors que les rapports entre
Blancs et Indiens se dégradaient. Afin d'empêcher toute révolte
dans les réserves, Sitting Bull fut arrêté, le 15 décembre
1890, par les autorités policières, qui l'abattirent. Le massacre
de Wounded Knee survint peu après.
Pieds-Noirs,
confédération
de tribus indiennes appartenant au groupe linguistique algonquien et
peuplant la région des Plaines, entre les rivières Missouri et
Saskatchewan. Cette confédération s'appelle également Pied-noir.
Les
Pieds-noirs comprennent trois catégories distinctes : les
Siksikas ou Pieds-noirs, les Kainahs ou Sangs, et les Piegans.
Originaires de la province de la Saskatchewan, ils migrèrent au
milieu du XVIIIe siècle
dans le Montana à la recherche de bisons. Au milieu du XIXe siècle,
à l'apogée de leur puissance, ils contrôlaient un vaste territoire.
Les
Pieds-noirs étaient d'excellents cavaliers, des chasseurs de bisons
émérites et des guerriers redoutables. Ils étaient craints par les
autres tribus indiennes et partaient fréquemment en guerre contre
leurs voisins Cree, Sioux, Crow, etc. En temps de guerre, les trois
catégories de Pieds-noirs s'unissaient pour défendre leurs terres.
Peuple
nomade, les Pieds-noirs vivaient dans des tipis regroupés en villages
facilement démontables. Ils étaient divisés en plusieurs bandes,
chacune dirigée par un chef. Ces bandes se réunissaient l'été pour
les cérémonies sociales et religieuses. Hormis la culture du tabac,
les Pieds-noirs ne pratiquaient pas l'agriculture. Ils présentaient
une économie typique des peuples des Plaines ; les hommes
fabriquaient des armes et chassaient, tandis que les femmes
s'occupaient des enfants et récoltaient des plantes sauvages pour la
nourriture. Les Pieds-noirs pratiquaient la polygamie ; un
guerrier valeureux pouvait posséder plusieurs femmes.
Comanches,
peuple amérindien, branche méridionale des Shoshones, appartenant à
la famille linguistique uto-aztèque et à la culture des Indiens des
Plaines. Les Comanches quittèrent leur territoire originel et aride
de l'ouest des montagnes Rocheuses pour émigrer dans les Grandes
Plaines du Sud, au XVe siècle.
Là, ils chassèrent les Apaches et se retrouvèrent, à la fin du
XVIIIe siècle
et au début du XIXe,
à la tête d'un vaste territoire. Les Comanches étaient les
cavaliers les plus émérites de tous les peuples des Plaines ;
ils se fournirent en pintos, leurs chevaux préférés, en attaquant
les Espagnols, avant d'en faire eux-mêmes l'élevage. Peuple
extrêmement guerrier, les Comanches n'hésitaient pas à parcourir de
grandes distances pour attaquer les campements des colons et des
autres tribus indiennes. Ils étendirent leurs incursions jusqu'au
Mexique et empêchèrent les colons de pénétrer sur leur territoire
pendant plus d'un siècle. Ils firent la paix avec le gouvernement des
États-Unis en 1875. Au début du XIXe siècle,
la population comanche comptait environ trente mille individus, mais
une épidémie réduisit rapidement leur nombre à moins de dix mille.
L'activité
principale de ce peuple nomade était la chasse au bison. Organisées
socialement en bandes patrilinéaires, les familles vivaient dans des
wigwams. Ils étaient vêtus de peaux de daim et portaient des
chapeaux en fourrure l'hiver. Leur emblème de guerre était
impressionnant ; il s'agissait d'un scalp entier de bison avec
les cornes. Les hommes et les femmes pratiquaient le tatouage. La
religion comanche était essentiellement centrée sur la révélation
surnaturelle, obtenue grâce à une période de jeûne et d'isolement.
Les Comanches croyaient que les esprits des animaux leur portaient
chance et pouvaient leur venir en aide ; ils pensaient en outre
que des esprits protecteurs vivaient dans les rochers et se
manifestaient avec l'orage. Aujourd'hui, les descendants des Comanches
vivent dans des territoires privés de l'Oklahoma.
Cheyennes,
peuple indien d’Amérique du Nord, de la famille linguistique
algonquine.
Les
Cheyennes étaient des fermiers, des chasseurs, et pratiquaient la
cueillette au centre de l’actuel Minnesota, mais furent chassés de
cette région par les Sioux et les Ojibwés à la fin du XVIIe siècle.
Ils migrèrent progressivement vers l’Ouest dans le Dakota du Nord
qui porte actuellement leur nom et finirent par s’y installer,
vivant dans des cabanes de terre et pratiquant l’agriculture. Les
Ojibwés détruisirent cette colonie aux alentours de 1770, et les
Cheyennes se déplacèrent alors vers le Sud.
En
s’installant dans la région des Black Hills (dans l’actuel Dakota
du Sud), les Cheyennes passèrent de l’agriculture et de la chasse
au petit gibier à un mode de vie nomade, dépendant du bison. L’introduction
du cheval, qui atteignit cette partie de l’Amérique aux alentours
de 1750, contribua à faire des Cheyennes l’un des peuples majeurs
des Plaines de l’Ouest. Les Cheyennes avaient une culture des
Plaines typiquement nomade et étaient de remarquables chasseurs de
bisons et de farouches guerriers. Ils pratiquaient la danse du soleil,
au cours de laquelle les nouveaux braves « dansaient »
pendant des heures suspendus à un poteau. Leur religion accordait une
large prédominance aux expériences visionnaires. Durant ces visions,
des animaux étaient censés adopter une personne pour lui accorder
des pouvoirs spéciaux. Voir aussi Amérindiennes, langues.
Aux
environs de 1830, les Cheyennes s’étaient divisés en deux
groupes : les Cheyennes du Sud le long de la rivière Arkansas
supérieure, et les Cheyennes du Nord aux sources de la Platte River.
Jusqu’à ce qu’un afflux massif de chercheurs d’or pénètre
dans leur territoire à la fin des années 1850, les Cheyennes
étaient pacifiques envers les colons américains d’origine
européenne. Les conflits s’intensifièrent jusqu’à ce que les
forces militaires américaines massacrent un groupe paisible d’hommes,
de femmes et d’enfants cheyennes à Sand Creek, dans l’État du
Colorado, en 1864.
En
1876, des groupes de guerriers sioux et cheyennes causèrent la
défaite du général George Armtrong Custer et de ses trois cents
soldats à l’issue de la bataille de Little Big Horn. Après leur
reddition en 1877, les Cheyennes furent transférés par les
gouvernements américains dans le territoire Indien (actuel Oklahoma).
Là, ils souffrirent de maladies et de malnutrition et tentèrent
désespérément de s’enfuir.
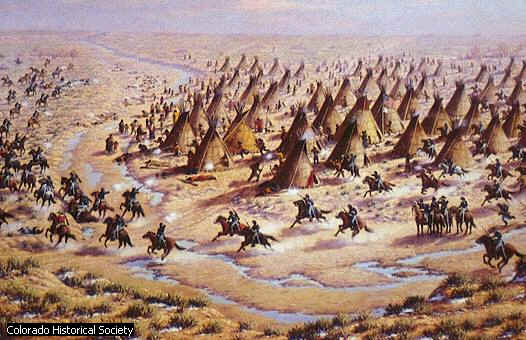
Le 29 novembre 1864, le colonel John M. Chivington
et ses soldats massacrèrent près de 300 Indiens Cheyennes et
Arapahos, essentiellement des femmes et des enfants. Le massacre fut
condamné par le gouvernement, qui indemnisa les survivants. En 1867,
le gouvernement américain imposa le transfert de tous les
Amérindiens des Grandes Plaines vers des réserves de l'Oklahoma.
Hidatsa,
tribu indienne d'Amérique du Nord, parfois également appelée
Minitari ou Gros-Ventre, appartenant à la famille linguistique des
Sioux et à la zone culturelle des Indiens des Plaines. Les Hidatsa
peuplèrent la région longeant la partie supérieure du fleuve
Missouri dans l'État actuel du Dakota du Nord jusqu'en 1837, date à
laquelle une épidémie de variole décima tous les Amérindiens de la
région. Les survivants se regroupèrent près du poste de commerce de
Fort Berthold. Le nom « Hidatsa » fut employé pour la
première fois au milieu du XIXe siècle
et faisait référence à l'un de leurs villages.
Peuple
d'agriculteurs, les Hidatsa vivaient dans des maisons en terre
regroupées en villages et cultivaient principalement le maïs. Ils
possédaient une organisation sociale complexe avec des rites
élaborés, partaient à la chasse au bison une fois par an et
pratiquaient la danse du soleil. Les Hidatsa conclurent des alliances
avec les tribus indiennes voisines Mandan et Arikara.
Shoshone,
peuples amérindiens des Grandes Plaines des États-Unis.
Les
peuples shoshones sont originaires de l’ouest des États-Unis. Bien
que parlant des langues similaires — les langues shoshoniennes,
de la famille linguistique uto-aztèque (voir Amérindiennes,
langues) —, ils ont développé des modes de vie différents
adaptés chacun à leur environnement.
Les
Eastern Shoshones vivaient dans les Grandes Plaines de la chasse au
bison. Ils firent de nombreux mariages avec les Crows, les Nez-Percés
et des Métis francophones. Ils résident principalement dans la
réserve de Wind River (Wyoming) qu’ils partagent avec les Arapahos.
Les
Shoshone-Bannocks, descendants des Northern Shoshones, vivaient sur le
plateau du fleuve Columbia, pratiquant la pêche, la chasse et la
cueillette. Ils ont été installés en 1868 sur la réserve de Fort
Hall (Idaho) avec un groupe de Bannocks (Northern Païutes) également
de langue uto-aztèque.
Les
Western Shoshones (ou Newe) vivaient traditionnellement dispersés en
petits groupes familiaux, sur de vastes territoires, pratiquant la
chasse et la cueillette. Aujourd’hui, on trouve plusieurs
communautés western shoshones dans les États de Californie, du
Nevada, de l’Idaho, ainsi qu’un sous-groupe nommé Goshute qui
réside sur la frontière entre le Nevada et l’Utah.
Les
peuples shoshones représentent plus de 10 000 personnes.
Leur situation économique varie en fonction des groupes. Leurs
principales activités sont l’élevage de bétail, l’exploitation
des ressources naturelles et le commerce. Les pratiques religieuses
des Shoshones incluent la Danse du Soleil (d’origine mandan-hidatsa),
la Danse des Esprits (d’origine païute) et la cérémonie du
Peyotl, élément principal de la Native American Church. Les peuples
shoshones luttent encore actuellement pour préserver leurs sites
sacrés menacés par le développement de complexes touristiques ou
industriels.
Mandan,
peuple amérindien d'Amérique du Nord de la famille linguistique
sioux. Les Européens rencontrèrent les Mandan pour la première fois
au XVIIIe siècle
à l'embouchure de la rivière Heart, dans la partie inférieure du
Missouri. Les Mandan, plus agriculteurs que nomades, vivaient dans des
villages fortifiés. Ils avaient coutume de se tatouer le visage et la
poitrine et pratiquaient certaines cérémonies sociales
sophistiquées. Une épidémie de variole emporta un grand nombre
d'entre eux, en 1837.
Nez-Percés,
peuple indien d'Amérique du Nord, de langue sahaptan. Les Nez-Percés
occupaient autrefois un vaste territoire situé dans le sud-est de
l'État de Washington, le nord-est de l'Oregon et le centre de
l'Idaho. Leur nom leur fut donné par les explorateurs français pour
leur coutume de porter des pendants de nez.
L'économie
des Nez-Percés était fondée sur la pêche, surtout du saumon, et
sur la cueillette de plantes, telles que les bulbes de camass, les
racines sauvages et les baies. Après 1700 environ, les Nez-Percés
élevaient aussi des chevaux et chassaient le bison. En hiver, ils
habitaient sur les berges des rivières dans des villages dont les
maisons étaient construites avec des écorces, des nattes et des
peaux. En été, ils campaient en montagne et sur les grandes prairies
de camass des plateaux. Ils faisaient du tissage et décoraient des
peaux de bisons avec de la peinture et des piquants de porc-épics.
Leur principale cérémonie religieuse était une danse en l'honneur
de l'esprit gardien, leur divinité tutélaire. Ils exécutaient
également des danses guerrières. Le peuple tout entier était
divisé en plus de 40 groupes, mené chacun par un chef
sélectionné par le peuple. Les mariages se pratiquaient
généralement en dehors du groupe. Une mission protestante s'établit
à Lapwai (Idaho) en 1837, pour répondre à la demande d'éducation
chrétienne faite par les Nez-Percés.
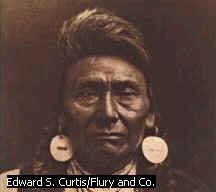
Le chef
Joseph,
chef des Nez-Percés, était respecté pour son génie militaire et
son éloquence. Extrait de son discours de reddition : « Certains
membres de mon peuple se sont enfuis dans les montagnes où ils n’ont
ni couvertures ni nourriture. Personne ne sait où ils se trouvent ;
ils sont peut-être en train de mourir de froid. Je veux qu’on m’accorde
le temps de chercher mes enfants, mais combien en trouverai-je ?.
Sans doute sont-ils parmi les autres morts. Écoutez-moi bien, je
suis las, et mon cœur est malade et triste. À partir d’aujourd’hui,
je ne me battrai plus jamais. »
En
1855, les Nez-Percés signèrent un traité avec les États-Unis
cédant la majeure partie de leur territoire au gouvernement, et
reçurent une réserve qui englobait Wallowa Valley, dans l'Oregon.
Lorsqu'on découvrit de l'or dans la région, ils furent contraints
d'abandonner toutes leurs terres et de retourner dans une réserve à
Lapwai. Un groupe mené par Chef Joseph refusa de se soumettre à cet
accord et, en 1877, gagna une bataille contre les troupes fédérales.
Joseph mena alors son groupe, composé aussi de femmes et d'enfants,
dans une retraite longue de plus de 1 600 km, et, bien que
poursuivis par des troupes fédérales nettement plus nombreuses, les
Amérindiens gagnèrent plusieurs batailles. Cependant, à environ
50 km de la frontière canadienne où ils auraient été sauvés,
Joseph et sa troupe furent capturés. Ils furent envoyés vers le
territoire Indien où beaucoup périrent rapidement. Quelques-uns des
survivants furent plus tard autorisés à retourner dans l'Idaho, où
la majorité d'entre eux vit actuellement dans la réserve des
Nez-Percés. Joseph et ceux qui restaient furent envoyés dans la
réserve de Colville, dans le nord de l'État de Washington. Voir
aussi Amérindiennes, langues.
1.
PRÉSENTATION
Apaches,
groupe de six peuples amérindiens culturellement apparentés et issus
de populations parlant athapascan. Ces différents peuples sont les
Apaches Kiowa, qui vivaient entre la frontière nord du Nouveau-Mexique
et la rivière Platte ; les Lipan de l'est du Nouveau-Mexique et
de l'ouest du Texas ; les Jicarilla du sud du Nouveau-Mexique ;
les Mescaleros du centre du Nouveau-Mexique et les Apaches de l'ouest au
centre de l'Arizona.
2.
HISTOIRE
Les
premiers habitants Apaches du sud-est des États-Unis étaient des
nomades. Certains allaient dans le Sud, parfois même jusqu'au Mexique.
Ils étaient essentiellement chasseurs de bisons, mais pratiquaient
aussi l'agriculture dans une moindre mesure. Pendant des siècles, ils
ont été de farouches guerriers, experts à la survie dans le désert,
et attaquant tous ceux qui empiétaient sur leur territoire.
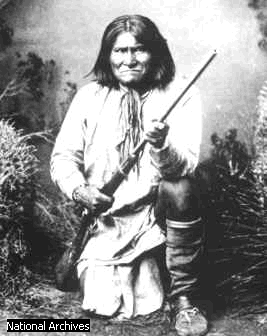 Les
premiers envahisseurs furent les Espagnols, qui pénétrèrent dans le
territoire apache à la fin du XVIe siècle.
L'avancée des Espagnols vers le nord bouleversa les anciennes relations
commerciales des Apaches avec les peuples voisins. Lorsque le
Nouveau-Mexique devint une colonie espagnole en 1598, les hostilités
s'accrurent entre les Espagnols et les Apaches. Un afflux de Comanches
sur le territoire des Apaches au début du XVIIIe siècle
obligea les Lipan et les autres Apaches à se diriger vers le sud et à
s'éloigner ainsi des terrains de pâture et de leur principale source
de nourriture, le bison. Ces Apaches commencèrent alors à piller pour
se nourrir. Les
premiers envahisseurs furent les Espagnols, qui pénétrèrent dans le
territoire apache à la fin du XVIe siècle.
L'avancée des Espagnols vers le nord bouleversa les anciennes relations
commerciales des Apaches avec les peuples voisins. Lorsque le
Nouveau-Mexique devint une colonie espagnole en 1598, les hostilités
s'accrurent entre les Espagnols et les Apaches. Un afflux de Comanches
sur le territoire des Apaches au début du XVIIIe siècle
obligea les Lipan et les autres Apaches à se diriger vers le sud et à
s'éloigner ainsi des terrains de pâture et de leur principale source
de nourriture, le bison. Ces Apaches commencèrent alors à piller pour
se nourrir.
Geronimo
(1829-1909), chef des Apaches Chiricahuas, opposa, de 1876 à 1886,
une résistance farouche à la volonté des États-Unis de déplacer
les Chiricahuas de leur foyer traditionnel dans l'Arizona vers la
réserve de San Carlos, au Nouveau-Mexique. Plusieurs fois
capturé par les autorités fédérales, il leur échappa jusqu'en
septembre 1886, date à laquelle il obtint le regroupement de sa tribu
dans l'Oklahoma (1894). Sa résistance marqua un des derniers
épisodes des guerres indiennes.
Les
attaques des Apaches contre les colons jalonnèrent la conquête de
l'Ouest américain et l'acquisition par les États-Unis du
Nouveau-Mexique en 1848. Les Amérindiens et les autorités militaires
américaines s'affrontèrent dans des guerres sans merci jusqu'à ce que
toutes les tribus apaches soient finalement regroupées dans des
réserves. La plupart des groupes étaient assujettis vers 1868, à
l'exception des Chiricahua, qui continuèrent leurs attaques jusqu'en
1872, année où leur chef Cochise signa un traité avec le gouvernement
américain et rejoignit une réserve en Arizona. Les derniers
combattants apaches, menés par le chef Geronimo, furent pourchassés en
1886 puis détenus en Floride.
3.
COUTUMES
ET RELIGION
Dans la
culture apache, les femmes rapportaient la nourriture, le bois et l'eau
tandis que les hommes partaient chasser et faire la guerre. La plupart
des familles vivaient dans des wickiups — des huttes de
branchage en formes de dôme érigées par les femmes — ou dans
des tipis en peau de bisons. Les peuples apaches de l'Ouest étaient matrilinéaires
(l'ascendance maternelle est prise en compte dans la filiation). La
polygamie était pratiquée lorsque les circonstances économiques le
permettaient, et l'un ou l'autre des conjoints pouvait aisément mettre
un terme au mariage. La religion était un aspect fondamental de la vie
des Apaches ; les plus connus parmi les êtres surnaturels
étaient les ga'ns, des esprits de la montagne protecteurs
représentés dans des rites religieux tels que la cérémonie de
puberté des filles, qui a encore lieu chez les Apaches de l'Ouest. De
nombreux descendants d'Apaches vivent dans des réserves d'Arizona et du
Nouveau-Mexique. L'agriculture, l'élevage et les activités liées au
tourisme sont importants économiquement. Cependant, le chômage y est
élevé. Leur culture actuelle est un mélange de croyances
traditionnelle apaches, comme la magie, et d'éléments américains
contemporains. Voir aussi amérindiennes, langues
Little
Big Horn, bataille de,
engagement militaire américain qui eut lieu le 25 juin 1876,
dans la région du Montana, entre un régiment de la 7e cavalerie
des États-Unis, commandé par le général George Armstrong Custer,
et une troupe de guerriers sioux et cheyennes, aussi appelée la
dernière bataille de Custer. La découverte d’or dans le massif des
Black Hills (« collines noires ») du Dakota du Sud, en
1874, avait attiré un grand nombre de prospecteurs blancs sur les
territoires des Sioux qui, sous le commandement de leurs chefs Sitting
Bull, Crazy Horse et Gall, les attaquèrent pour préserver leurs
terres sacrées.

Le second mandat du président Grant fut endeuillé
par le désastre militaire de Little Big Horn. Le 25 juin 1876,
lors d'une offensive du 7 e régiment
de cavalerie contre les Sioux et les Cheyennes sur les bords de la
rivière Little Big Horn, dans le Montana, le lieutenant-colonel
Custer et 264 de ses hommes périrent devant l'ennemi.
En
1876, l’armée américaine envisagea de mener une campagne contre
les Amérindiens hostiles, alors rassemblés dans le sud-est du
territoire du Montana. Le régiment de Custer, composé de
655 hommes, formait l’avant-garde d’une troupe commandée par
le général Alfred Howe Terry. Le 25 juin, les éclaireurs de
Custer localisèrent les Sioux à proximité de la rivière Little Big
Horn. Ignorant leur nombre — entre 2 500 et
4 000 hommes —, Custer décida de les attaquer
immédiatement. Espérant encercler ses adversaires, il organisa l’offensive
en prévoyant un assaut frontal avec environ 260 hommes sous son
propre commandement et deux colonnes sur les flancs. Le groupe d’assaut
se trouva en infériorité numérique face aux Sioux. Coupés des
colonnes des flancs et complètement encerclés, Custer et ses hommes
se firent massacrer, avant que les troupes de Terry ne viennent à la
rescousse du reste du régiment. Le champ de bataille, appelé aujourd’hui
monument national de Little Big Horn, fut déclaré monument national
en 1886 ; jusqu’en 1991, il était connu sous le nom de
monument national du champ de bataille de Custer.

Custer,
George Amstrong
(1839-1876), général nordiste américain dont la « dernière
charge » contre les guerriers sioux et cheyennes à Little Big
Horn est devenue un épisode légendaire de l'histoire américaine. À
sa sortie de l'académie militaire West Point, il se distingua durant
la guerre de Sécession. Il devint lieutenant colonel du 7e régiment
de cavalerie et fut envoyé au Kansas pour mener les dernières
guerres indiennes. Il fit campagne contre les Cheyennes de 1867 à
1868. En 1876, les États-Unis décidèrent d'en finir avec la
résistance des Sioux du Dakota, menés par Sitting Bull. Le régiment
de Custer repéra un camp sioux le 24 juin 1876, commandé par
les chefs Gall et Crazy Horse. Inférieurs en nombre, Custer et ses
hommes, au nombre de 264, furent cernés et tués par les Sioux.
Wounded
Knee,
village du Dakota du Sud, sur la réserve indienne de Pine Ridge.
Wounded Knee fut le site de deux conflits entre les populations
indiennes et le gouvernement des États-Unis. Vers la fin des années
1880, les Sioux se mirent à pratiquer la religion enseignée par
Wovoka, un prophète de la tribu des Paiutes qui promettait que la
pratique de la danse de l'Esprit assurerait le retour des terres
natales, la résurrection des ancêtres, la disparition des colons et
un avenir de paix et de prospérité éternelles. Effrayés par ce
rituel, les colons de la région demandèrent l'aide du gouvernement
fédéral. La police de la réserve soupçonnait le chef sioux Sitting
Bull d'être à l'origine du mouvement. Il fut abattu alors qu'il
tentait de résister à son arrestation. Ses partisans s'enfuirent
alors vers le camp du chef Big Foot. Le 7e régiment
de cavalerie les rattrapa et les plaça dans un campement, près du
ruisseau de Wounded Knee. Le 29 décembre 1890, un coup de feu
fut tiré dans l'enceinte du camp et l'armée riposta. Les soldats
massacrèrent quelques 200 Sioux désarmés, hommes, femmes et
enfants. Ceux qui essayèrent de s'enfuir furent poursuivis et
abattus.
Le
second incident débuta le 27 février 1973, lorsque des
partisans armés de l'American Indian Movement (AIM, Mouvement des
Indiens américains) s'emparèrent de Wounded Knee en exigeant qu'une
enquête soit faite par le Sénat américain sur les problèmes des
Indiens. Des policiers fédéraux furent envoyés et, au cours de
l'échange de coups de feu qui suivit, deux Indiens furent tués. Le
siège prit cependant fin soixante jours plus tard, lorsque les
Indiens reçurent l'assurance que leurs revendications seraient prises
en considération. Après une entrevue à la Maison-Blanche et la
promesse d'une seconde réunion, les Indiens furent informés que
toute plainte concernant l'application des traités devait être
adressée au Congrès. Aucune autre réunion n'eut lieu.
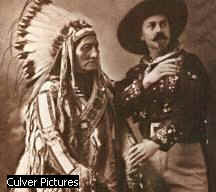 Buffalo
Bill
(1846-1917), aventurier américain, qui s'illustra lors de combats
menés contre les Indiens. Au début de la guerre de Sécession, en
1861, William Frederick Cody fut éclaireur et guide pour l'armée de
l'Union. En 1863, il s'enrôla dans la septième cavalerie du Kansas.
À la fin de la guerre en 1865, il traita avec les chemins de fer
Kansas Pacific Railroad pour fournir de la viande de bison aux
ouvriers de la ligne. On dit qu'il tua plus de 4 000 bisons
en moins de dix-huit mois, ce qui lui valut le surnom de « Buffalo
Bill ». Il participa aussi à la guerre contre les Sioux sous
le commandement du général Custer (1868-1876) et s'attacha à
défendre l'idée de la destruction massive des bisons, ce qui allait
priver les Amérindiens de tous moyens de subsistance. Buffalo
Bill
(1846-1917), aventurier américain, qui s'illustra lors de combats
menés contre les Indiens. Au début de la guerre de Sécession, en
1861, William Frederick Cody fut éclaireur et guide pour l'armée de
l'Union. En 1863, il s'enrôla dans la septième cavalerie du Kansas.
À la fin de la guerre en 1865, il traita avec les chemins de fer
Kansas Pacific Railroad pour fournir de la viande de bison aux
ouvriers de la ligne. On dit qu'il tua plus de 4 000 bisons
en moins de dix-huit mois, ce qui lui valut le surnom de « Buffalo
Bill ». Il participa aussi à la guerre contre les Sioux sous
le commandement du général Custer (1868-1876) et s'attacha à
défendre l'idée de la destruction massive des bisons, ce qui allait
priver les Amérindiens de tous moyens de subsistance.
En
1883, Buffalo Bill, que le romancier Ned Buntline avait contribué à
populariser, renoua avec la tradition familiale et créa son propre
cirque, le Wild West Show, dont le spectacle relatant la vie dans les
prairies fut joué en Europe et aux États-Unis pendant près de vingt
ans.

Missouri
(rivière),
rivière du centre des États-Unis, principal affluent du Mississippi,
d’une longueur de 4 370 km. Son bassin est d’environ
1 400 000 km2.
Le Missouri est formé par la confluence de la Jefferson, de la
Gallatin et de la Madison à Three Forks, dans le sud-ouest du
Montana. Il s’écoule vers le nord en contournant la principale
chaîne des Montagnes rocheuses puis, après avoir traversé une gorge
de 360 m portant le nom de Gates of the Mountains, bifurque vers
le nord-est pour atteindre Fort Benton, dans le Montana, limite de la
navigation. À partir de Fort Benton, la rivière se dirige vers l’est
et est rejointe par la Milk River puis par la Yellowstone. Le Missouri
s’écoule ensuite principalement vers le sud-est, traverse le Dakota
du Nord et le Dakota du Sud jusqu’à Sioux City, dans l’Iowa, où
il bifurque vers le sud pour former la frontière entre le Nebraska et
le Kansas à l’ouest, et l’Iowa et le Missouri à l’est. Il
reçoit les eaux de la Platte River près d’Omaha, dans le Nebraska,
et celles du Kansas à Kansas City, dans l’État du Missouri. Après
ce confluent, le Missouri décrit un coude vers l’est et traverse l’État
du Missouri. À 25 km environ en amont de Saint Louis, il se
jette dans le cours du Mississippi. Depuis 1944, une série de
barrages et d’écluses construits sur la rivière régulent son
débit. En 1993 cependant, de fortes pluies ont provoqué d’importantes
inondations. Les principales villes situées sur la rivière sont
Bismarck, Sioux City, Omaha, Council Bluffs, Saint Joseph, Atchison,
Leavenworth et Kansas City.
1.
PRÉSENTATION
Yellowstone
National Park,
le plus ancien des parcs nationaux des États-Unis et du monde, situé
principalement dans le nord-ouest du Wyoming, aux frontières sud-ouest
du Montana et est de l’Idaho. Créé en 1872, il couvre une superficie
de 8 983 km2.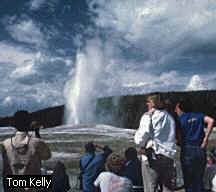
2.
SITUATION
ET CARACTÉRISTIQUES
Situé au
cœur des montagnes Rocheuses, à une altitude moyenne de
2 450 m, sur un large plateau volcanique entouré de hautes
chaînes de montagnes, le parc national de Yellowstone est célèbre
pour ses geysers spectaculaires, ses sources d’eaux chaudes, ses
fumerolles, ses cascades et ses canyons. Il est traversé du sud au nord
par la rivière Yellowstone, dont le cours forme en s’élargissant le
lac Yellowstone, puis s’écoule entre les parois hautes de 335 m
du fameux Grand Canyon de Yellowstone, franchissant deux chutes
spectaculaires de 34 et 95 m.
3.
CURIOSITÉS
GÉOLOGIQUES : GEYSERS ET SOURCES CHAUDES
Avec plus
de 3 000 geysers et 10 000 sources chaudes, le
Yellowstone National Park est la plus grande concentration d’un tel
phénomène au monde (il abriterait plus de la moitié des geysers
connus). Old Faithful (« le Vieux Fidèle »), le plus
célèbre de ces geysers, jaillit pendant environ quatre minutes, à
intervalles de 37 à 93 minutes, en une colonne de vapeur et d’eau
chaude qui peut s’élever à 52 m d’altitude, expulsant à
chaque éruption de 38 000 à 45 000 litres d’eau.
Parmi les autres geysers, Giant (« le Géant »), le plus
haut, fait éruption à intervalles irréguliers, et propulse une
colonne d’eau haute de plus de 61 m ; Giantess (« la
Géante »), lui, jaillit durant plus de quatre heures, mais
seulement deux fois par an environ.
Les
sources d’eaux chaudes du parc sont encore plus nombreuses que les
geysers. Les minéraux présents dans les eaux de certaines d’entre
elles se sont déposés en concrétions sur le sol environnant, formant
des cônes et des terrasses. L’exemple le plus saisissant est le site
de Mammoth Hot Springs, où se sont formées des terrasses hautes de
90 m. L’eau chaude qui s’accumule sur ces terrasses forme des
bassins au fond desquels prospère une algue qui colore leurs eaux. Les
volcans de boue sont également nombreux dans le parc. Ce sont des
monticules formés par de l’eau chaude mélangée à de la fine
matière rocheuse sortie de terre. Tower Falls (40 m), le Golden
Gate Canyon et la falaise d’obsidienne, formation volcanique de
50 m de haut, comptent au nombre des grands sites du parc.
4.
UNE FAUNE
ABONDANTE ET PROTÉGÉE
Site
géologique, le Yellowstone National Park constitue aussi l’une des
plus grandes réserves zoologiques du monde. De nombreuses espèces de
mammifères y évoluent, comme le grizzli, l’élan, l’antilope, le
wapiti, le cerf-milet, le coyote, l’orignal, le bison, le mouflon, le
lynx, la loutre et le loup gris (réintroduit en 1995), dont certaines
ne doivent d’avoir survécu qu’à la création du parc. Plus de deux
cents espèces d’oiseaux, dont l’aigle, le pélican et le cygne
trompette, y ont été recensées. Les vastes forêts de conifères, qui
couvrent la plus grande partie du parc, fournissent à la faune un
habitat protégé.
Comme tous les grands parcs nationaux des États-Unis
— qui accueillent aujourd’hui au total 270 millions de
visiteurs par an (1994) et devraient en recevoir près de
500 millions en 2010 —, Yellowstone connaît un problème de
surfréquentation, qui menace son écosystème et ses ressources
naturelles, ainsi que la survie de certaines espèces, en particulier le
grizzli.
1.
PRÉSENTATION
parcs
nationaux et réserves naturelles,
zones sélectionnées par des gouvernements ou des organisations
privées dans le but de les protéger contre tout dommage ou toute
dégradation dus à l’Homme. Ces zones sont choisies pour leur beauté
exceptionnelle, pour leur intérêt scientifique ou pour le rôle qu’elles
jouent dans l’héritage culturel d’un pays, et souvent également
pour offrir des infrastructures de loisirs à la population.

Le Grand Canyon National Park, autour du canyon du
Colorado, est l'un des parcs nationaux les plus fréquentés du monde.
2.
LES
PREMIERS PARCS NATIONAUX
L’idée
de créer des parcs nationaux et des réserves naturelles s’est
développée au début du XIXe siècle
en réponse à l’industrialisation croissante qui était à l’origine
de dommages à grande échelle et de la dégradation de l’environnement
naturel en Europe et en Amérique du Nord. De nombreux pays densément
peuplés disposaient déjà de parcs urbains et de jardins publics (voir
Jardins, histoire des), et certaines zones rurales constituaient par
ailleurs depuis longtemps des réserves de chasse ou des domaines
privés pour les familles royales et les nobles. Pourtant, dans la
plupart des régions du monde, l’activité humaine avait un impact
minime sur des territoires immenses et peu peuplés ou constituant des
zones naturelles intactes, telles que les Grandes Plaines d’Amérique
du Nord, le bassin amazonien, les forêts de l’Afrique subsaharienne
ou le Bush australien. Ces territoires ne semblaient pas devoir
bénéficier d’une protection spéciale puisque la plupart d’entre
eux étaient toujours inaccessibles ou inhospitaliers pour l’Homme.
Le Yellowstone
National Park, créé en 1872 et s’étendant sur une partie des
États du Montana, du Wyoming et de l’Idaho, est considéré comme le
plus ancien parc national du monde. Toutefois, le terme de « parc
national » ne fut employé pour la première fois qu’en 1879
pour désigner le Royal National Park créé en Nouvelle Galles du Sud
(Australie). Le concept de parc national s’étendit ensuite au Canada
et à la Nouvelle-Zélande pendant les années 1880, à l’Europe au
début du XXe siècle
avec un parc en Suède ; des parcs similaires virent ensuite le
jour au Japon, au Mexique, en URSS et dans de nombreuses colonies
britanniques durant les années 1930, puis en Grande-Bretagne, en France
et dans d’autres pays d’Europe pendant les années 1950 et 1960. En
France, le premier parc national, celui de la Vanoise, fut créé en
1963, suivi de parcs naturels régionaux et de réserves naturelles.
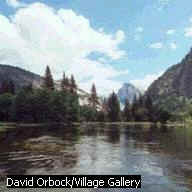 Depuis
lors, bien d’autres ont été créés, notamment en Afrique, en Inde,
au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique, de
nombreux pays possèdent aujourd’hui des parcs nationaux ;
ainsi, le quart de la superficie de la Tanzanie est consacré à des
réserves naturelles, avec notamment le parc du Serengeti
(13 000 km2);
le parc national du Tsavo, au Kenya, est l’un des plus grands du monde
(21 000 km2).
Voir aussi Patrimoine mondial. Depuis
lors, bien d’autres ont été créés, notamment en Afrique, en Inde,
au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique, de
nombreux pays possèdent aujourd’hui des parcs nationaux ;
ainsi, le quart de la superficie de la Tanzanie est consacré à des
réserves naturelles, avec notamment le parc du Serengeti
(13 000 km2);
le parc national du Tsavo, au Kenya, est l’un des plus grands du monde
(21 000 km2).
Voir aussi Patrimoine mondial.
Situé dans la Sierra Nevada, en Californie, ce parc
national de 3 081 km 2
correspond au site de la haute vallée de Merced et de Yosemite. Il
est réputé pour ses forêts de séquoias, ses hautes montagnes de
granite et leurs escarpements spectaculaires, ainsi que pour ses
cascades grandioses.
3.
LES PARCS
NATIONAUX AUJOURD’HUI
Outre leur
fonction initiale qui consistait à préserver des paysages et à offrir
des lieux de loisirs publics, de nombreux parcs ont été créés dans
le but de protéger des espèces menacées et d’encourager la
recherche scientifique. Ils peuvent par conséquent être considérés
comme des réserves naturelles, une appellation qui concerne un
ensemble très varié de zones dans lesquelles des animaux et des
plantes rares ou des écosystèmes particuliers sont protégés et
étudiés. La chasse, la cueillette, le bruit sont limités ou interdits
et l’accès du public est strictement contrôlé. Ces zones peuvent se
trouver à l’intérieur de parcs nationaux — la Réserve de
tigres de Kanha, à l’intérieur du parc national de Kanha dans le
nord de l’Inde, par exemple — et sont en général plus petites
que la plupart des parcs nationaux.

La forêt du Sequoia National Park, en Californie, est
réputée pour ses séquoias géants, dont certains dépassent
100 m de hauteur.
Les
parcs nationaux sont le plus souvent détenus et gérés par l’État.
Certaines réserves naturelles, notamment les réserves naturelles
nationales, sont gérées par des organismes gouvernementaux ; de
nombreuses réserves sont dirigées par des fondations nationales, des
associations pour la protection des animaux ou d’autres organismes
bénévoles.
La plupart
des parcs nationaux et réserves naturelles sont confrontés aux
exigences contradictoires de la conservation et des loisirs ; du
simple fait de leur nombre, les visiteurs risquent d’endommager
involontairement les paysages ou de mettre en péril la flore et la
faune que les parcs étaient censés protéger. Face à cette menace,
certaines parties des parcs nationaux ont été fermées au public en
même temps qu’était limité le nombre de visiteurs autorisés à
pénétrer dans les zones devenues fragiles. Des pistes ou des routes
spéciales ont été aménagées, comme dans plusieurs parcs nationaux
africains, et la présence d’un guide accompagnateur, sur des circuits
bien définis a été rendue obligatoire pour visiter certains parcs
nationaux, notamment en Inde.

Avec un front de 5 km et 60 m de haut, le
glacier du Perito Moreno, situé dans le parc national Los Glaciares,
en Patagonie, est le plus célèbre et le plus spectaculaire des
treize glaciers du Champ de Glace Patagon. Sa progression, d'environ
100 m par an vers l'est, est la plus importante du monde. Chaque
année, d'immenses blocs de glace se détachent du glacier et se
déversent avec un bruit assourdissant dans le Lago Argentino,
provoquant d'importantes montées du niveau de l'eau.
La
fonction des parcs nationaux et des réserves naturelles peut devenir
contradictoire avec d’autres usages possibles du terrain et des
ressources, notamment dans les régions relativement isolées et peu
peuplées qui semblent être les plus appropriées aux actions de
préservation. L’armée peut, par exemple, considérer ces zones comme
d’excellents terrains d’entraînement. D’autres zones sont
menacées par l’exploitation commerciale : des parcs nationaux de
Tasmanie et de l’île du Sud en Nouvelle-Zélande ont, par exemple,
été agrandis dans les années 1980 afin de protéger les forêts
tropicales de l’exploitation forestière; les compagnies d’électricité
souhaitent développer des projets hydroélectriques ou construire des
centrales nucléaires, etc. Dans les parcs où l’exploitation des
carrières, des mines, et la production d’électricité ou d’autres
activités à grande échelle sont autorisées, celles-ci sont
contrôlées scrupuleusement et à grands frais afin de réduire la
pollution et la dégradation du paysage.

Au cœur des Alpes du Sud, la cime enneigée du mont
Aspiring domine le parc national du même nom, qui a été inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco en 1986.
Dans de nombreux pays en voie de développement, les
fermiers, les chasseurs ou les chercheurs de minéraux, avides de terres
non cultivées ou de ressources inexploitées, pénètrent dans les
zones protégées. Dans les parcs nationaux africains, par exemple, les
éléphants étaient sérieusement menacés par le braconnage dans les
années 1970 et 1980. Dans le parc national d’Amazonie au Brésil, les
conflits sont fréquents entre les peuples indigènes et les fermiers et
prospecteurs venus de l’extérieur.
La
préservation des sites naturels d’une beauté exceptionnelle,
constituant un patrimoine culturel ou présentant un intérêt
scientifique, est particulièrement problématique dans les pays en voie
de développement. En effet, dans ces pays, contrairement aux nations
industrialisées qui furent les premières à créer des parcs nationaux
et des réserves naturelles, les gouvernements et les groupes de
pression estiment souvent que les projets risquent d’entraver leur
développement ultérieur et qu’ils sont trop coûteux ou
impopulaires. L’Unesco, le Programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUD) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) soutiennent et aident les parcs nationaux et les réserves
naturelles des pays en voie de développement ; de plus, l’Unesco
a inscrit de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles sur la
liste de son patrimoine mondial tant dans les pays développés que dans
les pays en voie de développement. Compte tenu de la croissance
continue des économies et des populations, la création et l’entretien
des parcs nationaux et des réserves naturelles semblent devoir être
tout à la fois de plus en plus nécessaires et de plus en plus
difficiles. Voir aussi Conservation.
4.
LES PARCS
NATIONAUX ET LES RÉSERVES NATURELLES EN FRANCE
Les parcs
nationaux ont été créés en France par une loi de 1961. Ces musées
de la nature sauvage sont chacun divisés en plusieurs zones qui
couvrent, au total, plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Dans la
zone centrale, les activités agricoles et commerciales, la circulation
automobile, la cueillette, la chasse, l’élevage et le bruit sont
strictement réglementés ; des réserves intégrales, très
protégées et à but exclusivement scientifique, peuvent être
constituées à l’intérieur de cette zone centrale. Une zone
périphérique met à la disposition de tous les ressources
scientifiques animales et végétales, l’air pur, le calme et le
silence.
Ces
différentes missions (protection de la flore et de la faune,
développement du tourisme) constituent l’une des difficultés de
gestion des parcs en France aujourd’hui. Les premiers parcs naturels
nationaux furent ceux de la Vanoise et de Port-Cros, créés en 1963.
Depuis, plusieurs autres parcs ont vu le jour : ceux des
Pyrénées, des Cévennes, des Écrins, du Mercantour et de la
Guadeloupe. L’ensemble couvre une superficie d’environ
1,2 million d’hectares, soit 2 p. 100 du territoire
français.

Situé au carrefour des départements de Savoie et
Haute-Savoie, dans les Préalpes françaises, le parc naturel, créé
en 1995, s'étend sur 80 936 ha. Une réserve nationale de
chasse et de faune sauvage y a également été créée.
Les
parcs naturels régionaux ont été créés en 1969 avec le parc d’Armorique.
Ce sont les parcs d’Armorique, du Ballon des Vosges, de Brenne, de
Brière, de Brotonne, de Camargue, de la Chartreuse, de Corse, de la
Forêt d’Orient, des Grands Causses, du Haut-Languedoc, du Haut-Jura,
de la Haute-Vallée de Chevreuse, des Landes de Gascogne, du
Périgord-Limousin, du Livradois-Forez, de Lorraine, du Lubéron, du
Marais du Cotentin et du Bessin, du Marais Poitevin, Val de Sèvre et
Vendée, de la Martinique, du Massif des Bauges, de la Montagne de
Reims, du Morvan, du Nord-Pas-de-Calais, de Normandie-Maine, du Perche,
du Pilat, du Queyras, du Vercors, du Vexin français, des Volcans d’Auvergne
et des Vosges du Nord. Ces témoins de la nature ruralisée couvrent une
superficie totale de 47 000 km2,
soit environ 8 p. 100 du territoire.
Instruments
d’aménagement du territoire s’étendant parfois sur plusieurs
centaines de milliers d’hectares et englobant donc des secteurs
habités, ils doivent préserver et mettre en valeur le patrimoine
naturel, mais aussi le patrimoine humain, en particulier les formes d’habitat
du monde rural.
Les
réserves naturelles ont été créées par des lois de 1930, 1980 et
1989. Souvent de petite taille (quelques dizaines à quelques centaines
d’hectares), elles conservent des milieux écologiques dont la faune,
le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles présentent
une importance particulière. Il existe en France 128 réserves
naturelles.
 
Animal typique des prairies, autrefois très commun,
le bison ne vit plus, à l'état sauvage, que dans les parcs nationaux
du Canada et des États-Unis. C'est un animal migrateur.
Bison,
grand mammifère bovidé sauvage caractérisé par son cou bossu et
son grand collier de fourrure laineuse. Le bison est originaire
d'Eurasie, où il était fréquemment la proie des chasseurs du
Paléolithique. C'est l'un des rares bovidés à être passé d'un
continent à l'autre avant la formation du détroit de Béring à
l'époque préhistorique. Le bison s'est ainsi répandu en Amérique
du Nord, où survivent deux sous-espèces, le bison de plaine et le
bison des bois. Le bison d'Europe, plus grand mais plus léger que le
bison d'Amérique, est presque éteint ; on en trouve encore
quelques-uns dans les parcs naturels et les zoos.
Le
bison d'Amérique est plus grand mammifère terrestre d'Amérique du
Nord, où il est habituellement appelé « buffalo ». Le
bison se caractérise par une bosse située au-dessus des épaules, de
courtes cornes pointues présentes chez les deux sexes, courbées vers
l'extérieur et vers le haut partant des côtés de la tête massive,
et un arrière-train assez mince. Le mâle adulte du bison d'Amérique
du Nord fait environ 2 m de haut au niveau de la bosse et entre
2,5, et 3,5 m de long et il pèse de 850 kg à 1 tonne ;
la femelle est plus petite. La tête, le cou, les pattes de devant, et
la partie avant du corps ont un épais manteau de poils longs et
sombres. La partie arrière du corps est couverte de poils beaucoup
plus courts. Le mâle adulte porte en général une barbe noire
d'environ 30 cm de long.
Les
bisons vivent généralement en groupes, à l'exception des vieux
mâles qui sont solitaires. La plus grande partie de l'année, les
femelles et les jeunes forment de petites bandes avec lesquelles les
mâles immatures peuvent rester. Les mâles adultes ont leur propre
groupe. Les bandes peuvent s'associer au printemps, ou en automne, en
grands troupeaux à la recherche de nourriture ou d'eau. Les
grognements des bisons s'entendent à faible distance. Le beuglement
des mâles en rut, audible à près de 5 km de distance retentit
surtout en période d'accouplement, principalement entre juillet et
septembre, quand les mâles recherchent les femelles et tâchent
d'écarter les rivaux. En période d'accouplement, les mâles ne
s'alimentent pas beaucoup et perdent au moins 90 kg. La gestation
dure de huit à neuf mois et la femelle met au monde un seul petit de
couleur jaune-roux. Après quelques jours, le petit peut se joindre au
troupeau, où il reste avec sa mère jusqu'au printemps suivant.
Jusqu'au
XIXe siècle,
pas moins de 60 millions de bisons vivaient dans les Grandes
Plaines, entre le Mexique et le Canada, et on en trouvait quelques-uns
à l'est du Mississippi. Ils jouaient un rôle primordial dans
l'existence des peuples des Grandes Plaines (voir
Amérindiens), qui mangeaient leur chair, utilisaient leur peau et
leurs os pour en faire des outils ; même les excréments
séchés servaient de combustible. Entre 1830 et 1889, une chasse
acharnée menée par les colons blancs en avait réduit le nombre à
moins de mille. Actuellement, près de trente mille bisons vivent dans
des zones protégées ou dans des ranchs privés et leur effectif
s'est accru de manière importante.

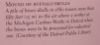
Classification :
les bisons appartiennent à la famille des Bovidés. Le bison de
plaine a pour nom latin Bison bison bison, le bison des bois
celui de B. bison athabasca et le bison d'Europe celui de B. bonasus.

Le parc de Yellowstone, le premier parc national des
États-Unis, créé en 1872, a permis aux wapitis de subsister en
Amérique du Nord. En effet, leur habitat avait été, en grande
partie, détruit par l'avancée vers l'ouest des pionniers.
Aujourd'hui, le plus grand troupeau d'Amérique vit dans ce parc.
Wapiti,
mammifère ruminant, originaire de la partie nord du Nouveau Monde,
entre le sud du Canada et le nord du Mexique, et proche du cerf
élaphe d'Europe, d'Afrique du Nord-Ouest et d'Asie. Sa fourrure est
brun foncé sur la tête et le cou, et gris crème sur le dos et les
flancs. Un adulte mesure 1,5 m de hauteur au garrot et pèse
jusqu'à 340 kg. Les bois sont lisses et atteignent une taille
importante, plus de 1,2 m de long en moyenne chacun. Ils tombent
en mars, commencent à repousser à la fin de l'été jusqu'à
l'automne. Les wapitis pâturent et broutent de l'herbe, des
brindilles et des feuilles.
Le
wapiti était autrefois répandu dans les régions tempérées du
Nouveau Monde, mais l'avancée de la civilisation a réduit son
territoire, et d'immenses troupeaux ont été abattus pour la
consommation et le sport. L'animal est aujourd'hui largement limité
aux zones montagneuses de l'ouest des États-Unis et du Canada. Les
mâles vivent seuls ou en petits groupes séparés du troupeau
principal, pendant la plus grande partie de l'année et ne rejoignent
le troupeau qu'en période d'accouplement. À cette époque, les
mâles luttent pour conquérir les femelles, en accompagnant ces
luttes de leurs brames. À la fin de l'été, certaines populations de
wapitis quittent les plaines et migrent vers les limites supérieures
des forêts de montagne. La femelle donne naissance à un unique faon.
Classification :
le wapiti appartient à la famille des Cervidés. Il a pour nom latin Cervus
elaphus.
|