
1.
PRÉSENTATION
Amérindiens,
peuples indigènes des Amériques, également appelés Indiens d’Amérique.
Le terme d’Indien fut employé la première fois par Christophe Colomb
qui, en abordant le continent et les îles d’Amérique, croyait à
tort avoir atteint les Indes, en Asie. Le terme Amérindien désigne les
peuples originaires d’Amérique du Nord, de Méso-Amérique (Mexique
et Amérique centrale) et d’Amérique du Sud.
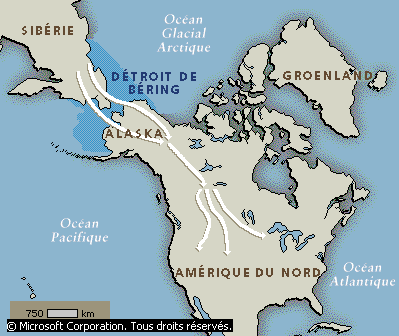
De nombreux anthropologues pensent aujourd'hui que les
Indiens descendent de peuples asiatiques parvenus en Amérique du Nord
par le détroit de Béring.
2.
PREMIERS
HABITANTS
On pense
qu’à l’époque où les premiers colons européens débarquèrent
aux Amériques, le continent comptait plus de 90 millions de
personnes : environ 10 millions habitaient au nord du Mexique
actuel, 30 millions vivaient au Mexique, 11 millions en
Amérique centrale, 445 000 dans les îles des Caraïbes,
30 millions dans la région andine sud-américaine et
9 millions dans le reste de l’Amérique du Sud. Il s’agit d’estimations :
certains avancent des chiffres bien inférieurs.
3.
PEUPLEMENT
ET PREMIÈRES MIGRATIONS
Il est
généralement admis que le peuplement de l’Amérique commença
pendant la période glaciaire qui débuta il y a environ
30 000 ans : des tribus originaires d’Asie, pratiquant
la chasse, la pêche et la cueillette et disposant d’outils de pierre
et d’os typiques de la fin du Paléolithique, franchirent le détroit
de Béring alors émergé et se dispersèrent vers le sud à la
poursuite du gibier. La présence humaine est attestée en
22000 av. J.-C. au Canada (Yukon), en
21000 av. J.-C. au Mexique, en 18000 av. J.-C. au
Pérou. Il semble que le sud du continent fut atteint en
10000 av. J.-C.
Certaines caractéristiques physiques des populations
amérindiennes, d’origine asiatique commune, se différencièrent en
fonction de l’environnement et des habitudes alimentaires.
Vers 7000 av. J.-C. eut lieu un réchauffement
climatique qui modifia les conditions de vie et permit l’apparition
des premières pratiques agricoles. Néanmoins, le mode de vie des
chasseurs-cueilleurs nomades ne disparut pas pour autant et resta même
majoritaire dans certaines régions.
4.
PRINCIPALES
ZONES CULTURELLES
Une zone
culturelle est avant tout une région géographique avec un climat, une
topographie et une population biologique, faune et flore,
caractéristiques. Les êtres humains peuplant la région doivent s’adapter
à cet environnement particulier pour en tirer leurs moyens de
subsistance.
4.1.
L’Amérique
du Nord
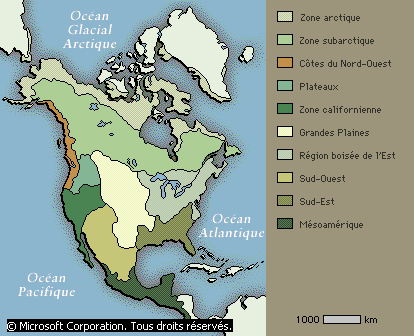 Régions
d'Amérique du Nord
Régions
d'Amérique du Nord
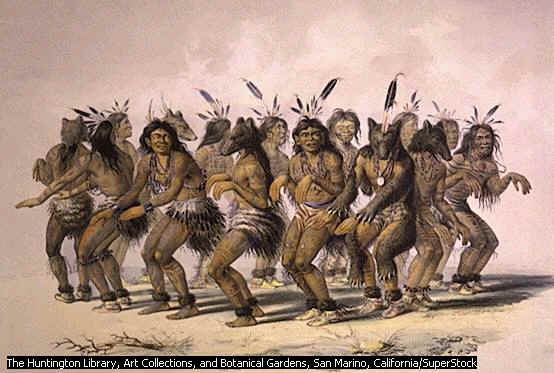
Les Amérindiens mettent en scène leurs mythes
religieux et les processus naturels qui ont lieu sur la terre à
l'aide de danses costumées et de rituels. Cette lithographie
représente la danse de l'ours dans laquelle les membres de la tribu
portent des masques à têtes d'ours et effectuent une danse qui imite
les mouvements de l'animal. Un tel rituel est censé permettre aux
danseurs d'accéder aux pouvoirs des grands esprits et de porter
chance à la tribu.
4.1.1.
Le
Sud-Ouest
Le
Sud-Ouest était peuplé au XVe siècle
de deux types de tribus indiennes : les cultivateurs sédentaires
et les nomades. Les premiers cultivateurs, les Hohokams, produisaient
maïs, haricots et courges dès 300 av. J.-C. : ils sont
les ancêtres des Pimas et Papagos actuels. Les plus célèbres
agriculteurs sont néanmoins les Pueblo, descendants des Anasazis dont
la culture se différencia vers 750 apr. J.-C. : culture
du maïs, haricots, courges, maisons en pierre, poterie. La culture de
ces Indiens Pueblos, dont les Zuni et les Hopi, semble assez préservée
aujourd’hui.
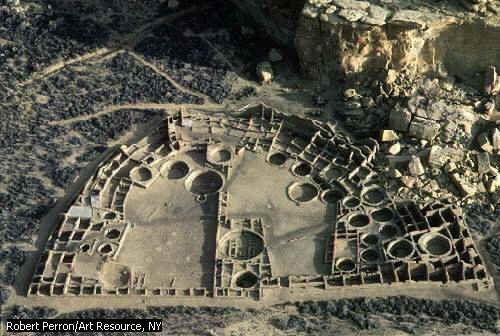
Pueblo Bonito, au Nouveau-Mexique, est un site
archéologique datant des IX
e
et Xe siècles.
À l’ouest
de la zone vivaient les peuples appartenant au groupe linguistique yuman,
dont les Havasupais et les Mojaves. Les nomades, de langue athabasque,
arrivèrent dans le Sud-Ouest au XVe siècle ;
ils apprirent l’agriculture auprès des Pueblos et l’élevage
auprès des Espagnols : ce sont les Navajos et les Apaches.
4.1.2.
Woodlands
À partir
de 1200 av. J.-C., les habitants de cette immense région
boisée commencèrent à cultiver tournesol, amarante, sureau des
marais, chénopode, et la pêche s’accrut le long des régions
côtières.
Après
1000 av. J.-C., la population de la partie atlantique
déclina. Dans le Midwest apparurent les premiers Mound Builders, les
Hopewells, qui construisirent de grands tumulus funéraires pour leurs
chefs ou pour leurs cérémonies religieuses. Cette culture hopewell
disparut vers 400 apr. J.-C. En 750, la « culture du
Mississippi », reposant sur la culture extensive du maïs, se
développa et vit la création de grandes villes : la plus grande
semble avoir été Cahokia, sur le site actuel de Saint Louis, qui
aurait abrité plus de 50 000 personnes.
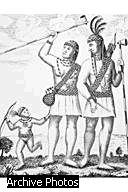 Les
premiers Européens à aborder Terre-Neuve venaient d’Islande, aux
alentours de l’an mille. La colonisation de la région par les
Européens ne débuta qu’au XVIIe siècle
et ne rencontra qu’une faible résistance, les épidémies importées
de l’Ancien Monde ayant décimé les Indiens de la région.
Les
premiers Européens à aborder Terre-Neuve venaient d’Islande, aux
alentours de l’an mille. La colonisation de la région par les
Européens ne débuta qu’au XVIIe siècle
et ne rencontra qu’une faible résistance, les épidémies importées
de l’Ancien Monde ayant décimé les Indiens de la région.
Les Indiens des Woodlands comprennent les Iroquois et
des peuples linguistiquement affiliés aux Algonquins, les Lenapes
(Delaware), les Micmac, les Narragansetts, les Shawnees, les Potawatomis,
les Menominees et les Illinois.
Indiens
Delaware
4.1.3.
Le Sud-Est
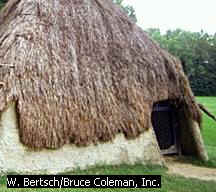 Les
peuples du Sud-Est comprenaient les Cherokees, les Choctaw, les
Chikasaws, les Creek et les Séminoles, connus sous le nom des « Cinq
Nations », qui firent preuve d’une grande faculté d’adaptation
pour résister à l’invasion européenne. Les Natchez, autre peuple du
Sud-Est réputé pour leur construction élaborée de tumulus, furent
anéantis par les Européens au XVIIIe siècle.
Les
peuples du Sud-Est comprenaient les Cherokees, les Choctaw, les
Chikasaws, les Creek et les Séminoles, connus sous le nom des « Cinq
Nations », qui firent preuve d’une grande faculté d’adaptation
pour résister à l’invasion européenne. Les Natchez, autre peuple du
Sud-Est réputé pour leur construction élaborée de tumulus, furent
anéantis par les Européens au XVIIIe siècle.
Habitation
Natchez (reconstitution) =>
4.1.4.
Les
Plaines
La chasse
au bison était la principale source de nourriture des peuples de cette
zone culturelle jusqu’à l’extermination des troupeaux de bisons
sauvages dans les années 1880. La plupart des Indiens des Plaines
vivaient en petites bandes nomades ; certains bâtirent quelques
villages agricoles le long des fleuves des Plaines centrales.
La culture
des Indiens des Plaines est devenue célèbre et est souvent
considérée comme le stéréotype de la culture « indienne » :
les coiffes de longues plumes, le tipi, le calumet de la paix, les
costumes et les danses.
Les premiers Indiens des Plaines étaient les
Pieds-Noirs, des chasseurs de bisons, les Mandan et les Hidatsa, des
peuples agricoles de la région de la rivière Missouri. Puis certaines
tribus Shoshones et Comanches, les Sioux, les Cheyennes et les Arapahos,
migrèrent vers les Plaines à partir de 1450.
4.1.5.
Le Grand
Bassin et la Californie Les
Amérindiens de cette région développèrent un mode de vie archaïque
— chasse rustique au daim et au mouton, pêche (lions de mer,
dauphins, etc.), prise au filet d’oiseaux migrateurs, collecte de
pignons et de baies sauvages — entre 8000 av. J.-C. et
1850 apr. J.-C. Ils bâtirent des villages assez simples, avec
des maisons en chaume, et ne portaient pratiquement pas de vêtements l’été.
La technologie agricole était perfectionnée ; la vannerie devint
même un véritable art.
Cette région comprend les Païutes, les Utes et les
Shoshones, les Klamaths, les Modoc, et les Yuroks, les Pomos, Maidus,
Miwoks, Patwins et Wintuns, et les « tribus des missions ».
4.1.6.
Les
Plateaux

Le
chef Joseph, chef des
Nez-Percés, peuple indien du
nord-est de l'État de l'Oregon, aux États-Unis, était respecté
pour son génie militaire et son éloquence. Extrait de son discours
de reddition : « Certains membres de mon peuple se sont
enfuis dans les montagnes où ils n’ont ni couvertures ni
nourriture. Personne ne sait où ils se trouvent ; ils sont
peut-être en train de mourir de froid. Je veux qu’on m’accorde le
temps de chercher mes enfants, mais combien en trouverai-je ?
Sans doute sont-ils parmi les autres morts. Écoutez-moi bien, je suis
las, et mon cœur est malade et triste. À partir d’aujourd’hui,
je ne me battrai plus jamais. »
Les
Indiens vivaient l’hiver dans des villages composés de maisons rondes
construites en contrebas et campaient l’été dans des maisons en
natte. Ils faisaient sécher d’énormes quantités de saumon pêché
dans les fleuves Columbia, Snake ou Fraser et de camas qui leur
servaient de provisions pour l’hiver et, sur la rive inférieure du
fleuve Columbia, les tribus Wishram et Wasco tenaient une ville de
marché.
Les Indiens des Plateaux comprennent les Nez-Percés,
les Wallawallas, les Yakimas et les Umatillas du groupe linguistique
sahaptian, les Têtes-plates, les Spokanes et les Okanagons du groupe
linguistique salishan, les Cayuse et les Kutenais (sans appartenance
linguistique).
4.1.7.
Zone
subarctique La
moitié est de cette région était autrefois recouverte de glace ;
la pauvreté du sol et la courte période d’été rendaient impossible
toute forme d’agriculture. Les Indiens, nomades, pêchaient et
chassaient l’élan et le caribou.
Les Indiens de la moitié est sont des Algonquiens, qui
comprennent les Cree, les Ojibwés (également appelés Chippewas), les
Montagnais et les Naskapis. La moitié ouest abrite les peuples
appartenant au groupe linguistique athabasque, dont les Chipewyans,
Castors, Kutchins, Ingaliks, Kaskas et Tanana.
4.1.8.
Côtes
nord-ouest du Pacifique
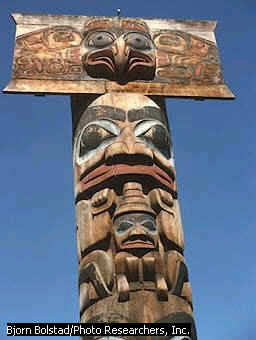 La
richesse et la diversité des ressources alimentaires favorisèrent l’installation
d’une population dense, organisée en grands villages et vivant dans
des maisons de bois abritant une famille étendue, parfois avec des
esclaves, et dirigée par un chef. L’hiver, avaient lieu des
cérémonies appelées potlatchs. Le commerce constituait une activité
importante.
La
richesse et la diversité des ressources alimentaires favorisèrent l’installation
d’une population dense, organisée en grands villages et vivant dans
des maisons de bois abritant une famille étendue, parfois avec des
esclaves, et dirigée par un chef. L’hiver, avaient lieu des
cérémonies appelées potlatchs. Le commerce constituait une activité
importante.
Cette zone
culturelle fut peuplée vers 3000 av. J.-C., le travail du
bois et l’artisanat en général y atteignirent un haut degré de
sophistication. Les tribus de cette zone sont les Tlingit, Tsimshians,
Haidas, Kwakiutls, Nootkas, Chinook, Salishs, Makahs et Tillamooks.
Ce totem mortuaire est fabriqué par le peuple indien
Haida, qui vit sur les îles de la Reine-Charlotte, au large de la
Colombie-Britannique, au Canada.
4.1.9.
L’Arctique
La
longueur de l’hiver rend impossible toute forme d’agriculture ;
les Inuits ou Eskimos vivent de la pêche et de la chasse.
La région
arctique resta inhabitée jusqu’en 2000 av. J.-C., époque
à laquelle les glaciers commencèrent à fondre. En Alaska, les Inuits
et les Yuits (également appelés Youpiks) développèrent une
technologie ingénieuse pour faire face aux rigueurs du climat et aux
maigres ressources alimentaires. Les Aléoutes n’ont jamais migré de
leur territoire d’origine, les îles Aléoutiennes, depuis
6000 av. J.-C.
4.2.
Amérique
centrale
 Les
sociétés archaïques de chasseurs-cueilleurs se mirent à cultiver des
haricots, courges, potirons et maïs vers 7000 av. J.-C. En
2000 av. J.-C., les Mexicains cultivaient l’amarante, l’avocat,
d’autres fruits et les piments. Ils commencèrent à bâtir des villes
et de 1400 à 400 av. J.-C., la civilisation olmèque, sur la
côte est du Mexique, fut à la tête d’une capitale abritant des
palais, des temples et des monuments construits sur une immense
plate-forme. De 450 à 600, Teotihuacan domina le Mexique, établissant
des relations commerciales avec Monte Albán, centre urbain des
Zapotèques, et les royaumes des Mayas qui s’étaient développés
dans le sud-ouest du pays et avaient élaboré une écriture basée sur
des glyphes.
Les
sociétés archaïques de chasseurs-cueilleurs se mirent à cultiver des
haricots, courges, potirons et maïs vers 7000 av. J.-C. En
2000 av. J.-C., les Mexicains cultivaient l’amarante, l’avocat,
d’autres fruits et les piments. Ils commencèrent à bâtir des villes
et de 1400 à 400 av. J.-C., la civilisation olmèque, sur la
côte est du Mexique, fut à la tête d’une capitale abritant des
palais, des temples et des monuments construits sur une immense
plate-forme. De 450 à 600, Teotihuacan domina le Mexique, établissant
des relations commerciales avec Monte Albán, centre urbain des
Zapotèques, et les royaumes des Mayas qui s’étaient développés
dans le sud-ouest du pays et avaient élaboré une écriture basée sur
des glyphes.
Le talent des sculpteurs olmèques s'illustra
notamment au travers de la réalisation de têtes géantes munies de
nez épatés et de bouches aux coins tirant vers le bas. Les
monolithes, taillés dans des blocs de basalte, offrent un précieux
témoignage de la production artistique de la première civilisation
méso-américaine, qui s'établit dans la région côtière du golfe
du Mexique et qui se développa entre 1500 et 600 av. J.-C.
environ.
 En
1000, dans le centre du Mexique, une nouvelle civilisation — celle
des Toltèques — étendit son empire dans la vallée du Mexique
et à l’intérieur même du territoire maya de Chichén Itzá. Cet
empire s’effondra en 1168. En 1433, la vallée du Mexique dominait à
nouveau la majeure partie du pays à la suite d’une alliance entre
trois royaumes voisins. Cette alliance permit de réunir l’ensemble du
territoire que Montezuma Ier,
roi des Aztèques, ne tarda pas à conquérir au XVe siècle.
L’Empire aztèque prospéra jusqu’en 1519, date à laquelle le
conquistador espagnol Hernán Cortés débarqua dans l’est du Mexique
et marcha sur la capitale aztèque, Tenochtitlan. Des rivalités
internes et une épidémie de variole affaiblirent les Aztèques, que
Cortés soumit en 1521.
En
1000, dans le centre du Mexique, une nouvelle civilisation — celle
des Toltèques — étendit son empire dans la vallée du Mexique
et à l’intérieur même du territoire maya de Chichén Itzá. Cet
empire s’effondra en 1168. En 1433, la vallée du Mexique dominait à
nouveau la majeure partie du pays à la suite d’une alliance entre
trois royaumes voisins. Cette alliance permit de réunir l’ensemble du
territoire que Montezuma Ier,
roi des Aztèques, ne tarda pas à conquérir au XVe siècle.
L’Empire aztèque prospéra jusqu’en 1519, date à laquelle le
conquistador espagnol Hernán Cortés débarqua dans l’est du Mexique
et marcha sur la capitale aztèque, Tenochtitlan. Des rivalités
internes et une épidémie de variole affaiblirent les Aztèques, que
Cortés soumit en 1521.
Unique cité précolombienne édifiée au bord de la
mer, le site exceptionnel de Tulum domine la mer des Caraïbes à
136 km au sud de Cancún, dans l'État de Quintana Roo. Entourée
sur trois côtés de murailles pouvant atteindre cinq mètres
d'épaisseur, cette forteresse toltéco-maya date du classique tardif
(entre le VIII
e
et le XIe siècle)
et a été le premier foyer entièrement urbain de la région
méso-américaine décrit par les Espagnols. Comme la plupart des
sites mayas, celui-ci était polychrome, avec des dominantes de rouge,
de bleu et de blanc, encore visibles sur certaines parois.
À l’époque
des premières conquêtes espagnoles, les peuples du Mexique
comprenaient l’Empire aztèque et de puissants royaumes mixtèques ;
les Tarasques ; les Zapotèques ; les Tlaxcalans ; les
Otomís ; les Totonaques ; les sujets de l’État maya
disparu de Mayapán au Yucatán et un certain nombre d’autres États
mayas, plus petits et préservés, dans le sud ; plusieurs groupes
indépendants dans les régions frontalières, comme les Yaquis, les
Huichols et les Tarahumaras dans le nord du Mexique et les Pipils dans
le sud. Après la conquête, les peuples amérindiens se retrouvèrent
sous la domination de la société hispano-mexicaine et maintenus dans
une condition paysanne.
La zone
culturelle d’Amérique centrale était une région de villages
agricoles cultivant le maïs, les haricots, la courge, l’amarante, et
pratiquant l’élevage qui alimentaient d’importants marchés
urbains. Les cités étaient décorées de sculptures et de peintures
brillantes, illustrant souvent les symboles méso-américains de la
puissance et du savoir : l’aigle, dieu des Cieux ; le
jaguar, dieu de la Terre et le serpent à sonnettes, associé à la
sagesse, à la paix et aux arts de la civilisation.
4.3.
Amérique
du Sud
4.3.1.
Nord de l’Amérique
du Sud et Caraïbes Les
peuples de cette zone vivaient dans de petits États indépendants et
procédaient à un commerce direct avec le Mexique et le Pérou par voie
maritime.
Les royaumes des Chibchas en Colombie étaient réputés
pour la finesse de leurs ornements en or. Dans les Caraïbes, des
groupes plus petits comme les Mískitos au Nicaragua, les Cunas au
Panamá et les peuples arawak et caribes des îles Caraïbes cultivaient
et pêchaient autour de leurs villages ; les Caribes peuplaient
également le littoral du Venezuela. Ces peuples menaient une vie plus
simple que les populations du nord des Andes.
4.3.2.
Centre et
sud des Andes
De 900 à
300 av. J.-C., une civilisation, concentrée dans la ville de
montagne de Chavín de Huantar, rayonna dans le nord du Pérou. Sa
religion avait pour symboles l’aigle, le jaguar, le serpent
(vraisemblablement un anaconda) et le caïman, symbole de l’eau et de
la fertilité des plantes. Vers 300 av. J.-C., la civilisation
de Mochica fit son apparition sur la côte nord du Pérou, celle de
Nazca sur la côte sud. Toutes deux construisirent d’immenses
systèmes d’irrigation, des villes et des temples tout en procédant
à un commerce intensif, dont l’exportation de céramiques.

Ce couteau cérémoniel en or incrusté de turquoises,
provient de la culture Chimú, particulièrement réputée pour ses
travaux d'orfèvrerie. Il représente le roi-dieu Nam-Lap (de la
dynastie Lambayeque) et utilise la technique du repoussé consistant
à donner du relief au métal. Il est conservé au Musée national de
Lima.
En 600 apr. J.-C., deux nouvelles puissantes
civilisations émergèrent au Pérou : les Huaris dans le centre
des Andes et les Tiahuanacus, plus au sud, sur le lac Titicaca, qui ne
vécurent que quelques siècles ; après 1000, d’autres
civilisations se développèrent, dont celle des Chimú dans le nord du
pays. L’ensemble du Pérou fut finalement colonisé par une
civilisation apparue dans le centre des Andes, à Cuzco ; il s’agissait
des Quechuas, régis par le peuple des Incas. L’empereur inca de l’époque,
Pachacuti Inca Yupanqui, entama l’expansion de son empire au XVe siècle.
En 1525, celui-ci s’étendait de l’Équateur jusqu’au Chili et en
Argentine. Lorsque le conquistador espagnol Francisco Pizarro débarqua
au Pérou, il ne lui fut pas difficile de conquérir l’Empire inca
dévasté par la guerre civile.
4.3.3.
L’Amazonie
Parmi
les nombreux petits groupes de cette zone culturelle peuplée vers
3000 av. J.-C., citons les Makiritares, Yanomamos, Mundurucus,
Tupinambas, Shipibos et Cayapós. Les familles linguistiques arawak et
caraïbe — parents linguistiques des peuples caraïbes —
vivaient également dans la région nord de l’Amazonie. Les peuples de
l’Amazonie ont préservé une grande part de leur mode de vie
traditionnel mais assistent aujourd’hui à la destruction progressive
de leur territoire par l’élevage, l’agriculture, l’exploitation
du bois et les mines.
4.3.4.
Extrémité
de l’Amérique du Sud Citons
les peuples agricoles comme les Mapuche, vivant sur les terres
cultivables, les peuples de chasseurs comme les Tehuelches vivant dans
la partie de la pampa impropre à l’agriculture, ou plus au sud
encore, près du détroit de Magellan, les peuples Ona, Yahgan et
Alacaluf, se nourrissaient principalement de poissons et de crustacés
tout en chassant les phoques et les lions de mer. Ces peuples nomades
vivaient dans de petits wigwams. Les Indiens de cette région ne sont
plus aujourd’hui qu’une minorité.
5.
HISTOIRE
DEPUIS L’ARRIVÉE DES EUROPÉENS
Les
premiers colons européens furent bien accueillis par les Amérindiens.
Conscients d’avoir affaire à des êtres humains, ils les reçurent
comme des membres d’une culture différente de la leur qui était plus
tolérante et respectueuse des rythmes et de l’esprit de la nature.
Territoires
indiens (USA)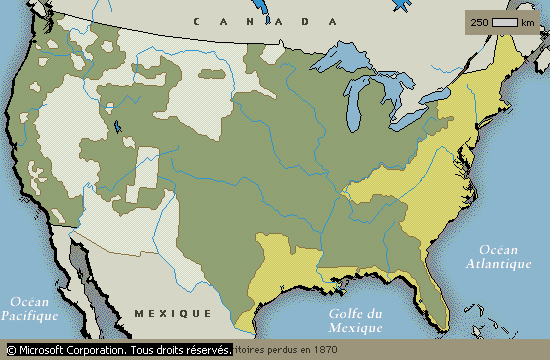
5.1.
Relations
avec le pouvoir colonial
Les
aventuriers et les colons espagnols convoitaient les terres des
Amérindiens tandis que les prêtres et autres religieux en voulaient à
leurs âmes. Finalement, ces deux « missions »
entraînèrent la disparition de nombreux peuples indigènes du
continent américain.
La situation des Amérindiens fut moins dramatique au
Canada où les intérêts économiques français étaient centrés sur
le commerce de la fourrure. Les Indiens constituaient de précieux
fournisseurs de peaux. De plus, les Français cherchaient des alliés
dans la guerre qu’ils menaient contre les Anglais qui, contrairement
aux Français du Canada, s’installèrent en grand nombre sur le
littoral atlantique des États-Unis actuels ; aussi
considéraient-ils en général les Amérindiens comme un obstacle à
leur installation.
5.2.
Le ravage
des épidémies L’impact
des épidémies importées d’Europe (variole, infections pulmonaires,
troubles gastro-intestinaux) fut particulièrement fort en Amérique
latine, où un grand nombre d’individus susceptibles de contracter ces
maladies étaient concentrés dans des villes comme Tenochtitlán et
Cuzco, sans parler des innombrables villes et villages éparpillés dans
la campagne.
Face au déclin de la population indigène, les
Espagnols effectuèrent des raids pour capturer des esclaves en Floride,
pour renflouer la main-d’œuvre. Lorsque cela ne fut plus suffisant,
ils importèrent des Africains de l’Ouest qui vinrent travailler dans
les plantations de canne à sucre et les mines d’argent.
Les Amérindiens qui ne furent pas décimés étaient
assignés, par village ou communauté entière, à un propriétaire
terrien ou à un chef de mine. Ce système dit de l’encomienda
constituait de l’esclavage pur et simple.
Les épidémies firent moins de ravages dans la forêt
canadienne, où la plupart des Indiens vivaient en chasseurs-cueilleurs
nomades. Les peuples agricoles qui vivaient dans des villages, comme les
Hurons au nord du lac Ontario, furent cependant gravement touchés par
des vagues d’épidémie à la suite de l’installation dans la
région de missions jésuites.
5.3.
Guerres et
migrations forcées Les
relations entre les Amérindiens et les colons anglais aux XVIIe
et XVIIIe siècles
furent marquées par une série de guerres particulièrement atroces
remportées par les Anglais. La plupart des Indiens des régions
côtières de l’est partirent à l’ouest dans les Appalaches.
5.4.
Relations
avec les États-Unis La
politique des États-Unis envers les Amérindiens fut, dans les faits,
impitoyable : guerres indiennes, déportations, massacres,
dévastations des territoires et de leurs ressources, spoliation (Indian
Removal Act de mai 1830, Homestead Act de 1862), alliances non
respectées (l’Oklahoma, officiellement territoire des « Cinq
Nations » en 1834, fut ouvert aux colons en 1889 et devint un
État de l’Union en 1907). Les populations indiennes atteignirent
leurs taux les plus bas au début du XXe siècle.
En juin 1924, le Congrès accorda finalement à ces Américains d’origine
la citoyenneté des États-Unis.
5.5.
Amérindiens
dans la société américaine contemporaine
En 1990,
le nombre d’Amérindiens, dont les Aléoutes et les Inuits, était de
près de 2 millions, soit 0,8 p. 100 de la population
américaine totale. De nombreuses tribus revendiquent désormais des
territoires et initient diverses actions pour retrouver leurs droits et
leurs terres.
5.6.
Indiens du
Canada Près
de 200 000 Amérindiens occupaient le territoire actuel du
Canada lorsque les premiers Européens débarquèrent. Ces populations
déclinèrent au cours du XIXe siècle,
et les Amérindiens représentent aujourd’hui environ
2 p. 100 de la population canadienne et appartiennent
principalement au groupe linguistique algonquien. Les autres familles
linguistiques représentées au Canada sont l’iroquois, le salishen, l’athabasque
et l’inuit (eskimo). Les Indiens sont divisés en 600 groupes ou
bandes. Un projet fut instauré en 1991 pour la création d’une
région d’une superficie d’environ 2 millions de km2
dans les Territoires du Nord-Ouest, appelée Nunavut (« notre
terre » en inuktitut), et dont l’administration sera confiée
aux Inuits en 1999.
5.7.
Indiens d’Amérique
latine
La
population indienne d’Amérique latine, estimée à
26,3 millions, dont 24 millions en Bolivie, en Équateur, au
Guatemala, au Mexique et au Pérou, se trouve dans une pauvreté
extrême, occupant des zones rurales isolées où elle tente de survivre
en travaillant la terre. Les paysans indiens représentent
60 p. 100 de la population totale de Bolivie et du Guatemala.
L’Uruguay est le seul pays d’Amérique latine dont la population
indigène a totalement disparu. La majorité des Latino-Américains sont
des « mestizos » (métis), issus de lignages amérindiens
et européens.
Seulement
1,5 p. 100 de la population totale indienne d’Amérique
latine est considérée comme tribale et elle est principalement
regroupée dans les régions excentrées du bassin de l’Amazonie où
elle vit de la chasse, de la pêche et de la culture du manioc et d’autres
racines.
La plus
grande tribu brésilienne non acculturée est celle des Yanomamos, qui
compte plus de 16 000 individus.
La population indigène totale d’Amérique latine
comprend un peu plus de 400 groupes amérindiens distincts, avec
leurs propres langues et dialectes.
Les populations indiennes et métisses, souvent pauvres
et tenues à l’écart des plus hautes sphères du gouvernement et de
la société latino-américaine, se sont parfois réfugiées dans le
radicalisme politique. Les gouvernements se sont vus dans l’obligation
de prendre des mesures de répression contre les populations indigènes
considérées comme des foyers de subversion, comme le Sentier lumineux
au Pérou, ou les zapatistes du chiapas au Mexique.
.

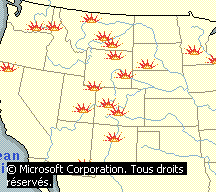 1.
PRÉSENTATION
indiennes,
guerres,
nom donné aux conflits armés entre les Indiens autochtones et les
Européens, au cours de la période d’exploration et de colonisation
européenne. Ces guerres furent épisodiques et localisées.
1.
PRÉSENTATION
indiennes,
guerres,
nom donné aux conflits armés entre les Indiens autochtones et les
Européens, au cours de la période d’exploration et de colonisation
européenne. Ces guerres furent épisodiques et localisées.
2.
PÉRIODE
COLONIALE
Les
premiers contacts entre les colons européens et les autochtones furent
en général pacifiques et leurs relations surtout commerciales. Les
tensions et conflits étaient le plus souvent résolus par la
négociation de traités. Cependant, dès la première moitié du XVIIe siècle,
les Indiens furent expulsés par les colons anglais, qui avaient besoin
de leurs terres pour s’installer. La guerre avec les Indiens de
Nouvelle-Angleterre fut évitée jusqu’en 1637 ; la guerre des
Péquots s’acheva alors par l’extermination presque totale de cette
tribu. Il y eut d’autres conflits entre les Anglais et les tribus
indiennes : avec les Naragansetts en 1643-1645 puis avec les
Wampanoags. Les causes en étaient complexes, chaque côté accusant l’autre
de violations des accords.
Tant que l’Espagne et la France furent présentes en
Amérique du Nord, les différentes tribus eurent la possibilité de s’allier
avec elles pour repousser les incursions britanniques sur leur
territoire. Cependant, la défaite des Français devant les Anglais
(1763) laissa ces tribus plus exposées que jamais à la puissance
britannique. Cette même année, Pontiac, chef des Ottawas, prit la
tête d’une confédération des tribus du bassin de l’Ohio et des
Grands Lacs pour tenter de chasser les Britanniques de la région.
Lorsque la France dut signer la paix avec la Grande-Bretagne, il resta
seul et fut vaincu.
Au Sud, lorsque les premiers colons s’installèrent en
Virginie, les tribus locales, sous l’autorité du chef Powhatan,
furent d’abord amicales. Cependant, les Européens affirmèrent leur
intention d’étendre leur colonie sur les terrains des autochtones. Le
22 mars 1622, les Indiens attaquèrent et tuèrent environ
350 colons. Ceux qui avaient survécu se vengèrent
impitoyablement. La décennie qui suivit fut une période de guerre
continue, suivie d’une paix fragile. Le 18 avril 1644, une autre
attaque faillit détruire la jeune colonie qui compta presque
500 tués. La guerre s’acheva en 1646, lorsque le gouverneur, sir
William Berkeley, réussit à capturer le chef indien.
L’expansion anglaise continua le long des rivières de
Virginie jusqu’en 1675-1676, quand éclata la guerre indienne
associée à la rébellion de Bacon. Les Indiens furent vaincus et les
tribus de la côte ne regagnèrent jamais leur ancien pouvoir. En
revanche, dans l’intérieur, les conflits ne s’apaisèrent pas.
Les Français du Québec et de la vallée du Mississippi
livrèrent eux aussi des guerres à leurs voisins indiens, à l’exemple
des Natchez. Dans la colonie néerlandaise de la Nouvelle-Hollande
(actuellement les États de New York et du New Jersey), les
Néerlandais se heurtèrent à plusieurs reprises aux Indiens. En 1655,
les Indiens attaquèrent la Nouvelle-Amsterdam (New York),
déclenchant un conflit qui dura jusqu’en 1664. Au cours de cette
période, les Néerlandais assujettirent la plupart des tribus des
Algonquins.
3.
PÉRIODE
RÉVOLUTIONNAIRE
Lorsque
débuta la guerre de l’Indépendance américaine, le gouvernement
britannique et les révolutionnaires s’efforcèrent de préserver la
neutralité des populations autochtones. Cependant, les deux adversaires
se mirent bientôt à recruter des alliés parmi les nations indiennes.
Dans le Sud, les Cherokees, les Choctaw et les Creek, qui soutenaient la
cause britannique, furent écrasés par les Américains et leurs
nouveaux alliés, les Espagnols.
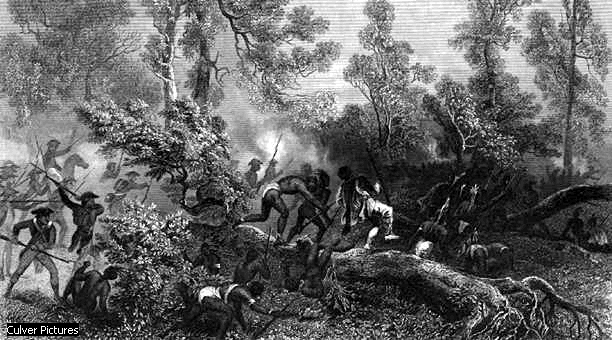
En 1794, sous la conduite du lieutenant William Henry
Harrison, les colons américains remportent sur le site dit de
Fallen
Timbers
(sur lequel se situe actuellement la ville de Toledo dans
l'Ohio) une bataille décisive contre les tribus indiennes animées
par les indiens miamis. Le traité de Greenville négocié l'année
suivante vient entériner l'amputation des territoires consécutive à
cette bataille.
Le
traité de Paris (1783), qui mit fin à la guerre de l’Indépendance
américaine, ne mentionnait pas les Indiens. Les tribus indiennes des
nouveaux territoires à l’ouest des Appalaches se soulevèrent lorsque
les États-Unis tentèrent de les traiter comme des ennemis vaincus. En
1791, l’armée du général de division Arthur St Clair fut défaite
par les Indiens près de fort Wayne (aujourd’hui en Indiana). Les
forces du général Anthony Wayne finirent par écraser la tribu des
Miamis dans l’ancien Nord-Ouest, à la bataille de Fallen Timbers, en
août 1794, ce qui ouvrit la vallée de l’Ohio à la colonisation
américaine.
Dans la période de l’immédiat après-guerre, les
Creek et d’autres nations du Sud-Ouest tentèrent de sauvegarder leur
autonomie par la négociation ou par la guerre, demandant parfois l’aide
des Espagnols. Cependant, l’Espagne hésitait à prendre leur parti
contre la puissance grandissante des États-Unis.
4.
LA GUERRE
DE 1812
Que ce
soit au Nord ou au Sud, les Indiens furent mêlés à la guerre de 1812
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans l’ancien Nord-Ouest,
Tecumseh, un chef Shawnees, et son frère exhortèrent les Indiens à
revenir à leurs traditions passées. William Henry Harrison, gouverneur
du territoire de l’Indiana, averti par Tecumseh, en 1810, qu’il ne
devait pas permettre à la colonisation européenne de s’étendre,
décida en 1811 de détruire le quartier général de ce dernier. Cette
bataille devint un épisode de la guerre générale anglo-américaine et
les Indiens se rangèrent bientôt du côté britannique. Tecumseh fut
tué en octobre 1813 et son rêve d’unité s’éteignit avec lui.
Après sa mort, les tribus Delaware, Miami, Ojibwé (ou Chippewa) et
Wyandot firent la paix avec les Américains.
Dans la zone sud, la guerre débuta par un soulèvement
des Creek à Fort Mims, dans l’Alabama. Les Indiens tuèrent presque
tous les colons du fort, mais ils étaient irrémédiablement divisés
en factions favorables ou opposées à la guerre. Le commandant de la
milice du Tennessee, Andrew Jackson, en profita et, en mars 1814, ses
forces remportèrent une écrasante victoire. Le traité qui suivit mit
un terme à la puissance indienne dans le Bas-Mississippi.
5.
LA
DÉPORTATION DES INDIENS
Le
gouvernement américain usa systématiquement, au début du XIXe siècle,
de la contrainte. C’est ainsi que fut adoptée la loi sur la
déportation des Indiens de 1830, qui se traduisit par le déracinement
de tribus de l’Est du pays et leur installation dans les terres
situées à l’Ouest du Mississippi.
Le refus de certaines tribus à accepter la
transplantation provoqua plusieurs guerres. À la même époque, les
Cherokee furent expulsés de Géorgie, de même que les Creek vivant
encore dans le Mississippi et l’Alabama. En Floride éclata la seconde
guerre Séminole. Lorsque cette période s’acheva, dans les années
1850, il ne restait plus que quelques petits groupes d’Indiens
éparpillés dans la moitié est des États-Unis.
6.
LES
GUERRES À L’OUEST DU MISSISSIPPI
Des
années 1840 aux années 1880, les forces américaines livrèrent de
nombreuses batailles pour ouvrir la voie aux émigrants qui se
dirigeaient vers l’Ouest et pour permettre au gouvernement d’établir
son contrôle sur ce vaste territoire. Le gouvernement fédéral créa
alors, un système de réserves où étaient cantonnés les Indiens.
La ruée vers l’or de 1849 fut un désastre pour les
Indiens du Far West. Les Bannocks et les Shoshones de l’Orégon
et de l’Idaho, les Utes du Nevada et de l’Utah, et les Apaches et
Navajos du Sud-Ouest entreprirent une résistance organisée contre les
spoliations mais finirent par être vaincus et parqués dans des
réserves.
Le conflit majeur eut lieu dans les Grandes Plaines. Les
restes de nombreuses tribus de l’Est s’entassaient dans ce
territoire, ayant de grandes difficultés à s’adapter à un
environnement si différent, tandis que les tribus originaires de la
région s’irritaient de la présence de ces nouveaux venus.
Les Arapahos, les Cheyennes et les Sioux se battirent
farouchement contre l’installation d’émigrants sur leurs
territoires dans les années 1860 et 1870. Parmi tous les combats, la
bataille de Little Big Horn fut la plus célèbre. Le 25 juin
1876, une grande partie du 7e régiment
de cavalerie du lieutenant-colonel George A. Custer fut anéantie
par les Sioux et les Cheyennes, commandés par Sitting Bull et Crazy
Horse. Moins d’un an plus tard cependant, la plupart des Sioux et des
Cheyennes s’étaient rendus. Seuls les Nez-Percés, jusqu’à la fin des années 1870, et Geronimo avec les Apaches continuèrent
 le combat
jusque dans les années 1880. Les guerres indiennes s’achevèrent avec
le massacre de Wounded Knee dans le Dakota du Sud, le 29 décembre
1890, au cours duquel des guerriers, des femmes et des enfants sioux
furent abattus par la cavalerie américaine.
le combat
jusque dans les années 1880. Les guerres indiennes s’achevèrent avec
le massacre de Wounded Knee dans le Dakota du Sud, le 29 décembre
1890, au cours duquel des guerriers, des femmes et des enfants sioux
furent abattus par la cavalerie américaine.