|
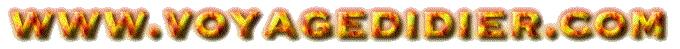
POLYNÉSIE FRANÇAISE:
INFORMATIONS DIVERSES
|

Bougainville, Louis Antoine de
(1729-1811), officier et navigateur français, connu pour son
importante contribution à la science et à la géographie au cours de
la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Bougainville
naquit à Paris où il fit ses études. Il abandonna le droit et
rejoignit l'armée française en 1754. À l'âge de vingt-cinq ans, il
écrivit un traité sur le calcul intégral et fut par la suite nommé
membre de la Royal Society de Londres. Pendant la guerre qui opposa
les Français aux Indiens, il fut l'aide de camp du marquis Louis
Joseph Montcalm de Saint-Véran au Canada, prenant part à la défense
de Ticonderoga et de Québec. Par la suite, Bougainville se battit en
Allemagne pendant la guerre de Sept Ans. En 1764, il tenta de fonder
une colonie française aux Malouines, bientôt abandonnée en raison
des contestations de l'Espagne qui revendiquait ces îles. Il fut le
premier navigateur français à faire le tour du monde (1766-1769).
Parti de Brest, il franchit le détroit de Magellan, traversa l'océan
Pacifique, atteignit Tahiti, les Samoa, les Salomon et Vanuatu. Il fut
accompagné par des naturalistes et des astronomes et fit de
nombreuses découvertes scientifiques et géographiques. Il relata ses
expéditions dans son Voyage autour du monde (2 vol.,
1771-1772).
Pendant
la guerre de l'Indépendance américaine, Bougainville servit dans les
forces françaises d'Amérique conduites par l'officier de marine
français le comte François Joseph Paul de Grasse. Il fut promu
contre-amiral en 1789, et maréchal en 1790. Peu de temps après, il
se retira pour se consacrer à la science.
Bougainville
fut élu membre de l'Institut de France en 1796, année de sa
fondation. Napoléon Ier
le fit sénateur, comte de l'Empire et officier de la Légion
d'honneur. La plus grande des îles Salomon, un détroit de ces îles
et un canal de Vanuatu furent nommés d'après Bougainville, comme le
fut le bougainvillier, plante grimpante tropicale d'Amérique.
Publié à partir de 1771, le Voyage autour du
monde de Bougainville n’est pas seulement la relation du premier
voyage de circumnavigation réalisé par un Français, c’est aussi
une œuvre littéraire de grande qualité. Esprit curieux, marqué par
la pensée philosophique de ce siècle des Lumières, Bougainville a
contribué à l’élaboration du mythe du « bon sauvage »,
à travers, notamment, la description du paradis terrestre qu’il
découvre à Tahiti. Avant d’engager sa traversée du Pacifique, il
navigue dans les eaux d’Amérique du Sud, où il rencontre les
Tehuelche, peuple de Patagonie aujourd’hui disparu, jadis présenté
par les découvreurs européens comme des géants.
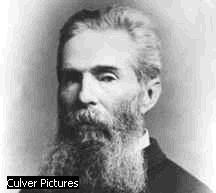
Melville, Herman
(1819-1891), romancier américain, figure marquante de la
littérature de la fin du XIXe siècle,
qui mit en scène, dans des nouvelles et des romans métaphysiques,
le combat millénaire du Bien et du Mal et l'échec des êtres de
bonne volonté. Herman Melville naquit le 1er août
1819, à New York, dans une famille de patriciens. En 1837,
renonçant à un destin tout tracé dans l'enseignement, il
s'embarqua comme mousse sur un navire en partance pour Liverpool.
Après un bref retour aux États-Unis, il s'embarqua à nouveau,
cette fois sur le baleinier Acushnet, en direction des mers
du Sud (1841). Après un voyage de dix-huit mois, il déserta dans
les îles Marquises et y demeura jusqu'à pouvoir s'embarquer pour
Papeete, capitale de Tahiti. Il travailla ensuite comme ouvrier
agricole, s'embarqua pour Honolulu. C'est là qu'il s'engagea sur la
frégate de la marine américaine United States (1843). En
1844, il mit un terme à sa carrière de matelot et commença à
écrire des romans nourris de ses expériences maritimes. Il
participa dès lors à la vie littéraire de Boston et de
New York. C'est en 1850 qu'il décida de s'installer à la
campagne près de Pittsfield, dans le Massachusetts, où il fit la
connaissance de Nathaniel Hawthorne ; ce dernier eut une
influence décisive sur son œuvre et il lui dédia son chef-d'œuvre
Moby Dick (1851). Par la suite, entre 1866 et 1885, Melville
dut revenir à New York occuper un poste d'inspecteur des
douanes afin de subvenir à ses besoins. Il mourut à New York
le 28 septembre 1891, peu après avoir achevé Billy Budd.
1.
PRÉSENTATION
Gauguin,
Paul
(1848-1903), peintre et sculpteur français qui fut l’un des
représentants majeurs de l’école de Pont-Aven avant de s’installer
en Polynésie.
Paul
Gauguin naquit à Paris le 7 juin 1848. Après une enfance
passée en partie à Lima — sa mère était issue de la
noblesse péruvienne —, il s’engagea dans la marine
marchande puis devint agent de change sur les conseils de son
tuteur, Gustave Arosa. Marié et père de famille, il se mit à
peindre durant ses heures de loisirs.
2.
DE L’IMPRESSIONNISME
À L’ÉCOLE DE PONT-AVEN
Devenu
l’ami de Camille Pissarro qui l’encouragea dans la voie de la
peinture et de la sculpture, il exposa pour la première fois au
Salon de 1876 (la Seine au pont d’Iéna, 1875, musée d’Orsay,
Paris). Il fut accepté par le groupe impressionniste et participa
aux expositions de 1880, de 1881, de 1882 et de 1886.
L’exemple
de Cézanne, avec qui il travailla à partir de 1881, mais aussi
ceux de Degas et de Puvis de Chavannes l’incitèrent toutefois à
évoluer vers une facture plus personnelle. Décidant de se
consacrer exclusivement à la peinture à partir de 1883, il partit
pour Rouen puis pour le Danemark où il abandonna femme et enfants
avant de revenir à Paris en 1885. En 1886, lors d’un séjour à
Pont-Aven, en Bretagne, il fit la connaissance du jeune Émile
Bernard avec qui il fonda ce que l’on a appelé l’école de
Pont-Aven, posant les jalons d’une esthétique nouvelle, le cloisonnisme,
qu’il opposait au néo-impressionnisme : inspiré par l’art
primitif et les estampes japonaises, ce style se caractérisait par
le refus de la perspective et l’utilisation de grands aplats de
couleurs saturées et de larges cernes sombres (la Vision après
le sermon, 1888, National Gallery, Édimbourg). Sa rencontre
avec Vincent Van Gogh à Arles en 1888 se solda par un
échec : il réalisa à cette époque une série de toiles
graves et baignées de mysticisme (le Christ jaune, 1889,
Albright-Knox Gallery, Buffalo, État de New York).
3.
GAUGUIN
ET LA POLYNÉSIE
De
retour à Paris, Gauguin décida de quitter l’Occident et la
civilisation industrielle. En 1891, après avoir organisé une vente
publique de ses œuvres, il s’embarqua pour les mers du Sud. Son
premier séjour à Tahiti (1891-1893) fut pour lui une
révélation : séduit par la beauté des indigènes et des
paysages, il se lança dans une production intense où il
privilégia les couleurs vives et denses en aplats, les formes
simplificatrices, tout en abandonnant l’illusion de la perspective
(Sur la plage, 1891 ; Quand te maries-tu ?,
1892, Kunstmuseum, Bâle, et surtout L’esprit des morts veille,
1893). Il composa également de nombreuses sculptures et statuettes,
taillées dans des bois rares, qui s’inspirent des mythes et des
légendes polynésiens (Idole à la coquille, 1893, musée d’Orsay).
Malade,
Gauguin rentra à Paris en 1893. Présentés à la galerie
Durand-Ruel, ses tableaux suscitèrent l’admiration de Bonnard, de
Vuillard et de Maurice Denis, mais l’exposition ne rencontra pas
le succès financier escompté. Il retourna alors à Tahiti en 1895,
y composant certains de ses plus grands chefs-d’œuvre : Nevermore
(1897, Institut Courtauld, Londres), les Seins aux fleurs rouges
(1899, Metropolitan Museum of Art, New York) et surtout le
triptyque D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où
allons-nous ? (1897, Museum of Fine Arts, Boston), qui
reflète ses interrogations sur la mort et que lui-même
considérait comme son testament artistique.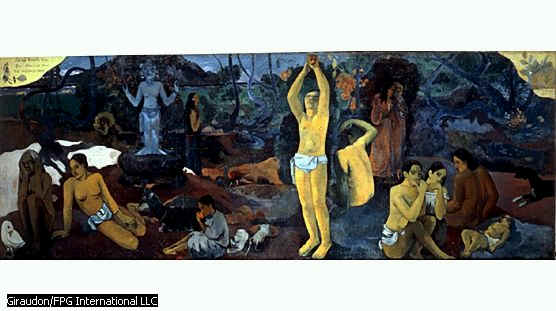
Après
une tentative de suicide, il s’installa en 1901 à Hiva-Oa, aux
îles Marquises, où il peignit notamment Et l’or de leur corps
(1901, musée d’Orsay) et Cavaliers sur la plage (1902,
Folkwang Museum, Essen).
Graveur, dessinateur et sculpteur, Gauguin écrivit
également de nombreux textes dont le dernier fut Avant et
Après, le roman de sa vie. L’exposition de ses œuvres, qui
fut organisée à Paris après sa mort, attira de nombreux artistes,
parmi lesquels Picasso que la force de ses dessins bouleversa et
Matisse que transporta la couleur des dernières toiles. L’art de
Gauguin fut déterminant pour les nabis et la naissance du fauvisme,
mais surtout anticipe d’une génération l’intérêt qu’allaient
porter les expressionnistes allemands et les cubistes au
primitivisme.
ILE
DE PÂQUES

Située à 3 700 km des côtes
chiliennes, l'île de Pâques est célèbre pour ses statues
mégalithiques, au nombre de 500 environ, qui constituent l'un des
problèmes les plus importants de l'anthropologie. Ces statues
immenses, ou moai, sculptées dans la pierre volcanique il
y a plus d'un millénaire et représentant d'impassibles visages
tournant le dos à la mer, peuvent atteindre 21 m. C'est sur
le flanc du volcan Rano Raraku que se trouve le berceau de ces
géants. On en trouve certains à peine commencés, d'autres
presque achevés et qui gisent immobiles dans différentes
positions. Les rangées de moaïs, ou « ahu »
étaient peut-être des autels réservés aux cérémonies.
Everen T. Brown
ART
ET CULTE DES ANCÊTRES
Dans
toute l’Océanie, on trouve un panthéon de dieux créateurs, d’esprits
d’ancêtres déifiés ou de héros légendaires. Si de nombreuses
œuvres d’art sont censées les représenter, l’interprétation
exacte de leur rôle et de leur fonction au sein de la communauté
est souvent complexe. Les sculptures par exemple comportent de
multiples sens cachés. Chacune d’entre elles renvoie à une
histoire spécifique, dont l’interprétation est connue des seuls
initiés. À la variété des messages correspond une complexité
plastique : les sculptures se composent souvent d’une
multitude de figures ajourées et sont ornées de très nombreux
motifs peints. En Mélanésie, elles interviennent directement dans
les cérémonies funéraires. Chez les populations du sud de
Malekula, au Vanuatu, lorsqu’un homme de rang élevé meurt, un
guerrier ou un chef par exemple, son corps est enterré puis exhumé
après putréfaction complète de la chair. Une statue de bois ou de
bambou (rambaramp) censée représenter le défunt est alors
façonnée puis placée à l’intérieur de la « maison des
hommes ». Sa présence doit pouvoir garantir la protection de
l’esprit du mort sur la communauté. Chez les Malangan de
Nouvelle-Irlande, on retrouve le même type de rituel funéraire,
mais les statues sont brûlées ou abandonnées au terme de la
cérémonie.
En Nouvelle-Calédonie, le culte des ancêtres s’illustre dans la
confection de masques spectaculaires. Ceux-ci peuvent représenter
simultanément le chef décédé, le père fondateur du clan et l’esprit
qui guide les esprits des morts dans l’autre monde. La coiffure du
masque est élaborée avec les cheveux des hommes du même clan que
le défunt et surmontée de plumes noires.
Les Polynésiens donnent le nom de mana au
lien qui existe entre création artistique et forces spirituelles.
Il s’agit d’une force active, associée aux ancêtres d’essence
divine et héritée de ces derniers. Cette force est indispensable
à toute entreprise humaine et accompagne les guerriers, les chefs
et les prêtres. Dans toute la Polynésie où ce concept est
répandu, l’œuvre d’art est l’un des principaux moyens
permettant d’invoquer le mana. Le choix des matériaux et l’iconographie
répondent à cette préoccupation, comme en témoignent les
célèbres pétroglyphes (gravures sur pierre) et statues
monumentales de l’île de Pâques. Ces gigantesques têtes ont
été sculptées dans la roche tendre extraite du cratère
volcanique de l'île. Aujourd’hui encore, le contexte rituel qui a
présidé à leur élaboration reste obscur.
Moins spectaculaires mais tout aussi symboliques,
les hei tiki ou pendentifs d’ancêtres, que confectionnent
les Maoris, créent un lien entre les vivants et les morts,
supprimant les distances engendrées par le temps et l’espace. Ils
sont transmis par héritage aux générations suivantes et portés
lors d’événements importants qui peuvent donner lieu à leur
échange comme la ratification d’un traité, d’une alliance, la
célébration d’un mariage ou de funérailles. Généralement en
jade (wai pounamou en langue maorie), ils portent le nom de l’ancêtre
défunt.
En Micronésie la sculpture, influencée par l'art polynésien, est
plus rare ; elle est constituée de petites amulettes, de
proues de pirogues sculptées et de bols incrustés de nacre. De l’île
Nukuoro, toutefois une statue en bois monumentale représentant la
déesse KoKawe nous est néanmoins parvenue. Cela s’explique en
partie par le fait que, bien que située en Micronésie, Nukuoro est
habitée par des populations d’origine polynésienne. La statue de
KoKawe doit être certainement mise en relation avec la tradition
polynésienne de sculpture monumentale, qui a donné naissance aux
statues de l’île de Pâques évoquées précédemment.
On trouve également dans toute la partie
occidentale des îles Carolines de petites figurines
anthropomorphes, utilisées comme fétiches pour protéger les
pirogues du mauvais temps. Les navigateurs les portaient jusqu’à
un cocotier proche du lieu où étaient entreposées les pirogues.
Ils invoquaient alors par des psalmodies les yalulawei,
esprits bienveillants de l’eau, avant d’attacher les fétiches
à la bôme de la pirogue.
À Satawan, atoll de l’archipel des Mortlock dans
les îles Carolines, les esprits des ancêtres protecteurs étaient
matérialisés par des masques portés par des danseurs, unique
manifestation de ce genre connue à ce jour en Micronésie. Le nom
donné aux masques, tapuanu, se compose de deux mots : tapu,
qui signifie « sacré, chargé de mana », et anu,
qui signifie « esprit d’ancêtre ».
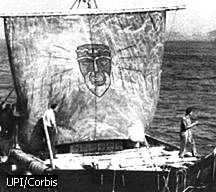
Heyerdahl, Thor (1914- ),
anthropologue et explorateur norvégien, qui tenta de reproduire
d’anciennes expéditions maritimes. Thor Heyerdahl est né à
Larvik.
Cherchant
à prouver que le peuplement des îles du Pacifique résultait
— pour partie du moins — de migrations effectuées
à partir de l’Amérique du Sud, il réussit, avec un
équipage de cinq hommes, à parcourir en 101 jours les
6 920 km qui séparent le port de Callao, au Pérou,
des îles Tuamotou, en Polynésie. Ils avaient pris place à
bord d’un radeau de balsa, le Kon-Tiki, fabriqué sur
le modèle des embarcations traditionnelles des anciens
Péruviens. À la suite de ce succès, Thor Heyerdahl conduisit
d’autres expéditions archéologiques aux îles Galápagos
(1954), puis à l’île de Pâques et dans le Pacifique
oriental (1955-1956), toujours dans le but d’étayer sa
théorie des mouvements migratoires à partir du continent
américain.
À
la fin des années 1960, il appliqua ses théories aux
Égyptiens ; selon lui, ceux-ci auraient pu atteindre l’Amérique
du Sud et fonder les civilisations aztèque et inca, il y a
quatre mille ans. Il s’embarqua à nouveau, sur un bateau en
papyrus cette fois-ci, pour traverser l’Atlantique à partir
de l’Afrique du Nord. La première tentative — en 1969
sur le Ra I — échoua après
4 500 km de navigation. Le Ra II, en 1970,
parvint à rallier l’île de la Barbade après 57 jours
en mer.
Peu
de temps après, Heyerdahl entama un nouveau voyage de près de
10 000 km sur une embarcation en roseaux, le Tigris,
en suivant la voie migratoire que les Sumériens auraient
empruntée à partir de l’Irak pour gagner l’océan Indien.
Cette expédition trouva son terme en mer Rouge, les combats
opposant alors Éthiopiens et Érythréens l’empêchant de
relâcher dans le port de Massaoua.
Thor
Heyerdahl est l’auteur de plusieurs ouvrages : L’Expédition
du Kon-Tiki ; Île de Pâques : l’énigme
dévoilée ; Aku-Aku ; Tigris : à la recherche
de nos origines.
Voir
aussi
Exploration géographique.
1.
PRÉSENTATION
récif corallien, relief sous-marin des mers
chaudes construit par accumulation de madrépores. Encadrant des
zones peu profondes, les récifs coralliens sont formés d'une
accumulation d'exosquelettes calciques de corail, d'algues rouges et
de mollusques. Construits par dépôts successifs donnant un aspect
rocheux, ils s'élèvent de 1 à 100 cm par an et se
développent dans la zone intertropicale, là où la température de
l'eau de surface n'est jamais inférieure à 16 °C et où les
eaux sont suffisamment claires pour laisser passer la lumière.
2.
FORMES
DE VIE
Les récifs coralliens forment des écosystèmes constitués à la
fois de végétaux photosynthétiques et d'organismes consommateurs
(voir écologie). La couche externe d'un récif est
constituée de polypes de coraux vivants. À l'intérieur de ceux-ci
se développent des algues unicellulaires sphériques appelées
zooxanthelles. Un squelette calcique, à la fois vivant et mort,
contenant des algues filamenteuses vertes, se trouve sous ces
polypes et les entoure. Ces algues, avec d'autres végétaux
associés, constituent les producteurs primaires.
Les zooxanthelles photosynthétiques et les algues filamenteuses
vertes transfèrent directement une partie de l'énergie solaire aux
polypes des coraux. Ils se nourrissent également la nuit du
zooplancton qu'ils capturent à l'aide de leurs tentacules ;
ils en retirent des nutriments, en particulier le phosphore, plus
que des calories. Avec la digestion, les coraux libèrent ces
nutriments au bénéfice des algues, qui les leur restituent,
réduisant ainsi la perte de nutriments dans l'eau.
Les poissons herbivores, tels les poissons-papillons bariolés, les
holothuries, les ophiures, ainsi que de nombreuses espèces de
mollusques, se nourrissent d'algues. Cachés dans les innombrables
crevasses du récif, les prédateurs, tels que les petits crabes,
les labres (poissons allongés à épines), les murènes et les
requins ajoutent à la grande variété biologique des récifs
coralliens.
3.
TYPES
DE RÉCIFS
Il existe trois types de récifs coralliens : les récifs
frangeants, les récifs-barrières et les atolls. Les premiers
s'étendent sur une côte non-corallienne. Les récifs-barrières se
situent au large de la côte, dont ils sont séparés par un lagon
ou un chenal. Les atolls (les plus répandus des édifices
annulaires) sont des îles coralliennes formées généralement d'un
récif étroit en forme de fer à cheval et au milieu duquel se
trouve un lagon peu profond.
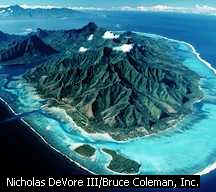
Un récif frangeant est un type de récif corallien
qui s'étend depuis le rivage d'une île ou d'une terre
continentale, sans qu'un bras d'eau ne sépare la terre du récif.
Ce type de récif entoure la majeure partie de l'île polynésienne
de Moorea.
Nicholas DeVore III/Bruce Coleman, Inc.

Un récif corallien peut être séparé de la
côte par une étendue d'eau qui constitue un lagon. Ce type de
récif s'appelle récif-barrière. Il en existe au large de l'île
polynésienne de Moorea.
Jack Fields/Photo Researchers, Inc.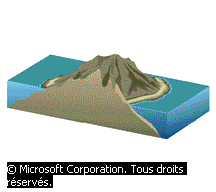
Les récifs sont frangeants lorsqu'ils longent
la côte d'une île ou d'un continent, barrières lorsqu'ils se
forment au large des côtes et annulaires lorsqu'ils isolent un
lagon. On distingue la partie interne de l'atoll (revers), la
partie externe (front) et la partie émergée (platier).
© Microsoft Corporation. Tous droits
réservés.
4.
BLANCHIMENT
CORALLIEN
Les récifs coralliens ont été récemment affectés par le blanchiment,
c'est-à-dire la décoloration ou la perte des zooxanthelles
symbiotiques. En 1979 et en 1980, plusieurs cas apparurent aussi
bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique. Une épidémie se
déclara en 1982 et 1983, touchant les récifs de l'est de
l'Afrique, de l'Indonésie, de la côte ouest de l'Amérique du Sud
et de celle de l'Amérique centrale. Des cas de blanchiment plus
graves et plus destructeurs se déclarèrent de 1986 à 1988,
touchant des régions aussi diverses que Taiwan, Hawaii, les îles
Fidji, l'île de Mayotte et le nord-est de l'Australie (Grande
Barrière).
La raison de cette épidémie n'est pas connue ; on soupçonne
la pollution, le réchauffement global de l'atmosphère et les
rayons ultraviolets. Bien que l'on ne dispose d'aucune preuve
tangible, de récentes découvertes indiquent que la température
inhabituellement élevée des eaux serait à l'origine de ce
phénomène. Les températures maximales permettant la croissance du
corail sont 26 °C et 27 °C. Les températures
supérieures à 29°C peuvent augmenter le taux de photosynthèse
des zooxanthelles symbiotiques, entraînant ainsi de fortes
concentrations de toxines à radicaux libres dans les tissus
coralliens. Les polypes coralliens ainsi stressés peuvent
activement rejeter les zooxanthelles, provoquant ainsi leur
blanchiment.
Les coraux blanchis se régénèrent difficilement ;
plusieurs années sont nécessaires pour qu'un récif s'assainisse
et des cas de blanchiment successifs peuvent être fatals au
corail : sans les zooxanthelles symbiotiques, ils sont
incapables de fabriquer les squelettes de carbonate de calcium qui
constituent la base du récif corallien.
Hormis la pollution de l'eau, certaines actions
anthropiques affectent les édifices coralliens. Ainsi la chasse à
la dynamite, bien qu'interdite, crée des brèches définitives dans
ces édifices. Les essais nucléaires effectués dans les atolls du
Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale ont profondément
affecté les récifs ; toutefois, il faut bien considérer que
les endroits touchés restent très localisés.
Lorsque le corail est affecté, c'est l'ensemble de
l'édifice et des divers habitats écologiques qu'il abrite qui sont
menacés. Les récifs coralliens, qui forment un merveilleux monde
de couleurs et de vie, sont donc parmi les écosystèmes les plus
fragiles au monde.
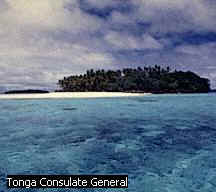
atoll, chapelet circulaire de récifs
coralliens entourant un lagon. La planète compte quelque quatre
cents atolls, situés pour la plupart dans le Pacifique. Le plus
étendu (120 km) est celui de Kwajalein, qui fait partie de
l'archipel Marshall.

perle, concrétion ronde produite par
certains mollusques bivalves et appréciée en joaillerie. Les
perles sont constituées de nacre, substance tapissant les
parois des coquilles des mollusques. La nacre est composée
principalement de cristaux d'aragonite. La perle est sécrétée
par couches successives autour d'un corps étranger venu se
loger dans la cavité du bivalve, un petit grain de sable, par
exemple. La particule « irrite » le mollusque qui
la recouvre de matière nacrée. Les mollusques, tant marins que
d'eau douce, produisent des perles, mais les variétés les plus
précieuses viennent des huîtres perlières du golfe Persique.
Les
perles peuvent avoir différentes formes : hémisphérique,
en forme de poire, cloche ou goutte. Les plus coûteuses sont
sphériques. Les perles sont diversement colorées, les teintes
les plus prisées étant blanc, noir, rose et crème.
Les
pêcheries sont situées dans le golfe de Panamá, aux Antilles,
dans les îles du Pacifique sud et le long des côtes de l'Inde,
du golfe Persique, du Japon, du Mexique et de l'ouest de
l'Amérique centrale, en particulier dans les îles des Perles,
près de la côte du Nicaragua, et en Australie occidentale.
Les
perles de rivière sont produites par des moules d'eau douce
dans différentes régions du monde. La Chine en est le
principal producteur.
Les
perles naturelles rondes sont cultivées avec succès depuis
1920. On introduit dans l'huître perlière un corps étranger
de la taille approximative de la perle souhaitée. Pendant
plusieurs années, l'huître l'enrobe de couches de nacre. Les
perles de culture ne sont pas faciles à distinguer des perles
véritables, si ce n'est par un expert. La technique de
production de perles de culture a été mise au point au Japon
et la culture des perles est une importante industrie japonaise.
Les perles artificielles, entièrement fausses, sont le plus
souvent en verre.

vanillier, liane formant un genre
d'orchidées, qui comprend une centaine d'espèces. Cette liane à
tige cylindrique s'attache à un support par ses racines. Les
fleurs sont grosses, charnues mais de couleur terne.
Seule
une espèce à feuilles verdâtres produit le fruit appelé
vanille. Cette orchidée est originaire d'Amérique centrale, mais
l'essentiel de la production actuelle de vanille provient de
Madagascar et des îles voisines (Comores, Réunion, Seychelles).
La vanille était déjà très appréciée des Aztèques, qui
l'utilisaient pour aromatiser le chocolat. Le fruit, une gousse de
15 à 23 cm, est récolté vert, puis séché. Le séchage
permet de libérer des substances (vanilline et huile odorante),
qui donnent à la vanille son parfum caractéristique.
La
pollinisation de ce vanillier (qui déclenche la fructification)
ne peut se faire que par un insecte spécifique, qui ne vit qu'en
Amérique. Les producteurs de l'océan Indien doivent donc
polliniser chaque fleur de vanillier à la main, pour en obtenir
les précieuses gousses.
Classification :
l'espèce productrice de vanille a pour nom scientifique Vanilla
planifolia.

arbre à pain, arbre tropical de la famille du
mûrier, originaire des îles du Pacifique Sud. Son fruit
constitue une ressource vivrière importante de cette région. Il
a la taille d'un melon, est pourvu d'une écorce épaisse et
renferme une chair blanche amylacée qui, une fois cuite, est un
peu sucrée, de texture douce. Une fois séchée et écrasée, on
peut en faire des biscuits, du pain et des desserts. Les graines,
également comestibles, ont l'aspect et le goût de châtaignes.
L'arbre peut atteindre environ 12 m de haut. Ses feuilles
sont brillantes, longues, découpées, résistantes. Les fleurs
mâles sont disposées sur des chatons jaunes et les femelles sur
des inflorescences épineuses. On fabrique des vêtements à
partir de son écorce, des meubles et des canoës à partir de son
bois léger et tendre. Sa sève est un latex utilisé pour
l'imperméabilisation.
Le
jacquier, dont les fruits comestibles peuvent peser jusqu'à 20 ou
30 kg, est un proche parent de l'arbre à pain.
Classification :
l'arbre à pain appartient à la famille des Moracées. Son nom
latin est Artocarpus altilis. Le jacquier a pour nom latin Artocarpus
integrifolia.
|
retour à la
page du lieu
retour
à la page principale
|