|

1. PRÉSENTATION
Polynésie-Française,
territoire d'outre-mer (TOM) français, situé dans l'océan Pacifique
Sud.
2.
GÉOGRAPHIE
La
Polynésie-Française est composée de cent trente îles, îlots et
atolls regroupés en cinq archipels : îles de la Société,
constituées des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, l'archipel des
Tuamotu, les îles Gambier, les îles Australes et les îles Marquises
(l'île Clipperton, atoll désert au sud de la côte mexicaine, en fait
également partie). S'étendant sur une superficie maritime de près de
5 millions de km², soit la taille de l'Europe, les terres
émergées de Polynésie-Française ne représentent en réalité que
4 200 km².
Objet
depuis plus de deux siècles de tous les fantasmes et de tous les
mythes, la Polynésie a longtemps été une terre d'accueil pour les « Blancs »,
appelés « popa », désireux d'évasion. Ainsi le peintre
Paul Gauguin, le chanteur Jacques Brel, l'explorateur Paul-Émile Victor
ou l'acteur Marlon Brando se sont installés sur ces îles.
Tahiti,
située dans l'archipel de la Société, est l'île phare du territoire
puisqu’elle regroupe plus des deux tiers de la population de la
Polynésie-Française. Sa principale ville, Papeete, en est la capitale
et le principal centre économique.
Le
population est composée à 70 p. 100 de Polynésiens, à
15 p. 100 d'Européens et à 8 p. 100 de Chinois.
3.
ÉCONOMIE
L'agriculture
occupe une place non négligeable dans l'économie de la
Polynésie-Française. Outre les cultures vivrières, composées de
taro, de manioc et de patates douces, la Polynésie produit de la
vanille et du coprah, ainsi que des fruits tropicaux. Malheureusement,
ces cultures souffrent de la concurrence internationale et de
l'éloignement des centres de consommation. Par ailleurs, la culture de
la vanille a considérablement pâti de l'apparition et du
développement de la vanille synthétique. La pêche occupe une place
croissante dans l'économie locale, en particulier depuis que le
territoire mène une politique active pour attirer notamment les
chalutiers japonais. Néanmoins, les retombées de la pêche restent
pour l'instant limitées. La construction et la maintenance navales ne
constituent pas encore des secteurs moteurs de l'industrie
polynésienne. Celle-ci demeure encore pour l'essentiel limitée à la
transformation des produits agricoles, avec en particulier des
brasseries. Une part importante des ressources polynésiennes provient
toutefois de la mer avec les perles noires de Tahiti, renommées et
exportées dans le monde entier. Les ventes de perles noires
procureraient actuellement le tiers des recettes d'exportation du
territoire.
Pendant près de trente-cinq ans, l'économie
polynésienne a largement profité des retombées économiques du Centre
d'expérimentation du Pacifique (CEP) de Mururoa et Fangataufa où la
France a mené ses campagnes d'essais nucléaires. L'image de la
Polynésie a été quelque peu ternie par ces essais, mais leur arrêt
définitif en 1996, après une dernière campagne fort contestée dans
le monde, a engendré sur le territoire une nouvelle source
d'inquiétude. Certes, la France s'est engagée à verser une indemnité
destinée à compenser cet arrêt mais pendant dix ans seulement.
Entre-temps, le défi auquel doit faire face le territoire consiste en
un redéploiement complet de ses activités économiques.
Outre la culture des perles, le principal espoir réside
désormais dans le développement de l'activité touristique. Mais, si
le mythe tahitien reste toujours aussi vivace dans les imaginations, les
chiffres disponibles ne reflètent que modestement cette attirance. Il
est vrai que l'équipement hôtelier local, s'il est de bonne qualité,
pratique des prix peu concurrentiels. De plus, la Polynésie-Française
a pendant longtemps souffert dans la région d'une mauvaise image de
marque liée aux essais nucléaires. On note toutefois, depuis deux ans,
une forte croissance du secteur touristique, puisqu'en 1998 celui-ci
représente plus de 20 p. 100 du PIB, soit une hausse de plus
de 10 p. 100 par rapport aux cinq années précédentes.
L'effet psychologique de l'arrêt des essais a certes pu jouer, mais
c'est surtout la déréglementation aérienne qui, en diminuant les
coûts du transport aérien, a permis d’accroître la clientèle
potentiellement intéressée par la Polynésie. Néanmoins, des
infrastructures adaptées restent encore à développer et à améliorer
afin d’attirer une clientèle plus internationale, en particulier les
Australiens et les Néo-Zélandais qui disposent d'un niveau de vie plus
élevé que celui de la clientèle métropolitaine. Le PIB global de la
Polynésie-Française atteint aujourd’hui 1 760 millions de
dollars et son PIB par habitant environ 8 000 dollars.
4.
HISTOIRE
La
Polynésie n’est peuplée que tardivement en raison de son
éloignement des principaux foyers de peuplement en Océanie. Les îles
de la Société sont les premières îles polynésiennes occupées par
les migrations en provenance de l'ouest de l'Océanie qui deviennent par
la suite le point de départ à l'occupation progressive des autres
archipels polynésiens.
Magellan
est, en 1521, le premier navigateur européen à « découvrir »
quelques îles qui font aujourd'hui partie intégrante de la
Polynésie-Française. Au cours des XVIe
et XVIIe siècles,
les navigateurs Mendena, Quiros, Schouten, Le Maire approchent à
leur tour des rivages polynésiens. Mais c'est à l'Anglais Samuel
Wallis que reste attaché dans la mémoire collective le souvenir de la
découverte de Tahiti en 1767. L'année suivante Bougainville baptise
cette île « la Nouvelle Cythère » en souvenir des fortes
impressions laissées sur l'équipage par les habitantes des lieux. Cook
fait également escale deux fois dans l'île mythique, en 1769 et en
1774.
En 1797, la London Missionary Society (LMS),
d'inspiration calviniste, envoie sur place dix-huit fervents
prosélytes. Cette présence après bien des péripéties est finalement
couronnée de succès en 1815 lorsque l'un des rois de Tahiti, Pomare II,
se convertit au christianisme. L'influence politique de la LMS
s'accroît alors si puissamment qu'elle se taille un véritable royaume
temporel qui exclut d'emblée toute autre obédience religieuse et plus
précisément celle de l'Église catholique romaine.
La présence française résulte paradoxalement de cet
ostracisme. C'est effectivement en cherchant réparation pour les
humiliations subies par son clergé, interdit de séjour, que les
représentants français décident en représailles d'imposer un
protectorat sur Tahiti et sur Moorea. L'amiral Dupetit Thouars force
alors la main à la monarchie tahitienne, en profitant de l'inertie des
Anglais, et ce, en dépit des protestations de leur consul Pritchard.
Les Français élargissent par la suite leur domaine, tant
institutionnellement (passage du statut de protectorat à celui de
colonie en 1877) que géographiquement : aux Marquises et à
Tahiti, déjà sous contrôle français, s'ajoutent les dernières îles
de la Société (1897) et les îles Australes (1900).
Cette
patiente consolidation de la présence française masque en fait la
profonde léthargie économique dans laquelle sombrent ces archipels
polynésiens, même si l'on doit relever, ici ou là, le développement
vite contrarié de la culture du coton, avec l'aide d'une main-d'œuvre
chinoise importée, de la vanille ou du café. Seule l'exploitation du
coprah dans de gigantesques cocoteraies offre alors au territoire un
semblant de dynamisme. Elle permet néanmoins l'émergence d'une petite
bourgeoisie, qui finit par occuper une place clé dans la société
tahitienne.
La Seconde Guerre mondiale sort réellement la
Polynésie-Française de son assoupissement colonial : ralliés
dès 1940 à la France Libre, ceux que l'on appelle alors les
Établissements français d'Océanie (EFO) mettent à la disposition des
Alliés tant leurs ressources humaines, avec la création d'un bataillon
du Pacifique, que leur situation géographique. Les Américains,
profitant de sa position stratégique, aménagent alors un aérodrome
dans l'île de Bora Bora. Du traumatisme laissé par les années de
guerre émerge la conscience d'une identité polynésienne incarnée par
un leader charismatique Pouvanaa a Oopa, qui joue un rôle de premier
ordre entre 1947 et 1977, mobilisant une importante minorité sur des
positions indépendantistes exprimées dès 1958.
En 1960, l'ouverture de l'aéroport international de
Faaa (Tahiti) permet un désenclavement progressif du territoire. Cet
événement précède de quelques années la décision de transférer la
base d'expérimentation nucléaire du Sahara en Polynésie-Française.
Pour les besoins du CEP (Centre d'expérimentation nucléaire), les
atolls inhabités et relativement isolés de Mururoa et Fangataufa sont
réquisitionnés pour les besoins des essais qui se sont poursuivis au
rythme de quatre à cinq par an, dans l'atmosphère jusqu'en 1975, puis
souterrains. En 1996, après une ultime série d'essais, le gouvernement
français met définitivement fin aux expérimentations.
À la suite de la pression croissante exercée par le
parti indépendantiste, un nouveau statut est accordé en 1984 au
territoire qui bénéficie d'une plus large autonomie interne. Il est
aujourd’hui doté d'une Assemblée territoriale de quarante et un
membres qui élisent un Conseil des ministres ainsi qu'un président,
tandis que la France est représentée par un délégué du gouvernement
notamment chargé des questions de maintien de l'ordre. Le président du
territoire est depuis 1991 Gaston Flosse, leader du Tahoeraa Huiraatira
(parti favorable au maintien de la Polynésie-Française au sein de la
République). Aux dernières élections de mai 1996, le parti
indépendantiste d'Oscar Temaru (le Tavini Huiraatira) arrive en seconde
position avec plus de 10 p. 100 des voix. (voir Dom-Tom)
Superficie terrestre : 4 200 km2 ;
superficie maritime : 5 030 000 km² ;
population (estimation 1998) : 237 844 habitants.
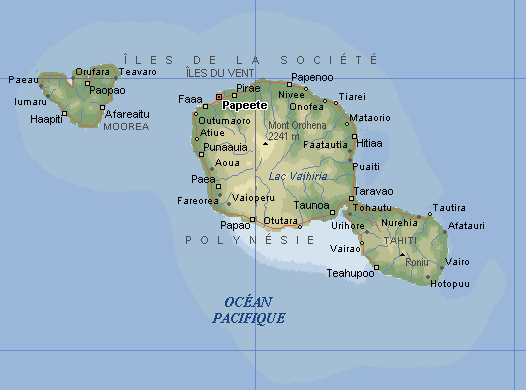
Tahiti ,
île de la Polynésie-Française, la plus grande de l'archipel de la
Société, dans les îles du Vent. Tahiti regroupait en 1990
115 820 habitants sur une superficie de 1 042 km2.
Elle mesure environ 50 km de long pour 25 km de large. Cette
île volcanique culmine à 2 241 m d'altitude au mont
Orehena, au centre. À l'est, la presqu'île de Taiarapa, dont le
point culminant se trouve à 1 323 m d'altitude au mont
Roniu, est reliée au reste de l'île, Tahiti Nui, par l'isthme
de Taravao. Tahiti est entourée d'un récif de corail. La population,
qui comprend de nombreux métis et une colonie chinoise, se concentre
sur les côtes. Papeete, dans le nord-ouest, regroupe les deux tiers
des habitants. Les bananes, les noix de coco, le sucre de canne et la
vanille constituent les principales productions agricoles. Le tourisme
est une importante ressource de l'île.
L'île
fut abordée pour la première fois en 1767 par un Européen, Samuel
Wallis, qui la nomma île du Roi-George III. Bougainville y passa
en 1768, la renomma Nouvelle-Cythère et revendiqua l'île au nom de
la France. James Cook y séjourna l'année suivante. Le Britannique
Bligh, capitaine du Bounty, y fit relâche en 1788, un an avant
la mutinerie de ses matelots. Des missionnaires français venus
s'installer dans l'île furent expulsés en 1836 par la reine Pomaré,
à la demande des Britanniques. La France instaura alors, avec
l'amiral Dupetit-Thouars, un protectorat en 1843. Tahiti devint une
colonie française en 1880, puis un territoire d'outre-mer en 1946 ;
son statut fut élargi en 1977 puis en 1984. Paul Gauguin y séjourna
dans les années 1890.
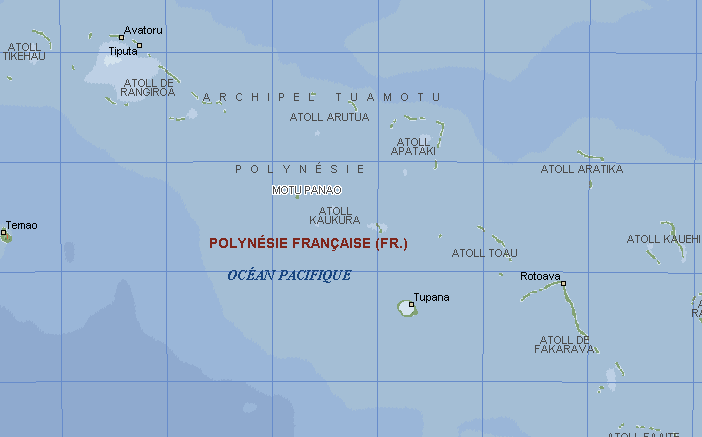
Tuamotu, îles ,
archipel de la Polynésie française, situé à l'est de Tahiti et au
sud-ouest des îles Marquises, dans le sud-est de l'océan Pacifique.
L'archipel comprend environ 80 atolls s'étendant, en deux
chaînes parallèles, sur une distance de 1 400 km. D'une
superficie de 880 km2,
il regroupe 12 374 habitants. Ces îles, très basses, sont
souvent sans eau douce courante. Les îles principales sont Rangiroa,
Fakarava, Hao et Makemo. Le ramassage des perles et la récolte du
coprah constituent les principales activités économiques de ces
îles, reliées pour certaines à Papeete par avion. Les atolls de
Mururoa et de Fangataufa sont utilisés par la France pour les essais
nucléaires. Visitées par les Espagnols en 1606, les îles devinrent
protectorat français en 1844 et furent annexées en 1880.
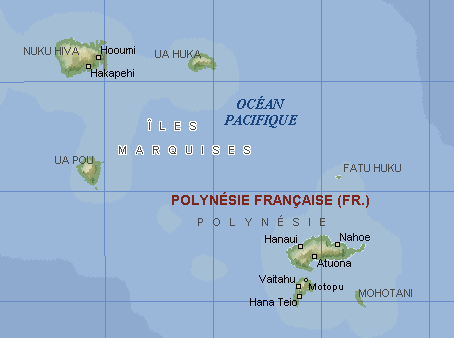
Marquises, îles ,
archipel de la Polynésie-française (territoire français
d'outre-mer), dans l'océan Pacifique, sur le 10e parallèle
sud. L'archipel est situé au milieu du Pacifique, au nord-est des
îles Tuamotu. Les dix îles Marquises ont une superficie totale de
1 274 km2
pour une population totale estimée en 1988 à
7 538 habitants. Le groupe nord-ouest comprend Nuku Hiva, Ua Huka
et Ua Pou ; le groupe sud-est comprend Hiva oa, Fatu
Hiva et Tahuata. Taiohae, le chef-lieu, se trouve sur Nuku Hiva.
D'origine volcanique, culminant à plus de 1 000 m
d'altitude, les îles Marquises sont montagneuses et fertiles avec des
noix de coco, du tabac et des arbres à pain. Hiva oa abrite la
tombe du peintre Paul Gauguin. Abordées pour la première fois par un
Européen en 1595, les îles Marquises furent touchées par James Cook
en 1775, puis annexées par la France en 1842 par Dupetit-Thouars.
Elles furent incluses dans les Territoires français de l'Océanie en
1880 puis dans la Polynésie française en 1958.
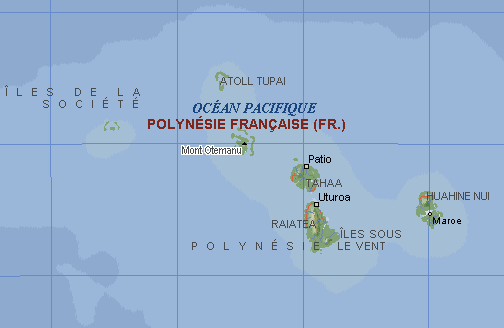
Société, îles de la ,
archipel situé dans l'océan Pacifique-Sud, faisant partie du
territoire d'outre-mer de la Polynésie-Française. L'archipel est
divisé en deux groupes : les îles du Vent et les îles
Sous-le-Vent. Les îles du Vent comprennent Tahiti, Moorea et Mehetia ;
les îles Sous-le-Vent comprennent Raiatea, Huahiné, Tahaa et Bora
Bora. La superficie totale des terres est d'environ 1 685 km2,
Tahiti en occupant environ 1 036 km2.
Les îles sont volcaniques, montagneuses et entourées de récifs de
corail qui forment un lagon côtier. Le plus haut sommet, le mont
Orohena, à Tahiti, culmine à 2 241 m d'altitude. Le climat
est chaud et humide. Les principaux produits agricoles sont la noix de
coco, le café et la vanille ; le café, le coprah, la nacre et
la vanille représentent la majeure partie des exportations. Le
tourisme constitue également une industrie importante des îles. La
population de l'archipel s'élevait en 1990 à
140 341 habitants.
Les
îles furent visitées la première fois par des Européens en 1607
quand le navigateur et explorateur portugais Pedro Fernandes de
Queirós y accosta. C'est l'explorateur britannique James Cook qui, le
premier, fit une description précise des îles, après les avoir
explorées en 1769, 1773, 1774 et 1777. Les îles devinrent un
protectorat français en 1843 puis une colonie française en 1880.
Elle sont devenues une partie du territoire d'outre-mer de la
Polynésie française en 1958.
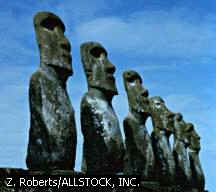
Les moai sont des statues taillées dans la
pierre volcanique. Ces géants se dressent sur des plates-formes
funéraires (ahu), comme autant de vestiges d'une
civilisation disparue.
Z. Roberts/ALLSTOCK, INC.
Pâques, île de ,
île de forme triangulaire appartenant au Chili, dans l’océan
Pacifique Sud, à environ 3 700 km à l’ouest de la
côte chilienne. L’île, constituée de trois volcans éteints, a
une superficie de 117 km2,
pour une population estimée en 1992 à 2 000 habitants.
Balayée par de forts vents alizés, l’île bénéficie d’un
climat chaud tout au long de l’année. La végétation est
essentiellement composée d’herbages. Le sol fertile permet de
cultiver la pomme de terre, la canne à sucre, le taro, le tabac,
ainsi que les fruits tropicaux. La première source d’eau douce
est l’eau de pluie qui s’amoncelle dans les lacs des cratères.
Le point culminant de l’île se situe à 538 m d’altitude.
En 1722, quand les premiers Européens arrivèrent, plusieurs
centaines de Polynésiens habitaient l’île, mais la maladie et
les rafles des marchands d’esclaves réduisirent ce nombre à
moins de 200 à la fin du XIXe siècle.
Des mariages eurent lieu entre Polynésiens et Chiliens.
L’île
doit son nom à l’explorateur hollandais Jacob Roggeveen, qui y
accosta le jour de Pâques 1722. Le gouvernement chilien annexa l’île
en 1888. Sur la côte ouest, une zone est réservée par le
gouvernement à la population indigène ; le reste de l’île
est utilisé comme pâture pour les moutons et le bétail.
L’île
de Pâques est d’une importance archéologique considérable car
il s’agit du site le plus riche en monuments mégalithiques de
toutes les îles du Pacifique ; de plus, la découverte de
tablettes a permis d’apporter la preuve de l’existence précoce
d’un système d’écriture en Polynésie.
Les
hommes qui taillèrent les mégalithes et gravèrent les tablettes
restent cependant méconnus. Le moment de l’arrivée des premiers
habitants est incertain : était-ce voici dix-huit siècles ou
plus tardivement ? Des preuves archéologiques et botaniques
tendent à démontrer que les premiers habitants de l’île
étaient d’origine sud-américaine. Par la suite, les ancêtres
des Polynésiens sont venus en pirogue des îles Marquises, ils ont
massacré les habitants et fait de l’île leur patrie. De nombreux
archéologues pensent qu’au temps de l’invasion les mégalithes
(environ 600 statues) étaient érigés sur toute l’île et
que beaucoup furent détruits par les Polynésiens au cours d’une
période de violences sur l’île de Pâques.
Les
grandes plates-formes d’inhumation, appelées ahus, qui furent
utilisées comme support des rangées de statues sont les plus
grands monuments de pierre existants. Les ahus étaient situées sur
des promontoires ou des sites dominant la mer. Chaque ahu était
construite avec des blocs de pierre ordonnés et ajustés sans
mortier. La plate-forme d’inhumation supportait habituellement 4
à 6 statues, bien qu’il existe une ahu, appelée Tongariki,
qui en supporte quinze. À l’intérieur de la plupart des ahus,
des caveaux abritent des sépultures individuelles ou collectives.
Environ
cent statues, ou moai, sont encore érigées sur l’île ;
leur hauteur varie de 3 à 12 m. Taillées dans le tuf, roche
volcanique tendre, elles représentent des êtres humains aux
oreilles et au nez allongés. La roche était extraite du cratère
nommé Rano-Raraku, où demeurent plusieurs statues inachevées,
dont une mesure 21 m de long. La plupart des statues sur les
plates-formes d’inhumation portaient des couronnes cylindriques de
tuf rouge ; la plus grosse couronne pesait environ
27 tonnes.
Des
fouilles ont également révélé la présence de grottes cachées
contenant des vestiges de tablettes en bois endommagés, et de
nombreuses petites sculptures de bois. Les tablettes sont décorées
de personnages finement sculptés et stylisés, qui semblent être
une forme d’idéographie, celle-ci restant à ce jour encore
indéchiffrable.
|